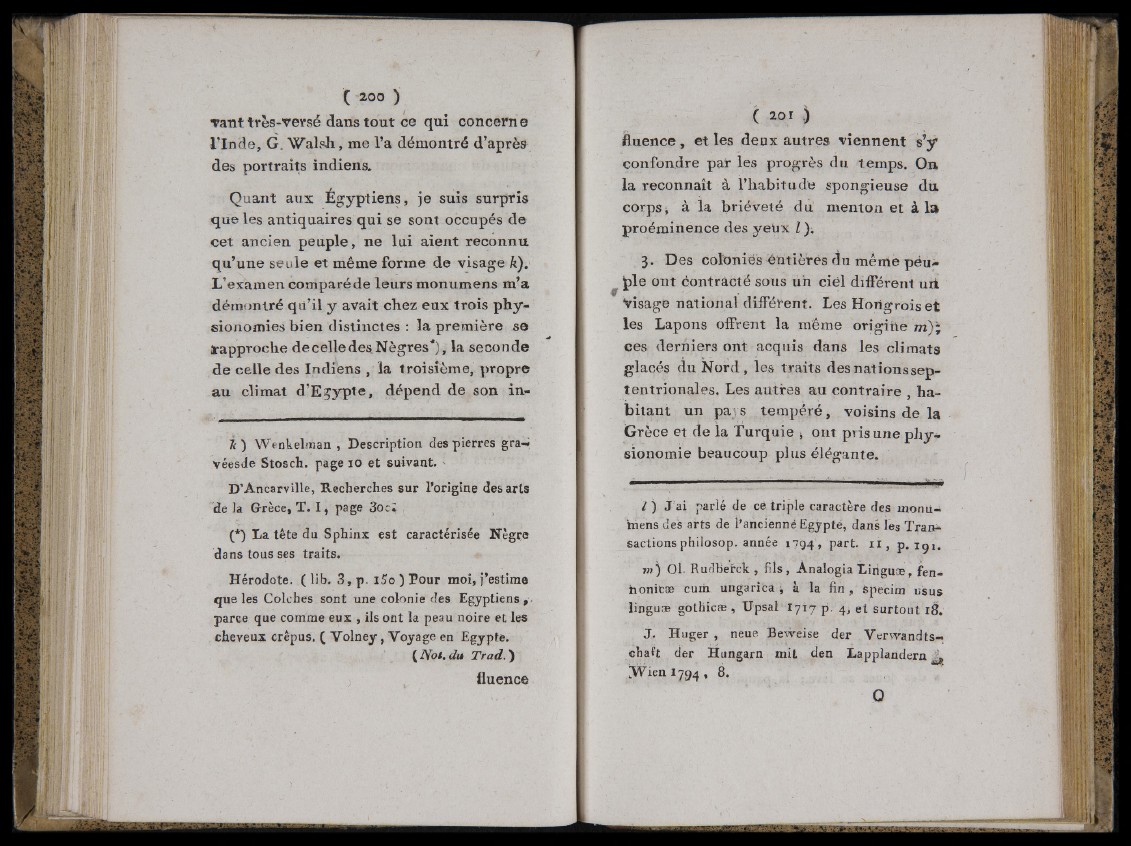
Tant très-versé dans tout ce qui concerne
l ’Inde, G. Wâlsfo', me l’a démontré d’après
des portraits indiens.
Quant aux É g yp tien s , je suis surpris
que les antiquaires qui se sont occupés de
c e t ancien peuple, ne lui aient reconnu
qu’une seule et même forme de visage k).
L ’examen comparé de leurs monumens m’a
démontré qu’il y avait chez eux trois p h y sionomies
bien distinctes : la première se
arapproclie dece lle des Nègres*), la seconde
de celle des Indiens , la troisième, propre
au climat d’Egjqpte, dépend de son in-
7c ) Wenkelman , Description des pierres gra-t
véesde Stosch. page 10 et suivant. *
D ’Ancarville, Recherches sur l’origine des arts
de la Grèce, T . I , page 3oc* ,
(*) L a tête du Sphinx est caractérisée Nègre
dans tous ses traits.
Hérodote, ( l ib . 3 , p. i 5o ) P o u r moi, j ’estime
que les Colebes sont une colonie des Egyptiens,,
parce que comme eux , ils ont la peau noire et les
cheveux crépus. ( V o ln e y , Voy ag e en Egypte.
( Not, du Trad. )
fluence
ifluence, e l les deux autres viennent s’ÿ
confondre par les progrès du temps. On
la reconnaît à l ’habitude spongieuse du
corps à la brièveté du menton et à la
proéminence des yetix l ).
3. Des colonies Entières du mênie peu*
£le ont contracté sous uh ciél différent uii
Visage national différent. Les Hongrois e t
les Lapons offrent la même origitie m);
ces derniers ont acquis dans les climats
glacés du N o rd , les traits des nations septentrionales,
Les autres au contraire / habitant
un pays tem p é ré , voisins de la
Grèce et de la Turquie | ont pris une p h y sionomie
beaucoup plus élégante.
/ ) J ai parlé de ce triple caractère des monu-
h ien s des arts de l’ancienné Egypte, dans les Transactions
philosop. année 179 4 , Part* i l , p. 191 .
m) Ol. RudBetck , f ils, Ànalogia Liriguoe, fen-
honitæ cum ungaricà i à la fin , Spécial usus
linguæ gothicæ , Upsal 17 1 7 p. 4; et surtout 18.
J. Huger , neue Beweise der Ve rwandts chaft
der Hungarn mit den Lappländern JL
[Wien 1 7 9 4 , 8.