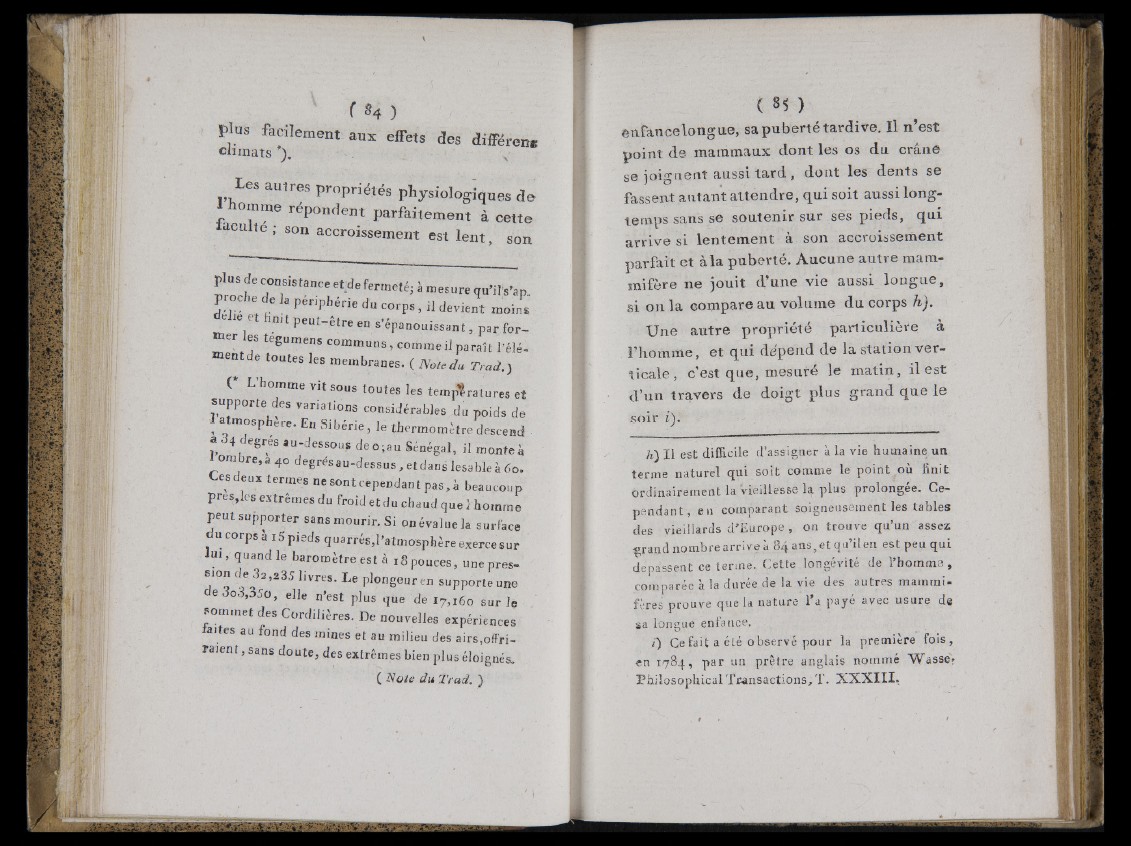
w r ç i
■ i l
psi
H
fil
■
g8gpggS§5
¡Ml|BÉyyfii:
HI
Pifi
H
i § É
I H
& jk
H$ÿë
t e *J
BIé I
SKl
( »4 )
Pins facilement aux effets des dif férer*
Cl ima ts ) . y
l e s autres propriétés physiologiques d e
1 homme répondent parfaitement à cette
acuité ; son accroissement est len t , son
Û n fh C,°n]Sistance et-de ^rrneté; à mesure Ç uW a p .
proche de la périphérie du corps, il devient « J L
* h e et hmt peut-être en s’épanouissant, par forer
es tegumens communs , comme il paraît l ’élé-
ent e toutes les membranes, j^àoiedw Trad.)
C L ’homme vit sous toutes les températures et
supporte des variations considérables du poids de
■1 atmosphère. En Sibérie, le thermomètre descend
*¿4 degrés au-dessous d e o ; au Sénégal, il monte à
1 ombre, a 40 degrés au-dessusÿ et dans lesable à 60.
Les deux termes ne sont cependant pas, à beaucoup
près,les extrêmes du froid et du chaud que 1 homme
peut supporter sans mourir. Si on évalue la surface
du corps à i 5 pieds quarrés,l’atmosphère exerce sur
’ qaand le ^ romè t r e est à j § pouces, une prest
o de d2’235 hvres. L e plongeur en supporte une
de 3o3,35o , elle n’est plus que de 17,160 sur Je
. ornmet des Cordillères. De nouvelles expériences
taites au fond des mines et au milieu des airs,offriraient,
sans doute, des extrêmes bien plus éloignés,
( Noie du Trad. )
( 8$ )
e n f a n c e longue, sa puberté tardive. Il n’est
point de mammaux dont les os du crâne
se joignent aussi tard , dont les dents se
fassent autant attendre, qui soit aussi longtemps
sans se soutenir sur ses pieds, qu i
arrive si lentement à son accroissement
parfait et à la puberté. Aucune antre mammifère
ne jouit d’une vie aussi lo n g u e ,
si on la compare au volume du corps h).
Une autre propriété particulière à
l ’homme, et qui dépend de la station ve rtic
a le , c ’e s t que, mesuré le matin, il est
d’un travers de doigt plus grand que le
soir i).
h) I l est difficile d’assigner à la vie humaine un
terme naturel qui soit comme le point ou finit
ordinairement la vieillesse la plus prolongée. Cependant
, en comparant soigneusement les tables
des vieillards d’ Europe , on trouve qu’un assez
■grand nombre arrive a 84 ans, et qu il en est peu qui
dépassent ce terme. Cette longévité de l’homme ,
comparée à la durée de la vie des autres mammifères
prouve que la nature 1 a payé avec usure de
sa longue enfance.
/) Ce fait a élé o bservé pour la première fo is ,
en 1784, par un prêtre anglais nommé "Wasser
3?hilosophical Transactions, T. X X X I I I .