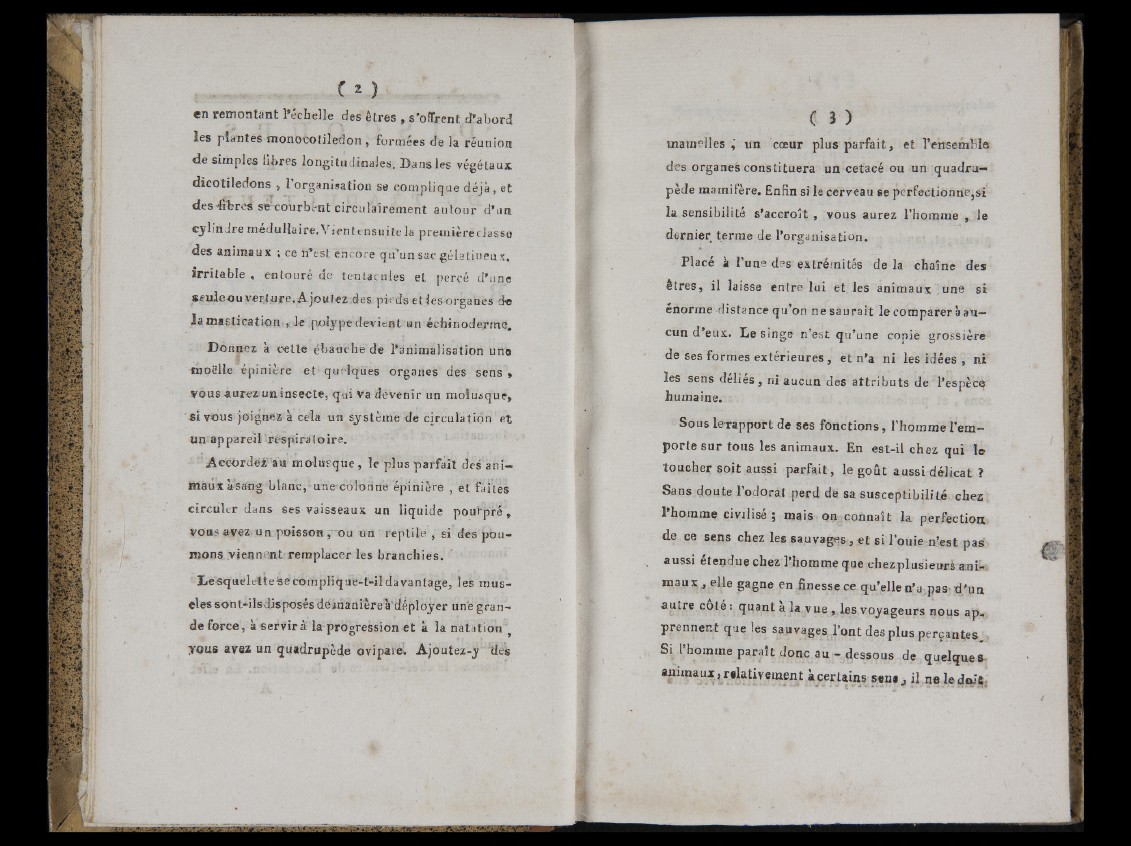
en remontant l’échelle des êtres , s ’offrent d’abord
les plantes monocotiledon , formées de la réunion
de simples libres longitudinales. Dans les végétaux
dicotiledons > 1 organisation se complique déjà, et
des-fîbres stecourbént circulaîrement autour d'un
cylindre médullaire. Vientensuite la premièreclasse
des animaux ; ce n’ est encore qu'un sac gélatineu x,
irritable , entouré de tentacules et perçé d’ une
seu leou v e r iu re .Ajou te z des pieds etlesorganes de
la mastication j le ..polype devient un écfainoderme.
Donnez à cette ébauche de l’ ànimalisation une
iboëlle épinière et quelques organes des sens*
vous aurezuninsec te, qui va devenir un molusque,
si vous joignez à cela un système de circulation et
un appareil -respira loire.
Ac corde z au molusque, le plus parfait des animaux
à sang blanc,; une colon né épinière , et faites
circuler dans ses vaisseaux un liquide pourpré,
vous avez un poisson , ou un reptile , si des poumons
viennent remplacer les branchies.
Lésquelettefce complique-t-il davantage, les muscles
sont-ilsdisposés deahanîèreàvcléployer une grande
force, à s e rv ira la progression et à la natation
yous ayez un quadrupède ovipare. Ajoute z -y des
( 5 )
mamelles,' un coeur plus pa r fa it , et l’ensemble
des organes constituera un cetacé ou un quadrupède
mamifère. Enfin si le cerveau se perfectionne,si
la sensibilité s’a c c r o î t , vous aurez l ’homme , le
dernier terme de l’organisation.
Placé à l ’une des extrémités de la chaîne des
ê tres , il laisse entre lui et les animaux une si
énorme distance qu’on ne saurait le comparer a a>.i—
cun d’eux. L e singe n’est qu’une copie grossière
de ses formes extér ieures, et n’a ni les idées , ni
les sens déliés, ni aucun des attributs de l’espècq
humaine.
Sous levapport de ses fonc t ions , l ’homme l’emporte
sur tous les animaux. En est-il chez qui le
toucher soit aussi parfait, le goût aussi délicat ?
Sans doute l ’odorat perd de sa susceptibilité chez
1 homme civilise j mais on connaît la perfection
de ce sens chez les sauvages, et si l ’onie n’est pas
aussi étendue chez l’homme que chezplusieurs ani-
mau x , elle gagne en .finesse ce qu’elle n’ a-pas d ’ un
a ptre cote: quant à la vue , les voyageurs nous a p.
prennent que les sauvages l ’ont des plus perçantes
Si l homme paraît donc au - dessous de quelque a
animaux ? rslativement à certains sen» 3 il ne le dois.