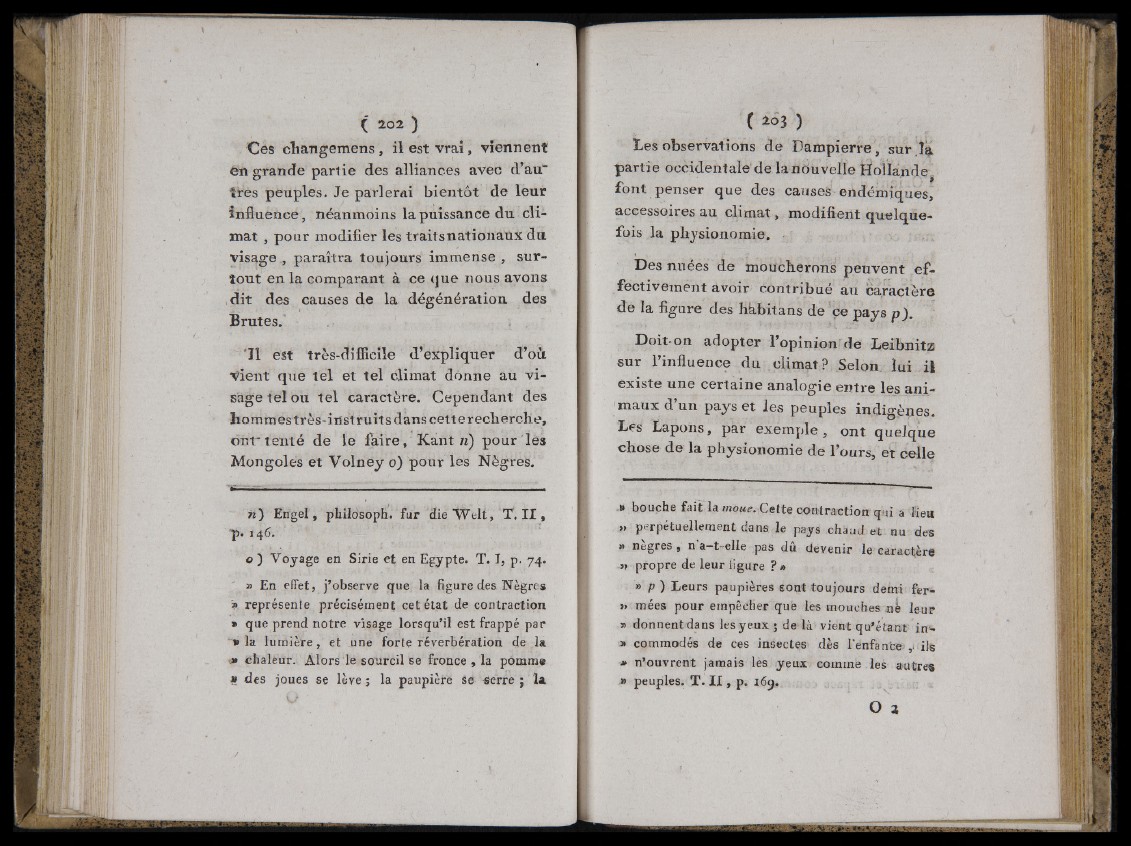
Ces changemens§ il est v ra i, viennent
grande partie des alliances avec d’au*
1res peuples. Je parlerai bientôt de leur
in flu en c e , néanmoins la puissance du c limat
, pour modifier les traits nationaux du
visage ., paraîtra toujours immense , surtou
t en la comparant à ce que nous avons
d it des causes de la dégénération des
Brutes.' .
‘I l est très-difficile d’expliquer d’oijt
Vient que te l et tel climat donne au v isage
tel ou te l caractère. Cependant des
¡hommes très-instruits dans cette recherche,
ont*tenté de le fa ir e , Kant n) pour lés
Mongoles et V o ln ë y o) pour les Nègres.
n ) Erige!, philosoph. fur d i eW e l t , T . I I ,
*p. *4 6.
o ) V o y a g e en Sirie et en Egypte. T . I, p. 74.
» En effet, j ’ observe que la figure des Nègres
v représente précisément cet état de contraction
» que prend notre visage lorsqu’ il est frappé par
1» la lumière, et une forte réverbération de la
■» chaleur. Alors le sourcil se fronce , la pomme
» d es joues se lève ; la paupière se -serre j la
y
Les observations de Dampierre , sur la
partie occidentale de la nouvelle KfoÎlande
font penser que des causes endémiques,
accessoires au c lim a t, modifient quelquefois
la physionomie. •
Des nuées de moucherons peuvent e f fectivement
avoir contribué au ¡caractère
de la figure des hàbitans de ce pays p).
Doit-on adopter l ’opinion’de Le ibnitz
sur l’influence du climat? Selon lu i i l
existe une certaine analogie entre les animaux
d’un pays et les peuples indigènes.
Les' Lapons, par exemple , ont quelque
chose de la physionomie de l ’ours, et ce-lle
* bouche fait la moue. Cette contraction qui a fieu
» perpétuellement dans le pays chaud et nu des
» negres , n a- t-elle pas dû devenir le caractère
v propre de leur figure ?»
» p ) Leurs paupières sont toujours demi fer-
>» mées pour empêcher que les mouches nè leur
» donnent dans les yeux 5 de là vient qu* étant inw
» commodés de ces insectes dès l ’enfance ,■ ils
* n’ ouvrent jamais lès y e u x comme les autre«
» peuples. T . I I , p. 169.