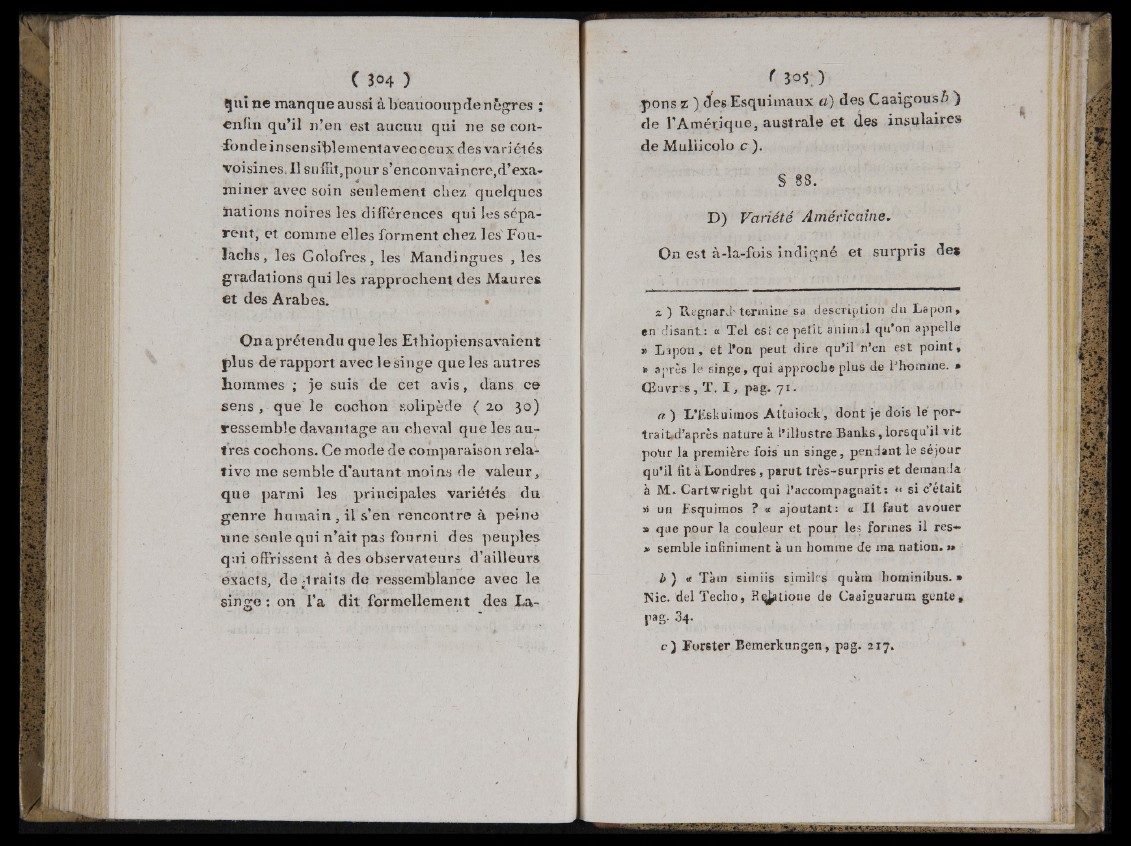
iju ip e manque aussi àbea iiooupdenèg re s ;
enfin qu’il n’en est aucuu qui ne se cou-
fbndeinsensiblemeivtavecceux des variétés
voisines, 11 suffit,pour s’enconvaincre,d’ exa-
. 4 . i •„
miner avec soin seulement chez quelques
nations noires les différences qui les séparent,
et comme elles forment chez les' Fou-
la ch s , les G olofre s , les Maudingues , les
gradations qui les rapprochent des Maures
e t des Arabes.
Qn a prétendu que les Ethiopiens avaient
plus de rapport avec le singe que les autres
hommes ; je suis de cet a v is , dans ce
sens , que le cochon solipède ( 20 $o)
ressemble davantage au cheval que les autres
cochons. Ce mode de comparaison rela^-
t iv e me semble d’autan tm o ins de va leu r,
q u e parmi les principales variétés du
g en re humain , il s’en rencontre à p e in e
une seule qui n’ait pas fourni des peuples
qui offrissent à des observateurs d’ailleurs
ex âd s , de îlraits de ressemblance avec le
s inge : on l ’a d it formellement des La-
( î ° 0
pons « ) ríes Esquimaux a) des CaaigoiisJ )
de l ’Amérjque, australe et des insulaires
de Mullicólo c ) .
§ 88.
D) Variété Américaine.
On est à-la-ibis in d ign é et surpris de*
z ) Regnardv termine sa description du L ap o n ,
en disant: « Te l est ce petit animal qu’ on appelle
» L a p o n , et l’ on peut dire qu’ il n’en est po int ;
* après le singe, qui approche plus de l ’ homme. •
CEuvrss, T . I , pag. 7 1 .
à ) L ’Eskuimos Al tu io ck , dont je dois le por-
traitid’après nature à l’ illustre B a n k s , lorsqu il v i t
po*ur la première fois un singe, pendant le séjour
qu’ il fit k Lon d re s , parut très-surpr is et demanda
à M» Car twr igbt qui l’accompagnait: « si c’était
si un Esquirnos ? « ajoutant: « I l faut avouer
» que pour la couleur et pour les formes il res*
» semble infiniment à un homme de ma nation. »
b } « Tain simiis similcs quàm horninibus. »
Tîic. del T e ch o , R^atione de Caaiguarum genteg
pag. 34.
e ) Fors ter Bemerkungen, pag. 217.