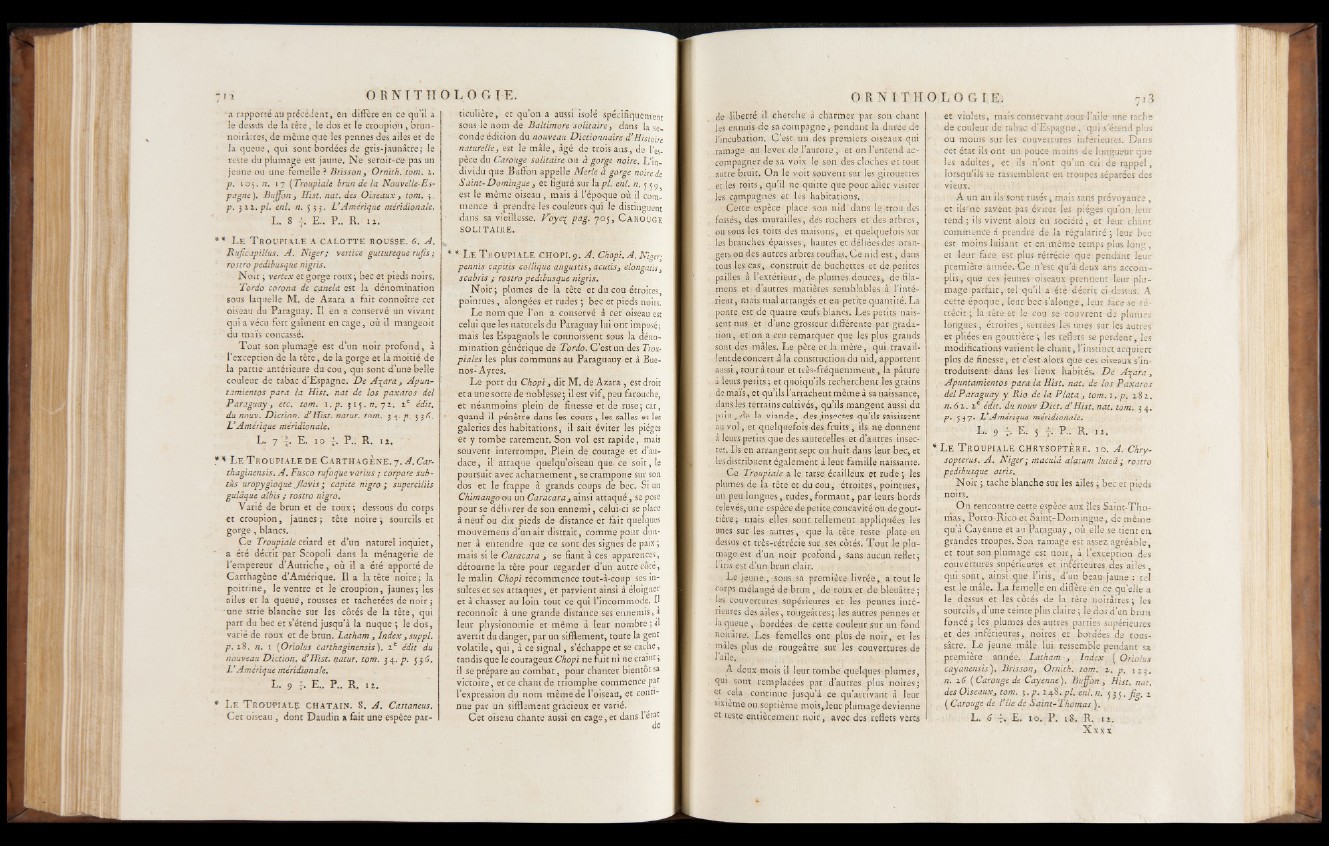
a rapporté au précédent, en diffère en ce qu’il a
le dessus de la tète, le dos et le croupion, brun-
noirâtres, de même que les pennes des ailes et de
la queue, qui sont bordées de gris-jaunâtre; le
reste du plumage est jaune. N e seroit-ce pas un
jeune ou une femelle ? Brisson> Ornith. tom. i.
p. 105. n. 17 (Troupiale brun de la Nouvelle-Espagne
). Buffon 3 Hist. nat. des Oiseaux 3 tom. 5..
p. 3 1 1 .p l. enl. n, 535. VAmérique méridionale.
L . 8 f i E.. P.. R . 12.
* L e T roupiale a calotte rousse, s . A .
Ruficapillus. A . Niger; vertice guttureque ru fis $
rostro pedibusque nigris.
No ir ; vertex et gorge roux; bec et pieds noirs.
Tordo corona de çanela est la dénomination
sous laquelle M. de Azara a fait connoîcre cet
oiseau du Paraguay. I l en a conservé un vivant
qui a vécu fort gaîment en cage, où il mangeoit
du maïs concassé.
Tour son plumage est d ’un noir profond, à
l’exception de la tête, de la gorge et la moitié de
la partie antérieure du cou, qui sont d ’une belle
couleur de tabac d’Espagne. D e A-çara, Apun-
tamientos para la Hist. nat de los paxàros del
Paraguay y etc. tom. 1. p. 315. n. 72. 2e édit,
du nouv. Diction. diH ist. natur. tom. 34. p. 5 3 6.
VAmérique méridionale.
L . 7 j . E . 10 P.. R . 12.
* Le T rou piale de C arthagène. 7. A . Car-
thaginensis. A . Fusco rufoque varius j corpore sub-
tàs uropygioque Jlavis ; capite nigro ; supercilïis
gulâque albis ; rostro nigro.
Varié de, brun et de roux; dessous du corps
et croupion, jaunes ; tête noire ; sourcils et
g o rg e , blancs. .
C e Troupiale criard et d’un naturel inquiet,
a été décrit par Scopoli dans la ménagerie de
l ’empereur d’Autriche, où il a été apporté de
Garthagène d’Amérique. Il a la tête noire; la
poitrine, le ventre et le croupion, jaunes; les
ailes et la queue, rousses et tachetées de noir;
une strie blanche sur les côtés de la tête, qui
part du bec et s’étend jusqu’à la nuque ; le dos ,
varié de roux et de brun. Latham 3 Index3suppl.
p .z S . n. 1 (Oriolus cartkaginensis). i c édit du
nouveau Diction. dyHist. rpatur. tom. 3 4. p. 5 3 6.
V Amérique méridionale.
L . 9 E.. P.. R , 1 1.
L e T r o u t i a l e c h â t a i n . S . A . Castaneus.
C e t o i s e a u , d o n t D a u d i n a f a i t u n e e s p è c e p a r -
ticulière, et qu’on a aussi isolé spécifiquement
sous le nom de Baltimore solitaire3 dans la seconde
édition du nouveau Dictionnaire d’Histoire
naturelle3 est le mâle, âgé de trois ans, de l’espèce
du Carouge solitaire ou à gorge noire. L ’individu
que Buffon appelle Merle à gorge noire de
Saint-Domingue3 et fig'uré sur lapl. enl. «.5 59
est le même oiseau , mais à l’époque où il commence
à prendre les couleurs qui le distinguent
v dans sa vieillesse. Voye■ { pag. 705, C arouge
SOLITAIRE.
* * L e T roupiale chopi. 9. A . Chopi. A . Niger
pennis capitis collique angustis, acucisj elongatist
scabris ; rostro pedibusque nigris.
N o ir ; plumes de la tête et du cou étroites,
pointues, alongées et rudes ; bec et pieds noirs.
L e nom que l’on a conservé à cet oiseau est
celui que les naturels du Paraguay lui ont imposé;
mais les Espagnols le connoissent sous la dénomination
générique de Tordo. C ’est un des Trou-
piales les plus communs au Paraguauy et à Buenos
Ayres.
L e port du Chopi 3 dit M . de Azara , est droit
et a une sorte de noblesse; il est vif, peu farouche,
et néanmoins plein de finesse et de ruse; car,
quand il pénètre dans les cours , les salles et les
galeries des habitations, il sait éviter les pièges
et y tombe rarement. Son vol est rapide, mais
souvent interrompu. Plein de courage et d’audace,
il attaque quelqu’oiseau que. ce soit, le
poursuit avec acharnement, se crampone sur son
dos et le frappe à grands coups de bec. Si un
Chimango ou un Çaracara3 ainsi attaqué, sepose
pour se délivrer de ison ennemi, celui-ci se place
à neuf ou dix pieds de distance et lait quelques
mouvemens d’un air distrait, comme pour donner
à entendre que ce sont des signes de paix ;
mais si le Caracara 3 se fiant à ces apparences,
détourne la tête pour regarder d’un autre côre,
le malin Chopi recommence tout-à-coup ses insultes
et ses attaques, et parvient ainsi à éloigner
et à chasser au loin tout ce qui l’incommode. II
reconnoîc à une grande distance ses ennemis, a
leur physionomie et même à leur nombre ; il
avertit du danger, par un sifflement, toute la genc
volatile, q u i, à ce signal, s’échappe et se cache,
tandis que le courageux Chopi ne fuit ni ne craint;
il se prépare au combat, pour chanter bientôt sa
victoire, et ce chant de triomphe commence par
l’expression du nom même de l’oiseau, et continue
par un sifflement gracieux et varié.
C et oiseau chante aussi en cage, et dans l état
de liberté il cherche' à charmer par son chant
les ennuis de sa compagne , pendant la durée de
l’incubation. C ’est un des premiers oiseaux qui
ramage au lever de 1 aurore, et on l’entend accompagner
de sa voix le son des cloches et tout
autre bruit. On le voit souvent sur les girouettes
et les toits, qu’il ne quitte que pour aller visiter
les campagnes et les habitations.
Cette espèce place son nid’ dans le trpu des
fossés,, des murailles, dés rochers et des arbres,
ou sous les toits des maisons, et quelquefois sur
les branches épaisses ,- hautes et déliées des orangers
ou des autres arbres touffus. C e nid es t, dans
tous les cas-, construit de bûchettes et de petites
pailles à l’extérieur, de, plumes douces, de fila—
mens et d’autres matières semblables à l’inté-
. rieur j mais mal arrangés et en petite quantité. La
ponte est de quatre oeufs blancs. Les petits naissent
nus et d’une grosseur differente par-gradation
, et on a cru remarquer que les plus grands
sont des mâles. L e père et la mère j qui travaillent
de concert â la construction du nid, apportent
aussi, tour à tour et très-fréquemment, la pâture
à leurs petits; et quoiqu’ils recherchent les grains
de maïs, et qu’ils l’arrachent même à sa naissance,
dans les terrains cultivés, qu’ils mangent aussi du
pain, de la viande, des .insectes qu’ils saisissent
au vol, et quelquefois des fruits , ils ne donnent
à leurs petits que des sauterelles et d’autres insectes.
Ils en arrangent sept ou huit dans leur bec, et
les distribuent également à leur famille naissante.
Ce Troupiale a le tarse; écailleux et rude ; les
plumes de la.tête et du cou, 'étroites, pointues,
un peu longues, rudes, formant, par leurs bords
relevés, une espèce de petite, concavité ou degout-
tièré; mais elles sont tellement appliquées, les
unes sur les autres, que la tête reste plate en
dessus et très-rétrécie sur, ses côtés. Tout le plumage
est d’un noir profond, sans aucun reflet;
1 iris est d’un brun clair. ;
Le jeune., sous sa première livrée, a tout le
corps mélangé de brun , de roux et de bleuâtre ;
les couvertures supérieures et les pennes intérieures
des ailes, rougeâtres;,les autres pennes et
la queue , bordées de cette couleur sur un fond
noirâtre. Les femelles ont plus de noir, et les
males plus de rougeâtre sur les couvertures de
l’aile, .
A deux mois il leur tombe quelques plumes,
qui sont remplacées par d’autres plus noires;
et cela continue jusqu’à ce qu’arrivant à leur
sixième ou septième mois, leur plumage devienne
et teste entièrement noir, avec des reflets verts
et violets, mais conservant,(sous l’aile nne tache
de couleur de tabac d’Espagne, qui s’étend plus
ou moins sur les couvertures inférieures. Dans
cet état ils ont un pouce moins de longueur que
les adultes, et ils n’ont qu’ un cri de rappel,
-, lorsqu’ils se rassemblent en troupes séparées des
vieux.
A un an ils-sont rusés -, mais sans prévoyance ,
et ils-ne savent pas éviter les pièges qu’on leur
rend ; ils vivent alors en société, et leur chant
commence à prendre de la régularité ; leur bec
esc moins luisant et en même temps plus long,
et leur face est plus rétrécie que pendant leur
première année. C e n’esç qu’à deux ans accomplis
i que ces jeunes oiseaux prennent leur plumage
pa'rfaic, tel qu’il a été décrit ci-dessus. A
cetce époque,: leur bec s’a longe, leur face se rétrécit
; la tête et le cou se couvrent de plumes
longues,, étroites, serrées les unes sur les autres
et pliées en gouttière ; les reflets se perdent, les
modifications varient le chant, l’instinct acquiert
plus de finesse, et c’est alors que ces oiseaux s’in troduisent'
dans les lieux habités. De A^aray
Apuntamientos para la Hist. nat. de los Paxaros
del Paraguay y Rio de la P lata 3 tom. 1. p. 282.
n. 6 1 . 2e édit, du nouv Dict. d’Hist. nat. tom. 3 4.
p. 537. L*Amérique méridionale.
L . 9 7. E. 5 £ P.. R. 12.
* L e T roupiale chrysoptere. 10. A . Chrysopterus.
A . Niger; macula alarum ïuteâ ; rostro
pedibusque atris.
Noir ; tache blanche sur les ailes ; bec et pieds
noirs.
On rencontre cette espèce aux îles Saint-Thomas,,
Porto-Rico et Saint-Domingue, de même
qu’à Cayenne et au Paraguay, où elle se tient eu
grandes troupes. Son ramage est assez agréable,
et tout son plumage est npic, à l’exception des
couvertures supérieures et inférieures des ailes,
qui sont , ainsi que l’iris, d’un beau-jaune : tel
est le mâle. L a femelle en diffère en ce qu’elle a
le dessus et les côtés de la tète noirâtres ; les
sourcils, d’une teinte plus claire ; le dos d’un brun
foncé ; les plumes des autres parties supérieures
et des inférieures, noires et bordées de rous-
sâtre. L e jeune mâle lui ressemble pendant sa
première an,née. Latham , Index ( Oriolus
cayanensis). Brisson3 Ornith. tom. 1. p. 12 - .
n. 16 [Çarouge de Cayenne'). JBufion, Hist. nat,
des Oiseaux3 tom. 5. p. 1 48. pl. enl. ni 533. fia, z
( Carouge de l’üe de Saint-Thomas ).
L . 6 -f, E . 10. P . 18. R. 12.
X x x x