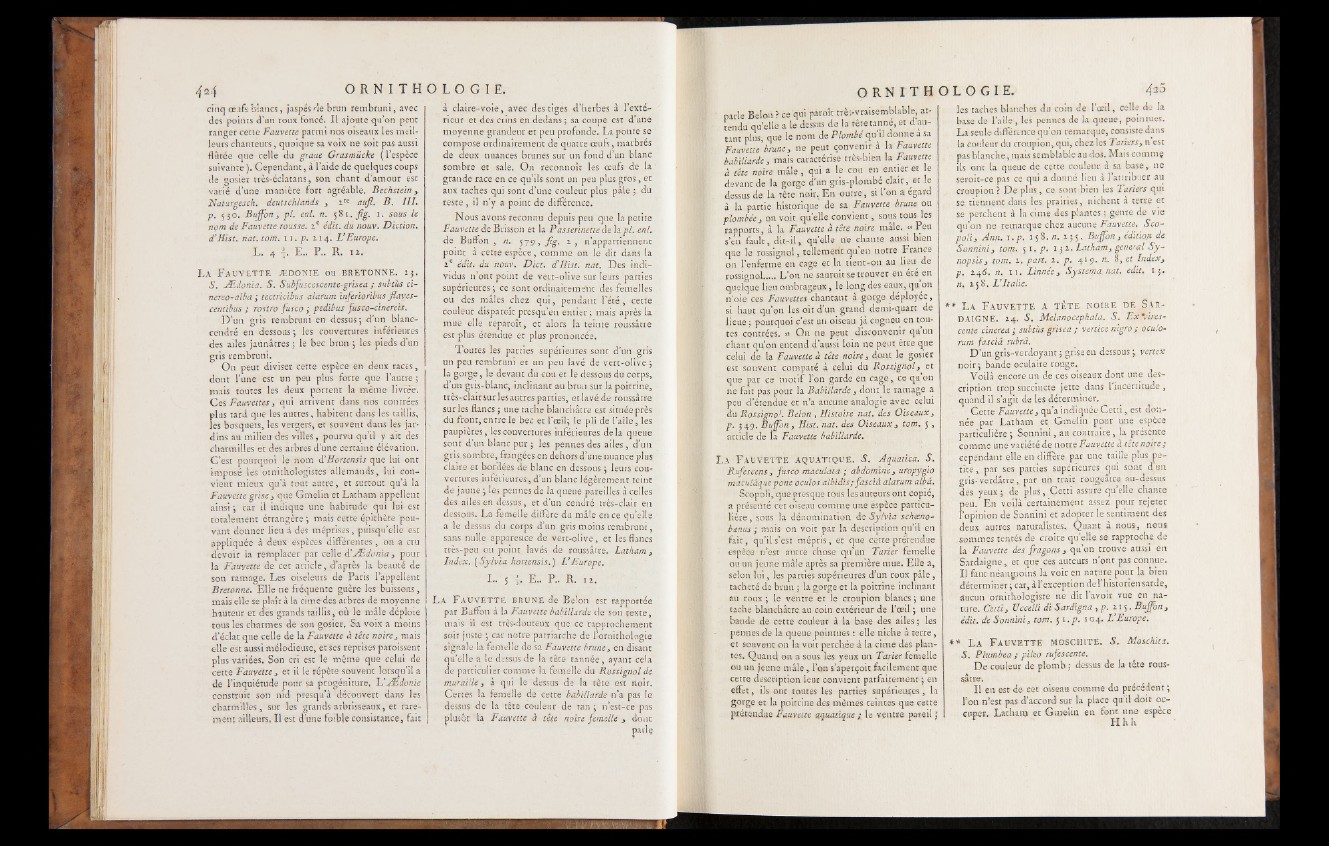
cinq oeufs blancs, jaspés de brun rembruni, avec
des points d’un roux foncé. I l ajoute qu’on peur
ranger cette Fauvette parmi nos oiseaux les meilleurs
chanteurs, quoique sa voix ne soit pas aussi
flutée que celle du graue Grasmücke ( l ’espèce
suivante ). Cependant, à l’aide de quelques coups
de gosier très-éclatans, son chant d'amour est
varié d’une manière fort agréable. Bechstein x
Naturgesch. deutschlands x i re aufl. B . III.
p. c 3 o. Buffon j pl. enl. n. 581. fig. 1. saus le
nom de Fauvette rousse. 2 e édit, du nouv. Diction.
d’Hist. nat. tom. 1 1 . p. 214. VEurope.
L . 4 f e E.. P.. R . 12.
L a F a u v e t t e ædonie ou b r e to n n e . 23.
S. JEdonia.. S. Subfuscessente-grisea ; subtàs ci-
nereo-alba ; tectncïbus alarum inferioribus jlaves-
centibus ; rostro fusco ; pedibus fusco-cinereis.
D ’un gris rembruni en dessus’, d’un blanc-
cendré en dessous 3 les couvertures inférieures
des ailes jaunâtres ; le bec brun ; les pieds d’un
gris rembruni.
On peut diviser cette espèce en deux races,
dont l’une est un peu plus forte que l ’autre ;
mais toutes les deux portent la même livrée.
Ces Fauvettes > qui arrivent dans nos contrées
plus tard que les autres , habitent dans les taillis,
les bosquets, les vergers, et souvent dans les jardins
au milieu dès villes, pourvu qu’il y ait des
charmilles et des arbres d’une certaine élévation.
C ’est pourquoi le nom d'Hortensis que lui ont
imposé les 'ornithologistes allemands, lui convient
mieux qu’à tout autre, et surtout qu’à la
Fauvette grise, que Gmelin et Latham appellent
ainsi 3 car il indique une habitude qui lui est
totalement étrangère ; mais cette épithète pouvant
donner lieu à des méprises, puisqu’elle est
appliquée à deux espèces différentes, on a cru
devoir la remplacer par celle à’Æ don ia , pour
la Fauvette de cet article, d’après la beauté de
son ramage. Les oiseleurs de Paris l’appellent
Bretonne. Elle ne fréquente guère les buissons,
mais elle se plaît à la cime des arbres de moyenne
hauteur et dés grands taillis, où le mâle déploie
tous les charmes de son gosier, Sa voix a moins
d’éclat que celle de la Fauvette à tête noire mais
elle est aussi mélodieuse, et ses reprises paroissent
plus variées. Son cri est le même que celui de
cette Fauvette et il le répète souvent lorsqu’il a
de l ’inquiétude pour sa progéniture, U Ædonie .
construit son nid presqu’à découvert dans les
charmilles , sur les grands arbrisseaux, et rare-
nient ailleurs, I l esc d une faible consistance, fait
à claire-voie, avec des tiges d ’herbes à l’extérieur
et des crins en dedans; sa coupe est d’une
moyenne grandeur et peu profonde. La ponte se
compose ordinairement de quatre oeufs, marbrés
de deux nuances brunes sur un fond d’un blanc
sombre et sale. On reconnoît les oeufs de la
grande race en ce qu’ils sont un peu plus gros, et
aux taches qui sont d’une couleur plus pâle ; dit
reste , il n’y a point de différence.
Nous avons reconnu depuis peu que la petite
Fauvette de Brisson et la Passerinette de la pl. enl.
de B u ffon , n. 575), fig. 2 , n’appartiennent
point à cette espèce, comme on le dit dans la
2e édïu du nouv. Dict. d'IIist. nat. Des individus
n’ont point de vert-olivè sur leurs parties
supérieures ; ce sont ordinairement des femelles
ou des mâles chez q u i, pendant l’é té , cette
couleur disparoît presqu’en entier; mais après la
mue elle reparoît, et alors la teinte roussâtre
est plus étendue et plus prononcée.
Toutes les parties supérieures sont d’un gris
un peu rembruni et un peu lavé de vert-olive ;
la gorge, le devant du cou et le dessous du corps,
d’un gris-blanc, inclinant au brun sur la poitrine,
très-_clairsur les autres parties, et lavé de roussâtre
sur les flancs ; une tache blanchâtre est située près
du front,entre le bec et l’oeil; le pli de l’aile , les
paupières, les couvertures inférieures delà queue
sont d’un blanc pur ; les pennes des ailes, d’un
gris sombre, frangées en dehors d’une nuance plus
claire et bordées de blanc en dessous ; leurs couvertures
inférieures, d ’un, blanc légèrement teint
de jaune ; les pennes de la queue pareilles à celles
des ailes en dessus , et d’un cendré très-clair en
dessous. La femelle diffère du mâle en ce qu’elle
a le dessus du corps d’un gris moins rembruni,
sans nulle apparence de vert-olive, et les flancs
très-peu ou point lavés de roussâtre. Latham x
Index. [Sylviahortensis.) L’Europe.
L . 5 E.. P.. R . 12.
L a F a u v e t t e brune de Bel on est rapportée
par Buffon à la Fauvette babil larde de son texte,
mais il est très-douteux que ce Rapprochement
soit juste ; car notre patriarche de l’ornithologie
signale la femelle de sa Fauvette brune, en disant
qu’elle a le dessus de la tête tannée, ayant cela
de particulier comme la femelle du Rossignol de
muraille, à qui le dessus de la tête est noir.
Cercès la femelle de cette babillarde n’a pas le
dessus de la tête-couleur de tan ; n’est-ce pas
plutôt ’ la Fauvette à tête noire femelle x dont
parle Belon > ce qui parole très-vratsemblable, attendu
quelle a le dessus de la rêtetanne,et tfautant
plus, que le nom de Plombé qu’il donne a sa
Fauvette hnae, ne peut convenir à la Fauvette
habillante , mais caractérise très-bien la Fauvette
à tête noire m â le , qui a le cou en entier et le
devant de la gorge d’un gris-plombe clair, et 1®
dessus de la tête noir. En outre, si 1 on a égard
à la partie historique de sa Fauvette bruns ou
plombée p on voit qu’elle convient, sous tous les
rapports, à la Fauvette à. tête noire male. « Peu
s’en fault, d it- il, qu’elle ne chante aussi hien
que le rossignol, tellement qu en notre France
on l’enferme en cage et la tient-on au lieu^ ne
rossignol.....L ’on ne sautoir se trouver en été, en
quelque lieu ombrageux, le long des eaux, qu on
n'aie ces Fauvettes chantant a gorge deployee,
si haut qu’pn les oit d’un gr^nd demi-quart de
lieue ; pourquoi c’est un oiseau jà cogneu en toutes
contrées. « On ne peut disconvenir qu’un
chant qu,’on entend d’aussi loin ne peut, être que
celui de la Fauvette à tête noire x donc le gosier
est souvent comparé à celui du Rossignols et
que par ce motif l’on garde en cage, ce qu’on
11e fait pas pour la Babillarde x dont le ramage a
peu d’étendue et n’a aucune analogie avec, celui ■
du Rossignol. Belon x Histoire nat. des Oiseaux 3
p. 349. Buffon x Hist. nat. des Oiseaux y tom. 5 >
article de la Fauvette babillarde.
L a F au v e t t e aq ua tiqu e ,. S . Aquatica. S.
Rufescens , fusco maculata ; abdomine x uropygio
ma eu laque pone ociilos albidis; fas cia alarum al'bâ.
Scopoli, que presque tous les auteurs ont copié,
a présenté cet biseau comme une. espèce particulière,
sous la dénomination de Sylvia schcx.no-
bantis ; mais on voit par la description qu’il en
fa it, qu’il sfesc mépris, et que cette prétendue
espèce n’est autre chose qu’un Tarier femelle
o.u un jeune mâle après sa première mue. Elle a,
selon lu i, les parties supérieures d’un roux pâle,
tacheté de brun ; la gorge et la poitrine inclinant
au roux ; le ventre et le croupion blancs ; une
tache blanchâtre au coin extérieur de l’oeil ; une
bande de cette couleur à la base des ailes ; les
pennes de la queue pointues : elle niche à terre,
et souvent on la voit perchée à la cime des plantes.
Quand; on a sous les yeux un Tarier femelle
ou un jeune mâle, l’on s’aperçoit, facilement que
cette description leu* convient parfaitement ; en
effet, ils ont toutes les parties supérieures, la
gorge et la poirrine des. mêmes teintes que cette
prétendue Fauvette aquatique i le ventre pareil ;
les taches blanches du coin de l’oe il, celle de la
base de l’a ile , les pennes de la queue, pointues.
L a seule différence qu’on remarque, consiste dans
la couleur du croupion, qui, chez les Tariersx n esc
pas blanche, mais semblable au dos. Mais eommç
ils ont la queue de cette couleur à sa base, ne
seroit-ce pas ce qui a donne lieu à 1 attribuer au
croupion ? D e plus, ce sont bien les Tariers qui
se tiennent dans les prairies, nichent à terre et
se perchent à la cime des plantes ; genre de vie
qu’on ne remarque chez aucune Fauvette. S copoli
y Ann. j . p. 158. n. 235. Buffonx édition de
Sonnini x tom. 5 1. p. 132. Latham3 general S y nopsis
x tom. 2. part. 1. p. 41 q. n, 8, et Indexx
p. 246. n. 1 1 . Linnée x S y stem a nat. edit. 13.
n. 258. L ’ Italie.
** L a F a u v e t t e a t ê t e noire de S ard
a ig n e . 24. S . Melanocephala. Si E x Vires-
cente cinerea ,* subtus grisea ; vertice nïgro ; oculo-
rum fasciâ rubrâ.
D ’un gris-verdoyant ; grise en dessous ; vertex
noir ; bande oculaire rouge.
Voilà encore un de ces oiseaux donc une description
trop succincte jette dans 1 incertitude ,
quand il s’agit de les déterminer.
Cette Fauvettex qu’a indiquée C e t t i, est donnée
par Latham et Gmelin pour une espèce
particulière ; Sonnini, au contraire, la présence
comme une variété de notre Fauvette a tete notre ;
' cependant elle en diffère par une taille plus pet
ite , par ses parties supérieures qui sont d an
gris-verdâtre,. par un trait rougeâtre au-dessus
des yeux ; de plus, Cetti assure qu’elle chance
peu. En voilà ‘certainement assez pour rejeter
l ’opinion de Sonnini et adopter le sentiment des
deux autres uaturalist.es.. Quant à nous, nous
sommes tentés de croire qu’elle se rapproche de
la Fauvette des fragons _> qu’on trouve aussi en
Sardaigne, et que ce.s auteurs n’ont pas connue,
ï j faiic-néanmoins la voir en nature pour la bien
déterminer ; car, à l’exception de ï’his.torien sarde,
aucun ornithologiste ne die 1 avoir vue en nature.
Cettix Uccelli di Sardigna > p. 215. Buffon x
édit, de Sonnini, tom. 5 1. p. 104. L ’Europe.
. * * L a F a u v e t t e - moschite. *5. MoscKtta.
S. Plumbea ; pileo rufescente.
D e couleur de plomb ; dessus de la tête rous-
sâtee.
I l en est de- cet oiseau comme du précédent ;
l’on n*est pas d’accord sur la place qu’il doit occuper.
Latham et Gmelin en font une espèce
r H h h