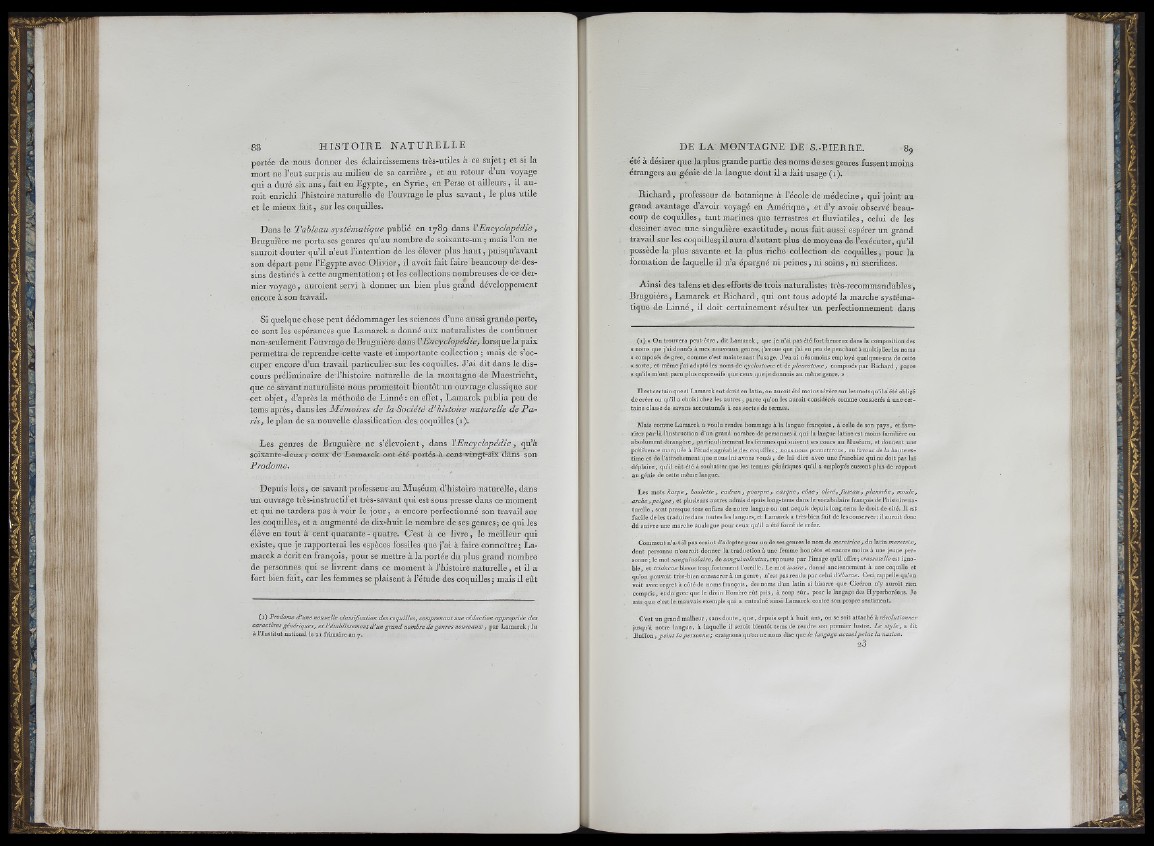
portée de nous donner des éclaircissemens très-utiles à ce sujet ; et si la
mort ne l’eut surpris au milieu de sa carrière , et au retour d’un voyage
qui a duré six ans, fait en Egypte, en Syrie, en Perse et ailleurs , il auroit
enrichi l’histoire naturelle de l’ouvrage le plus savant, le plus utile
et le mieux fait, sur les coquilles.
Dans le Tableau systématique ■^xéoXié. en 1789 dans ^Encyclopédie,
Bruguière ne porta ses genres qu’au nombre de soixante-un ; mais l’on ne
sauroit douter qu’il n’eut l’intention de les élever plus haut, puisqu’avant
son départ pour l’Egypte avec Olivier, il avoit fait faire beaucoup de-dessins
destinés à cette augmentation; et les collections nombreuses de ce eler-
nier voyage, auroient servi à donner un bien plus gra'nd développement
encore à son travail.
Si quelque-chose peut dédommager les sciences d’une aussi ^
ce sont les espérances que Lamarck a donné aux naturalistes de continuer
non-seulement l’ouvrage de Bruguière dans XEncyclopédie, lorsque la paix
permettra de reprendre cette vaste et importante collection ; mais de s’occuper
encore d’un travail particulier sur les coquilles. J’ai dit dans le discours
préliminaire de l’histoire naturelle de la montagne de Maestricht,
que ce savant naturaliste nous promettoit bientôt un ouvrage classique sur
cet objet, d’après la méthode de Linné : en effet, Lamarck publia peu de
tems après, dans les Mémoires de la Société d’histoire naturelle de P a ris,
le plan de sa nouvelle classification des coquilles (1).
Les genres de Bruguière ne s’élevoient, dans VEncyclopédie , qu’à
soixante-deux ; ceux d e Lamarck ont été portés à cent vingt-six dans SOn
Prodome,
Depuis lors, ce savant professeur au Muséum d’histoire naturelle, dans
un ouvrage très-instructif et très-savant qui est sous presse dans ce moment
et qui ne tardera pas à voir le jour, a encore perfectionné son travail sur
les coquilles, et a augmenté de dix'-huit le nombre de ses genres; ce qui les
élève en tout à cent quarante - quatre. C’est à ce livre, le meilleur qui
existe, que je rapporterai les espèces fossiles que j’ai à faire connoître; Laraarck
a écrit en françois, pour se mettre à la portée du plus grand nombre
de personnes qui se livrent dans ce moment à l’histoire naturelle, et il a
fort bien fait, car les femmes se plaisent à l’étude des coquilles; mais il eût
( 1) Prodome d ’une nouvelle classification des
caractères génériques, e t rétablissement d ’
à ITnslitut national le 2 i frimaire an 7.
comprenant une rédaction appropriée des
genres nouveaux, par Lamarck; lu
été à désirer que la plus grande partie des noms de ses genres fussent moins
étrangers au génie de la langue dont il a fait usage (1).
Richard, professeur de botanique à l’école de médecine, qui joint au
grand avantage d’avoir voyagé en Amérique, et d’y avoir observé beaucoup
de coquilles, tant marines que terrestres et fluviatiles, celui de les
dessiner avec une singulière exactitude, nous fait aussi espérer un grand
travail sur les coquilles; il aura d’autant plus de moyens de l’exécuter, qu’il
possède la plus savante et la plus riche collection de coquilles, pour la
formation de laquelle il n’a épargné ni peines, ni soins, ni sacrifices.
Ainsi des talens et des efforts de trois naturalistes très-recommandables,
Bruguière, Lamarck et Richard, qui ont tous adopté la marche systématique
de Linné, il doit certainement résulter un perfectionnement dans
( i ) « On trotivera peut-être , dit Lamarck , que je n’ai pas été fort heureux dans la composition des
« noms que j ’a i donnés à mes nouveaux genres; j’avoue que j’a i eu peu de penchantà multiplier les noms
rt composés de grec, comme c ’est maintenant l ’usage. J’en ai néanmoins employé quelques-uns de cette
« sorte, et même j’a i adopté les noms de cyclostome et depleurotome, composés par Richard , parce
« qu’ils m’ont paru plus expressifs que ceux que je donnois au même genre. »
I l est certain que si Laraarckeut écrit en latin, on auroit été moins sévère sur les mots qu'il a été obligé
de créer ou qu'il a choisi chez les autres, parce qu’on les auroit considérés comme consacrés à une certaine
classe de savans accoutumés à ces sortes de termes.
Mais comme Lamarck a voulu rendre hommage à la langue françoise, à celle de son p ays, et favoriser
par-là l’instruction d’un grand nombre de personnes à qui la langue latine est moins familière ou
absolument étrangère, parliculièrement les femmes qui suivent ses cours au Muséum, et donnent une
préférence marquée à l'étude agréable des coquilles ; nous nous permcttroas, eu faveur de la haute estime
et de l’attachement que nous lui avons voués, de lui dire avec une franchise qui ne doit pas lu i
déplaire, qu’il eût été à souhailei- que les termes génériques qu'il a employés eussent plus de rapport
au génie de cette même langue.
Les mots ha rp e , houlette , cadran , pourpre, ca squ e , cô n e , olive, fu s e a u , planorhe, moule,
a r ch e ,p e ig n e , et plusieurs autres admis depuis long-tems dans le vocabulaire François de l’hisloire naturelle
, sont presque tous enfans de notre langue ou ont acquis depuis long-tems le droit de cité. I l est
fa c ile de les traduire dans iouïes les langues, et Lamarck a très-bien fa it de les conserver: il auroit donc
dû suivre une marche analogue pour ceux qu’il a été forcé de créer.
Comment n'a -t-il pas craint d'adopter pour un de ses genres le nom de meretrice latin meretrix,
dont personne n’oseroit donner la traduction à une femme honnête et encore moins à une jeune personne;
le mot sanguinolaire, de sanguinolentus, repousse par l’image qu'il o îïvf, crassatelle est ignob
le, et tridacne blesse trop fortement l’oreille. L e mot iv o ire, donné anciennement à une coquille et
qu’on pouvoit très-bien consacrer à un genre, n’est pas rendu par celui d'éburne. Ceci rappelle qu’oa
voit avec regret à côté de noms françois, des noms d'un latin si bisarre que Cicéron n’y auroit rien
compris, et du grec que le divin Homère eût p ris, à coup sûr, pour le langage des Hyperboréeus. Je
sais que c’est le mauvais exemple qui a entraîné ainsi Lamarck contre son propre sentiment.
C’est un grand malheur, sans doute, q u e , depuis sept à huit ans, on se soit attaché à révolutionner
jusqu'à notre langue, à laquelle il seroit bientôt tems de rendre son premier lustre. L e s ty le , a dit
B u ffo n , p e in t la personne ; craignons qu’on ne nous dise que le langage actuel p e in t la nation.
23
if
n i
> t S - j
|ii