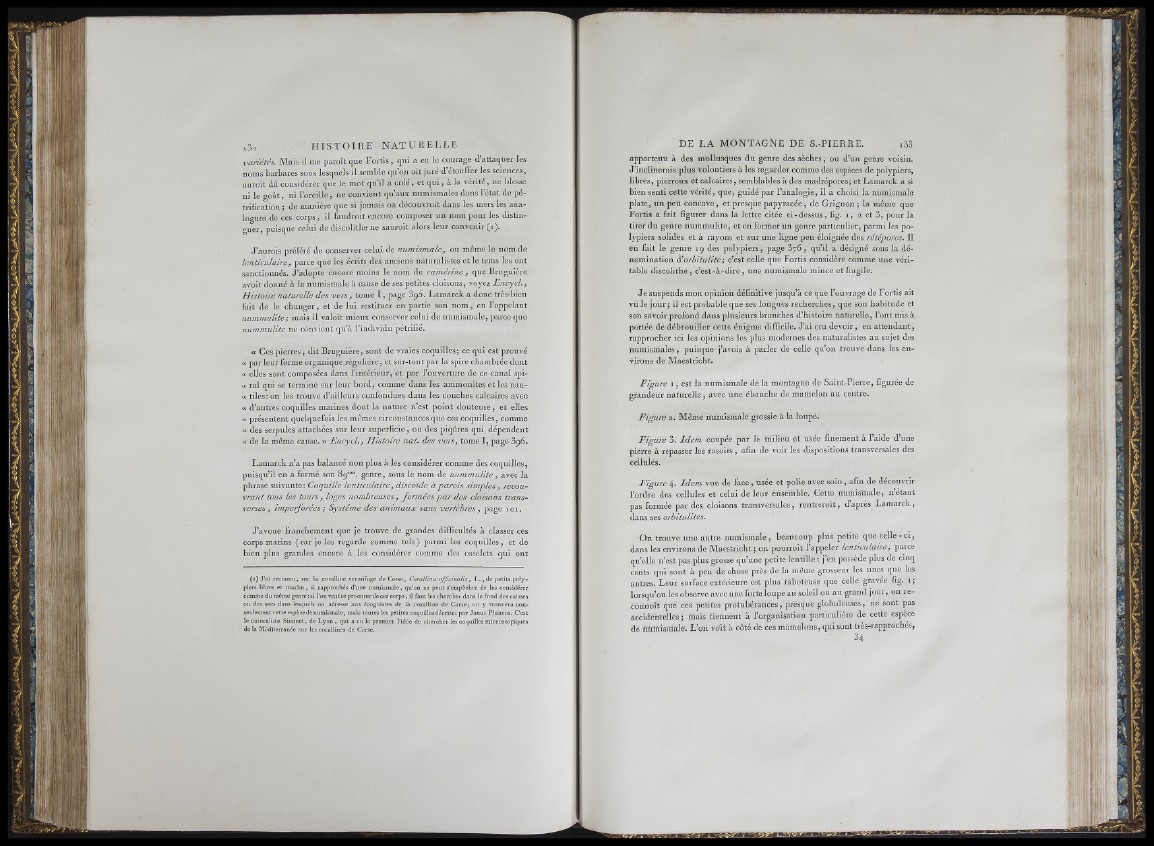
*
variétés. Mais il me paroît que Fortis , qui a eu le courage d’attaquer les
noms barbares sous lesquels il semble qu’on ait juré d’étoui'fer les sciences,
auroit dû considérer que le mot qu’il a créé, et qui, à la vérité, ne blesse
ni le goût, ni l’oreille, ne convient qu’aux numismales dans l’état de pétrification
; de manière que si jamais on découvroit dans les mers les analogues
de ces corps, il faudroit encore composer un nom pour les distinguer,
puisque celui de discolltlie ne sauroit alors leur convenir (i).
J’aurois préféré de conserver celui de numismale, ou même le nom de
lenticulaire, parce que les écrits des anciens naturalistes et le tems les ont
sanctionnés. J’adopte encore moins le nom de caniérine, que Bruguière
avoit donné à la numismale à cause de ses petites cloisons, voyez EncycL,
Histoire naturelle des vers, tome I , page Spû. Lamarck a donc très-bien
fait de le changer, et de lui restituer en partie son nom, en l’appelant
nummulite; mais il valoit mieux conserver celui de numismale, parce que
Tiummulite ne convient qu’à l’individu pétrifié.
« Ces pierres, dit Bruguière, sont de vraies coquilles; ce qui est prouvé
« par leur forme organique régulière, et sur-tout par la spire chambrée dont
cc elles sont composées dans l’intérieur, et par l’ouverture de ce canal spi-
cc rai qui se termine sur leur bord, comme dans les ammonites et les nau-
cc tiles: on les trouve d’ailleurs confondues dans les couches calcaires avec
cc d’autres coquilles marines dont la nature n’est point douteuse, et elles
cc présentent quelquefois les mêmes circonstances que ces coquilles, comme
cc des serpules attachées sur leur superficie, ou des piqûres qui dépendent
cc de la même cause. » EncycL, Histoire nat. des vers, tome I, page 3c)6.
Lamarck n’a pas balancé non plus à les considérer comme des coquilles,
puisqu’il en a formé son 89^“®. genre, sous le nom de nummulite, avec la
phrase suivante: Coquille lenticulaire, discoïde à parois simples , recouvrant
tous les tours, loges nombreuses, femiées par des cloisons transverses
, imperforées ; Système des animaux sans vertèbres , page 101.
J’avoue franchement que je trouve de grandes difficultés à classer ces
corps marins ( car je les regarde comme tels ) parmi les coquilles, et de
bien plus grandes encore à les considérer comme des osselets qui ont
( . ) .T -a ir
piers libres
comme du i
ou des sacs
seii Verne
le naliiralisie
de la Médilerrac
Li, sur la coralline vermifuge de Corse,
irins, si rapprochés d’une numismale, qu’on ne peut i
genre : si l’on veut se procurer de ces corps, il 1
lesquels oa adresse aux droguistes de la c
eu le premier l’idée de chercher 1*
, L . , de petits poly-
de les considérer
cher dans le fond <les caisses
Corse; on y trouvera noncoquilles
microscopiques
appartenu à des mollusques du genre des sèches, ou d’un genre voisin.
J’inclinerois plus volontiers à les regarder comme des espèces de polypiers,
libres, pierreux et calcaires, semblables à des madrépores; et Lamarck a si
bien senti cette vérité, que, guidé par l’analogie, il a choisi la numismale
plate, un peu concave, et presque papyracée , de Grignon ; la même que
Fortis a fait figurer dans la lettre citée ci-dessus, fig. i , 2 et 3, pour la
tirer du genre nummulite, et en former un genre particulier, parmi les polypiers
solides et à rayons et sur une ligne peu éloignée des rétépores. Il
en fait le genre 19 des polypiers, page 3y6 , qu’il a désigné sous la dénomination
èéorbitulite; c’est celle que Fortis considère comme une véritable
discolithe, c’est-à-dire , une numismale mince et fragile.
Je suspends mon opinion définitive jusqu’à ce que l’ouvrage de Fortis ait
vü le jour ; il est probable que ses longues recherches, que son habitude et
son savoir profond dans plusieurs branches d’histoire naturelle, l’ont mis à
portée de débrouiller cette énigme difficile. J’ai cru devoir, en attendant,
rapprocher ici les opinions les plus modernes des naturalistes au sujet des
numismales -, puisque j’avois à parler de celle qu’on trouve dans les environs
de Maestricht.
Figure 1, est la numismale de la montagne de Saint-Pierre, figurée de
grandeur naturelle, avec une ébauche de mamelon au centre.
Figiü-e 2. Même numismale grossie à la loupe.
Figure 3. Idem coupée par le milieu et usée finement à l’aide d’une
pierre à repasser les rasoirs, afin de voir les dispositions transversales des
cellules.
Figure 4. Idem vue de face, usée et polie avec soin, afin de découvrir
l’ordre des cellules et celui de leur ensemble. Cette nümismaie, n’étant
pas formée par des cloisons transversales, rentreroit, d’après Lamarck,
dans ses orbitulites.
On trouve une autre numismale, beaucoup plus petite que celle - c i ,
dans les environs de Maestricht ; on pourroit l’appeler lenticulaire, parce
qu’elle n’est pas plus grosse qu’une petite lentille : j’en possède plus de cinq
cents qui sont à peu de chose près de la même grosseur les unes que les
autres. Leur surface extérieure est plus iaboteuse que celle gravee fig. 1;
lorsqu’on les observe avec une forte loupe au soleil ou au grand jour, on reconnoît
qde ces petites protubérances, presque globuleuses, ne sont pas
accidentelles ; mais tiennent à l’organisation particulière de cette espèce
dé nttmisrüâle. L ’on voit à côté de ces mamelons, qui sont très-rapprochés,
34
f , /
À ■ ' !
I.':
r
;k
5 ' .
!; .
S - :
^ •
k. ’