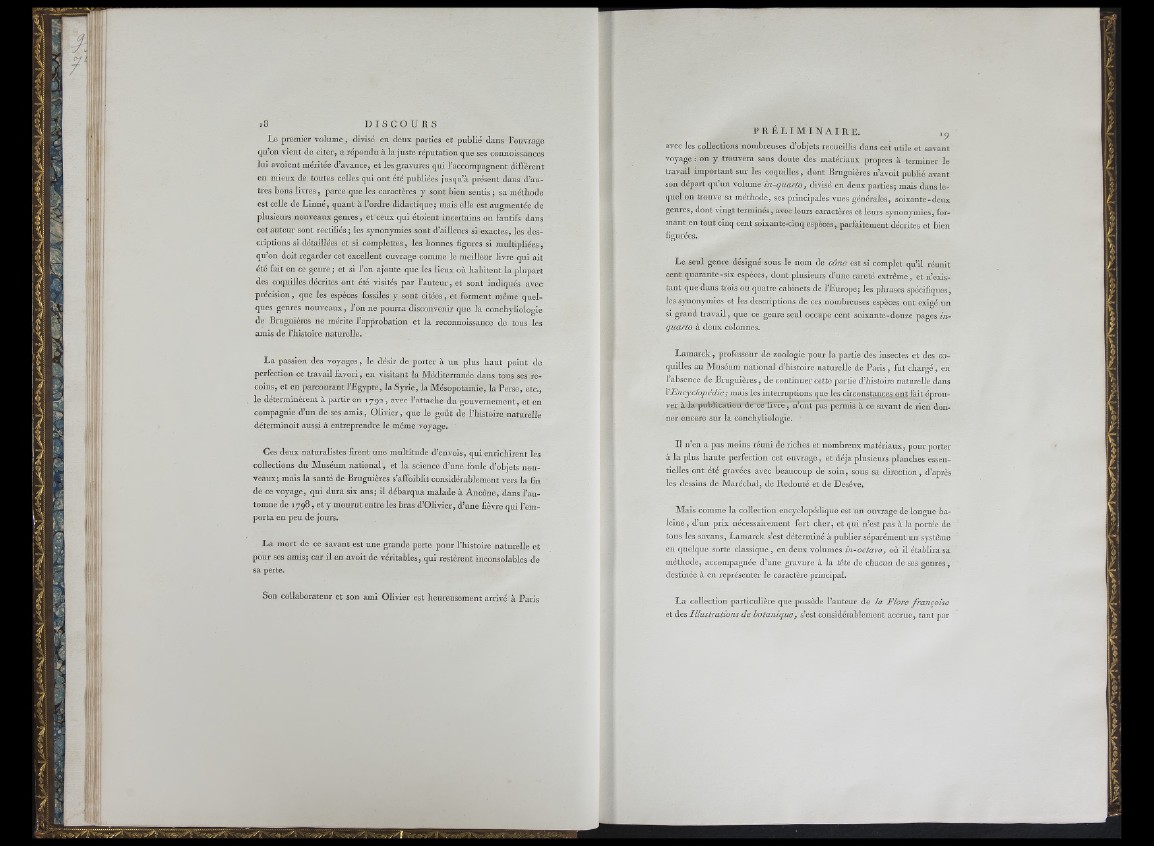
1(11
18 D I S C O U R S
Le premier volume ^ divisé en deux parties et publié dans l’ouvrage
qu’on vient de citer, a répondu à la juste réputation que ses connoissances
lui avoient méritée d’avance, et les gravures qui l’accompagnent diffèrent
en mieux de toutes celles qui ont été publiées jusqu’à présent dans d’autres
bons livres, parce que les caractères y sont bien sentis ; sa méthode
est celle de Linné, quant à l’ordre didactique; mais elle est augmentée de
plusieurs nouveaux genres, et ceux qui étoient incertains ou fautifs dans
cet auteur sont rectifiés; les synonymies sont d’ailleurs si exactes, les descriptions
si détaillées et si complettes, les bonnes figures si multipliées,
qu’on doit regarder cet excellent ouvrage comme le meilleur livre qui ait
été fait en ce genre ; et si l’on ajoute que les lieux où habitent la plupart
des coquilles décrites ont été visités par l’auteur, et sont indiqués avec
précision, que les espèces fossiles y sont citées, et forment meme quelques
genres nouveaux, l’on ne pourra disconvenir que la conchyliologie
de Bruguières ne mérite l’approbation et la reconnoissance de tous les
amis de l’histoire naturelle.
La passion des voyages, le désir de porter à un plus haut point de
perfection ce travail favori, en visitant la Méditerranée dans tous ses recoins,
et en parcourant l’Egypte, la Syrie, la Mésopotamie, la Perse, etc.,
le déterminèrent à partir en 179a, avec l’attache du gouvernement, et en
compagnie d’un de ses amis, Olivier, que le goût de l’histoire naturelle
déterminoit aussi à entreprendre le même voyage.
Ces deux naturalistes firent une multitude d’envois, qui enrichirent les
collections du Muséum national, et la science d’une foule d’objets nouveaux;
mais la santé de Bruguières s’affoiblit considérablement vers la lin
de ce voyage, qui dura six ans; il débarqua malade à Ancóne, dans l’automne
de 1798, et y mourut entre les bras d’Olivier, d’une fièvre qui l ’emporta
en peu de jours.
La mort de ce savant est une grande perte pour l’histoire naturelle et
pour ses amis; car il en avoit de véritables, qui restèrent inconsolables de
sa perte.
Son collaborateur et son ami Olivier est heureusement arrivé à Paris
P R E L I M I N A I R E . 19
avec les collections nombreuses d’objets recueillis dans cet utile et savant
voyage : on y trouvera sans doute des matériaux propres à terminer le
travail important sur les coquilles, dont Bruguières n’avoit publié avant
son départ qu’un volume in-quarto, divisé en deux parties; mais dans lequel
on trouve sa méthode, ses principales vues générales, soixante-deux
genres, dont vingt terminés, avec leurs caractères et leurs synonymies, formant
en tout cinq cent soixante-cinq espèces, parfaitement décrites et bien
figurées.
Le seul genre désigné sous le nom de cône est si complet qu’il réunit
cent quarante-six espèces, dont plusieurs d’une rareté extrême, et n’existant
que dans trois ou quatre cabinets de l’Europe; les phrases spécifiques,
les synonymies et les descriptions de ces nombreuses espèces ont exigé un
si grand travail, que ce genre seul occupe cent soixante-douze pages in-
quarto à deux colonnes.
Laraarck, professeur de zoologie pour la partie des insectes et des coquilles
au Muséum national d’histoire naturelle de Paris, fut chargé, en
l ’absence de Bruguières, de continuer cette partie d’histoire naturelle dans
M Encyclopédie j mais les interruptions que les circonstances ont fait éprouver
à la publication de ce livre, n’ont pas permis à ce savant de rien donner
encore sur la conchyliologie.
Il n’en a pas moins réuni de riches et nombreux matériaux, pour porter
à la plus haute perfection cet ouvrage, et déjà plusieurs planches essentielles
ont été gravées avec beaucoup de soin, sous sa direction, d’après
les dessins de Maréchal, de Redouté et de Desêve.
Mais comme la collection encyclopédique est un ouvrage de longue haleine,
d’un prix nécessairement fort cher, et qui n’est pas à la portée de
tous les savans, Lamarck s’est déterminé à publier séparément un système
en quelque sorte classique, en deux volumes in-octavo, où il établira sa
méthode, accompagnée d’une gravure à la tête de chacun de ses genres,
destinée à en représenter le caractère principal.
La collection particulière que possède l’auteur de la Flore françoise
et des Illustrations de botanique, s’est considérablement accrue, tant par
M iliiï