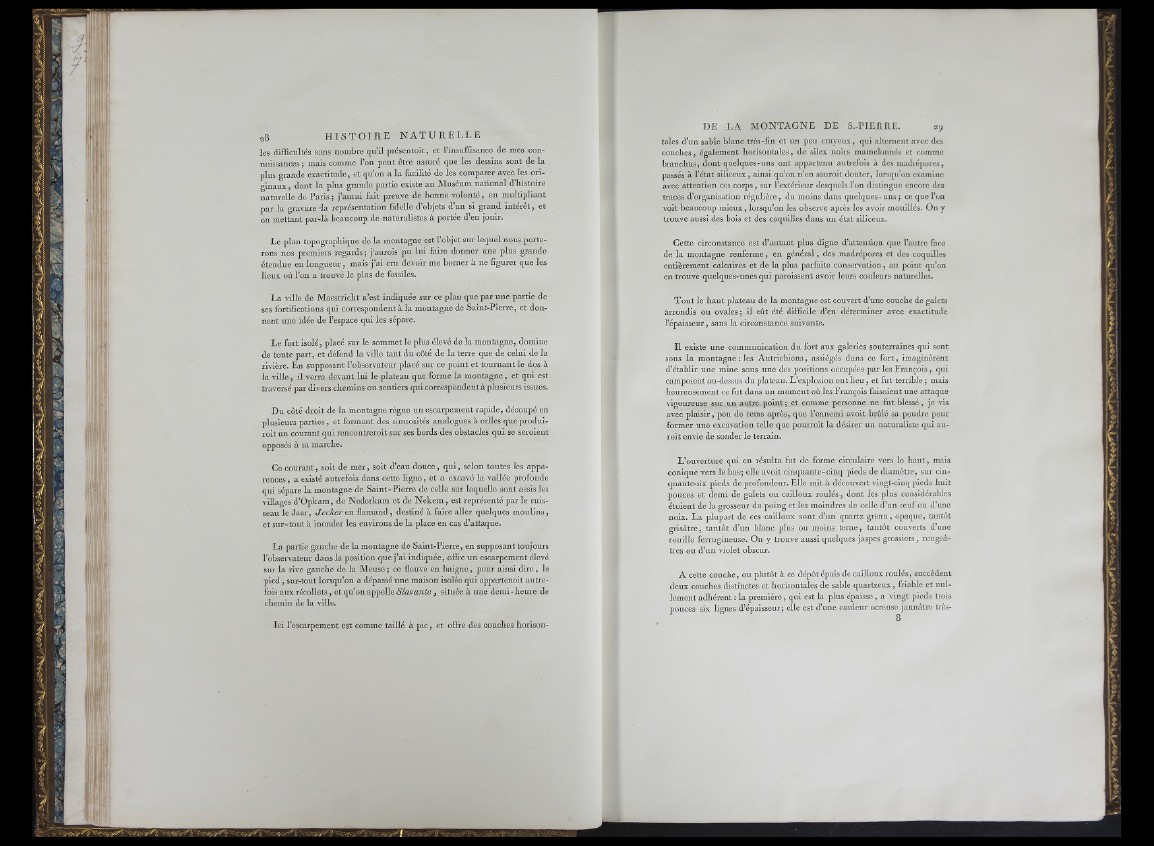
«!
les difficultés sans nombre qu’il présentoit, et l’insuffisance de mes connoissances
; mais comme l’on peut être assuré que les dessins sont de la
plus grande exactitude, et qu’on a la facilité de les comparer avec les originaux
, dont la plus grande partie existe au Muséum national d’histoire
naturelle de Paris ; j’aurai fait preuve de bonne volonté, en multipliant
par la gravure -la représentation fidelle d’objets d’un si grand intérêt, et
en mettant par-là beaucoup de naturalistes à portée d’en jouir.
Le plan topographique de la montagne est l’objet sur lequel nous porterons
nos premiers regards ; j ’aurois pu lui faire donner une plus grande
étendue en longueur, mais j’ai cru devoir me borner à ne figurer que les
lieux où l ’on a trouvé le plus de fossiles.
La ville de Maestricht n’est indiquée sur ce plan que par une partie de
ses fortifications qui correspondent à la montagne de Saint-Pierre, et donnent
une idée de l’espace qui les sépare.
Le fort isolé, placé sur le sommet le plus élevé de la montagne, domine
de toute part, et défend la ville tant du côté de la terre que de celui de la
rivière. En supposant l’observateur placé sur ce point et tournant le dos à
la v ille, il verra devant lui le plateau que forme la montagne, et qui est
traversé par divers chemins ou sentiers qui correspondent à plusieurs issues.
Du côté droit de la montagne règne un escarpement rapide, découpé en
plusieurs parties, et formant des sinuosités analogues à celles que produi-
roit un courant qui rencontreroit sur ses bords des obstacles qui se seroient
opposés à sa marche.
Ce courant, soit de mer, soit d’eau douce, qui, selon toutes les apparences
, a existé autrefois dans cette ligne, et a excavé la vallée profonde
qui sépare la montagne de Saint-Pierre de celle sur laquelle sont assis les
villages d’Opkam, de Nederkam et de Nekem, est représenté par le ruisseau
le Jaar, Jecker en flamand, destiné à faire aller quelques moulins ,
et sur-tout à inonder les environs de la place en cas d’attaque.
La partie gauche de la montagne de Saint-Pierre, en supposant toujours
l’observateur dans la position que j’ai indiquée, offre un escarpement élevé
sur la rive gauche de la Meuse ; ce fleuve en baigne, pour ainsi dire, le
pied, sur-tout lorsqu’on a dépassé une maison isolée qui appartenoit autrefois
aux récollets, et qu’on appelle Slavante , située à une demi- heure de
chemin de la ville.
Ici l’escarpement est comme taillé à p ic, et offre des couches horisontalcs
d’un sahle blanc très-fin et un peu crayeux, qui alternent avec des
couches, également horisontales, de silex noirs mamelonnés et comme
branchus, dont quelques-uns ont appartenu autrefois à des madrépores,
passés à l’état siliceux, ainsi qu’on n’en sauroit douter, lorsqu’on examine
avec attention ces corps, sur l’extérieur desquels l’on distingue encore des
traces d’organisation régulière, du moins dans quelques-uns; ce que l’on
voit beaucoup mieux, lorsqu’on les observe après les avoir mouillés. On y
trouve aussi des bois et des coquilles dans un état siliceux.
Cette circonstance est d’autant plus digne d’attention que l’autre face
de la montagne renferme, en général, des madrépores et des coquilles
entièrement calcaires et de la plus parfaite conservation, au point qu’on
en trouve quelques-unes qui paroissent avoir leurs couleurs naturelles.
Tout le haut plateau de la montagne est couvert d’une couche de galets
arrondis ou ovales ; il eût été difficile d’en déterminer avec exactitude
l’épaisseur, sans la circonstance suivante.
Il existe une communication du fort aux galeries souterraines qui sont
sous la montagne : les Autrichiens, assiégés dans ce fort, imaginèrent
d’établir une mine sous une des positions occupées par les François, qui
campoient au-dessus du plateau. L ’explosion eut lieu, et fut terrible ; mais
heureusement ce fut dans un moment où les François faisoient une attaque
vigoureuse sur un autre point; et comme personne ne fut blessé, je vis
avec plaisir, peu de tems après, que l’ennemi avoit brûlé sa poudre pour
former une excavation telle que pourroit la désirer un naturaliste qui au-
loit envie de sonder le terrain.
L ’ouverture qui en résulta fut de forme circulaire vers le haut, mais
conique vers le bas; elle avoit cinquante-cinq pieds de diamètre, sur cinquante
six pieds de profondeur. Elle mit à découvert vingt-cinq pieds huit
pouces et demi de galets ou cailloux roulés, dont les plus considérables
étoient de la grosseur du poing et les moindres de celle d’un oeuf ou d’une
noix. La plupart de ces cailloux sont d’un quartz grenu, opaque, tantôt
grisâtre, tantôt d’un blanc plus ou moins terne, tantôt couverts d’une
rouille ferrugineuse. On y trouve aussi quelques jaspes grossiers, rougeâtres
ou d’un violet obscur.
A cette couche, ou plutôt à ce dépôt épais de cailloux roulés, succèdent
deux couches distinctes et horisontales de sable quartzeux, friable et nullement
adhérent : la première, qui est la plus épaisse, a vingt pieds trois
pouces six lignes d’épaisseur; elle est d’une couleur ocreuse jaunâtre très