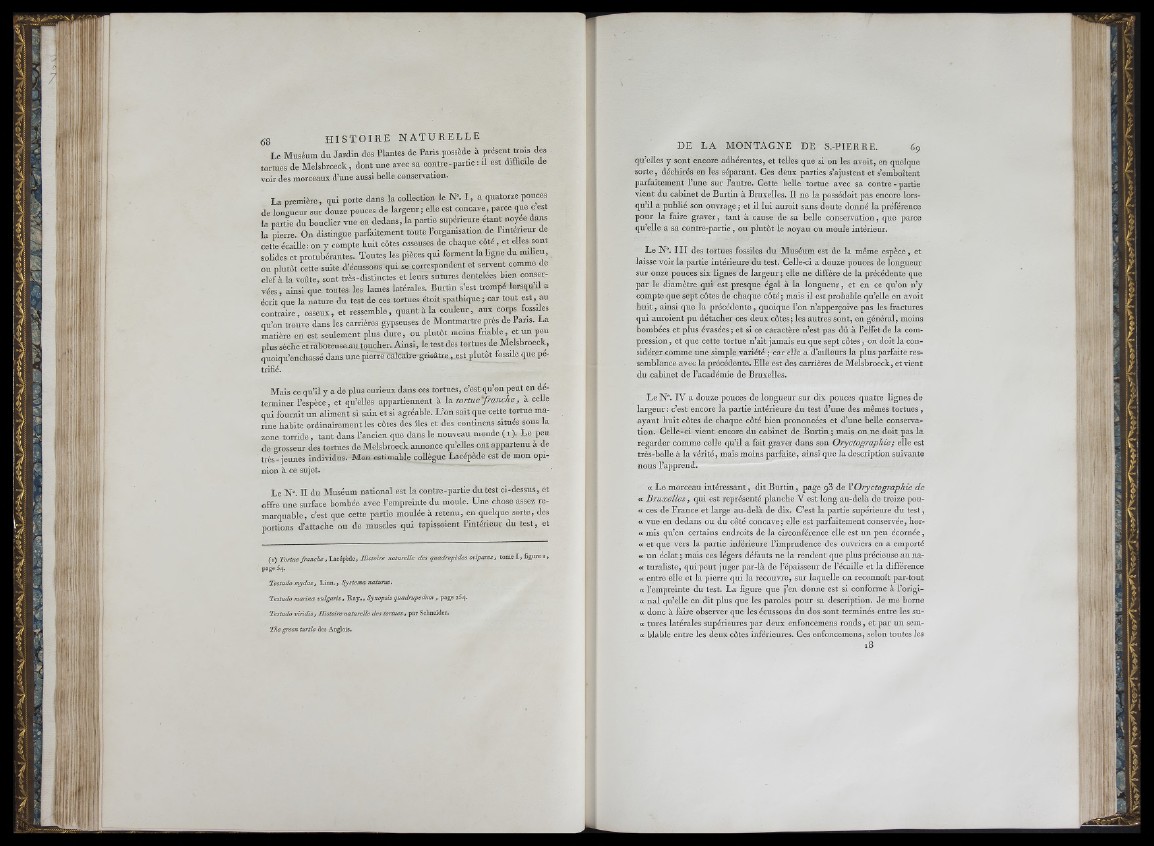
ns r.iii
Le Muséum du Jardin des Plantes de Paris possède à ^ 8™ ? «»1® des
tortues de Melsbroeck, dont une avec sa contre - partie : il est diliicile de
voir des morceaux d’une aussi belle conservation.
La première, qui porte dans la collection le N". I , a quatorze pouces
de longueur sur douze pouces de largeur; elle est concave, parce que cest
la partie du bouclier vue en dedans, la partie supérieure étant noyée dans
la pierre. On distingue parfaitement toute l’organisation de 1 intérieur de
cette écaille: on y compte huit côtes osseuses de chaque côté , et elles sont
solides et protubérantes. Toutes les pièces qui forment la ligne du milieu,
ou plutôt cette suite d’écussons qui se correspondent et servent comme de
clef à la voûte, sont très-distinctes et leurs sutures dentelées bien conservées
, ainsi que toutes les lames latérales. Burtin s’est trompé lorsqu’il a
écrit que la nature du test de ces tortues étoit spathique; car tout est, au
contraire, osseux, et ressemble, quant à la couleur, aux corps fossiles
qu’on trouve dans les carrières gypseuses de Montmartre près de Pans. La
matière en est seulement plus dure, ou plutôt moins friable, et un peu
plus sèche et raboteuse au toucher. Ainsi, le test des tortues de Melsbroeck,
quoiqu’enchassé dans une pierre calcaire grisâtre, est plutôt fossile que pé-
trifié.
Mais ce qu’il y a de plus curieux dans ces tortues, c’est qu’on peut en déterminer
l’espèce, et qu’elles appartiennent à la tonue'jranche, à celle
qui fournit nn aliment si sain et si agréable. L ’on sait que cette tortue marine
habite ordinairement les côtes des îles et des continens situés sous la
zone torride , tant dans l’ancien que dans le nouveau monde ( i ) . Le peu
de grosseur des tortues de Melsbroeck annonce qu’elles ont appartenu à de
très-jeunes individus. JVEoji estimable collègue Lacepede est de mon opinion
à ce sujet.
Le N°. II du Muséum national est la contre-partie du test ci-dessus, et
offre une surface bombée avec l’empreinte du moule. Une chose assez remarquable,
c’est que cette partie moulée à retenu, en quelque sorte, des
portions d’attache ou de muscles qui tapissoient l’intérieur du test, et
, Histoire naturelle des quadrupèdes ( i ) Tortue fra n c h e , ovipares, tome I ,
page 54.
Testudo m ydas, L in n ., Systema naturae.
Testudo marina vulgaris. R a y . , Synopsis quadrupedum , page 254.
Testudo v ir id is . Histoire naturelle des tortues, par Schneider.
The green turtle des Anglois.
DE L A M O N T A G N E DE S.-PIERRE. 69
qu’elles y sont encore adhérentes, et telles que si on les avoit, en quelque
sorte , déchirés en les séparant. Ces deux parties s’ajustent et s’emboîtent
parfaitement l’une sur l’autre. Cette belle tortue avec sa contre - partie
vient du cabinet de Burtin à Bruxelles. Il ne la possédoit pas encore lorsqu’il
a publié son ouvrage ; et il lui auroit sans doute donné la préférence
pour la faire graver, tant à cause de sa belle conservation, que parce
qu’elle a sa contre-partie, ou plutôt le noyau ou moule intérieur.
Le N®. I I I des tortues fossiles du Muséum est de la même espèce, et
laisse voir la partie intérieure du test. Celle-ci a douze pouces de longueur
sur onze pouces six lignes de largeur ; elle ne diffère de la précédente que
par le diamètre qui est presque égal à la longueur, et en ce qu’on n’y
compte que sept côtes de chaque côté; mais il est probable qu’elle en avoit
h uit, ainsi que la précédente , quoique l’on n’apperçoive pas les fractures
qui auroient pu détacher ces deux côtes; les autres sont, en général, moins
bombées et plus évasées ; et si ce caractère n’est pas dû à l’effet de la compression
, et que cette tortue n’ait jamais eu que sept côtes, on doit la considérer
comme une simple variété ; car elle a d’ailleurs la plus parfaite ressemblance
avec la précédente. Elle est des carrières de Melsbroeck, et vient
du cabinet de l’académie de Bruxelles.
Le N®. IV a douze pouces de longueur sur dix pouces quatre lignes de
largeur : c’est encore la partie intérieure du test d’une des mêmes tortues ,
ayant huit côtes de chaque côté bien prononcées et d’une belle conservation.
Celle-ci vient encore du cabinet de Burtin; mais on ne doit pas la
regarder comme celle qu’il a fait graver dans son Oryctographie} elle est
très-belle à la vérité, mais moins parfaite, ainsi que la description suivante
nous l’apprend.
« Le morceau intéressant, dit Burtin, page pS de ^Oryctographie de
« Bruxelles , qui est représenté planche V est long au-delà de treize pouce
ces de France et large au-delà de dix. C’est la partie supérieure du test,
cc vue en dedans ou du côté concave; elle est parfaitement conservée, hor-
cc mis qu’en certains endroits de la circonférence elle est un peu écornée,
Ci et que vers la partie inférieure l’imprudence des ouvriers en a emporté
« un éclat ; mais ces légers défauts ne la rendent que plus précieuse au na-
« turaliste, qui peut juger par-là de l ’épaisseur de l’écaille et la différence
cc entre elle et la pierre qui la recouvre, sur laquelle on reconnoît par-tout
cc l’empreinte du test. La figure que j’en donne est si conforme à l’origi-
« nal qu’elle en dit plus que les paroles pour sa description. Je me borne
c< donc à faire observer que les écussons du dos sont terminés entre les suce
tures latérales supérieures par deux enfoncemens ronds, et par un sem-
ct biable entre les deux côtes inférieures. Ces enfoncemens, selon toutes les
j' :
J ■ ■' ;