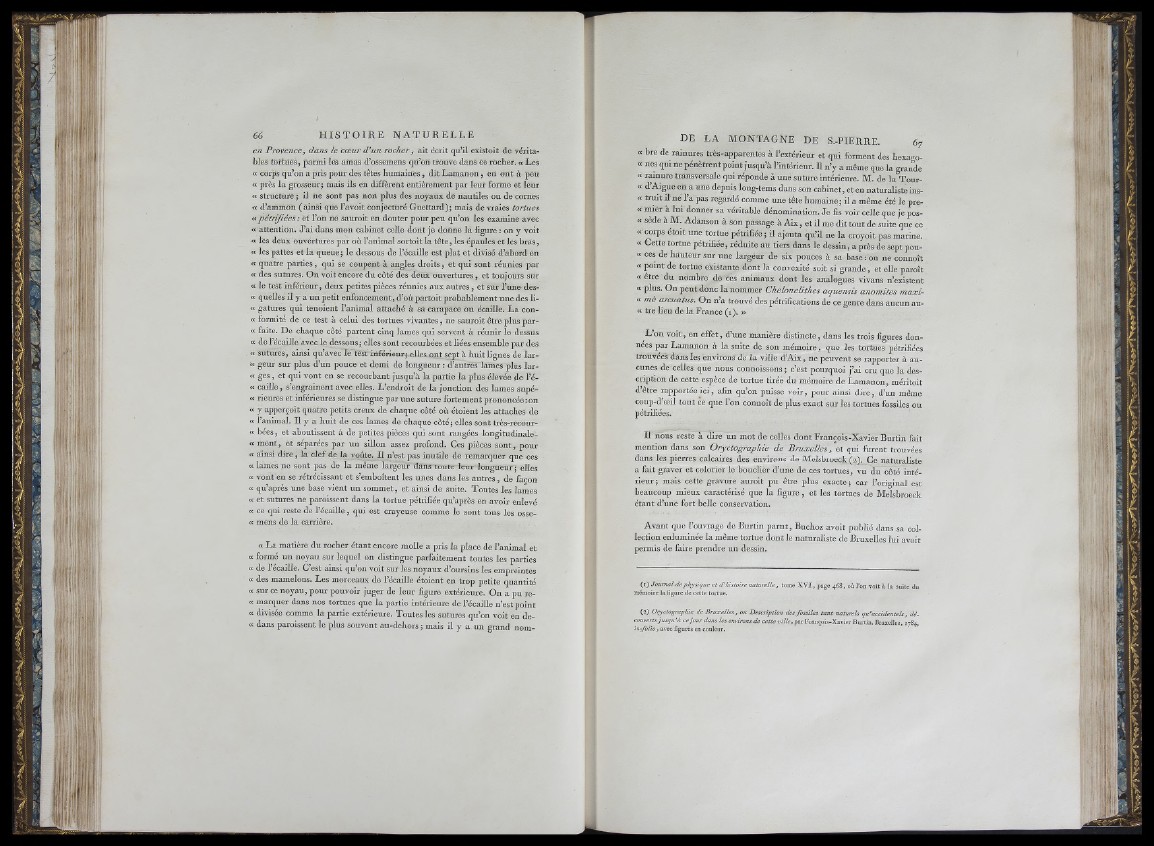
en Provence, dans le coeur d’un rocher, ait écrit qu’il existoit de véritables
tortues, parmi les amas d’ossemens qu’ori trouve dans ce rocher. « Les
« corps qu’on a pris pour des têtes humaines, dit Lamanon, en ont à peu
« près la grosseur; mais ils en diffèrent entièrement par leur forme et leur
« structure ; il ne sont pas non plus des noyaux de nautiles ou de cornes
« d’àmmoii (ainsi que l’avoit conjecturé Guettard); mais de vraies tortues
« pétrifiées : et l’on ne sauroit en douter pour peu qu’on les examine avec
« attention. J’ai dans mon cabinet celle dont je donne la figure : on y voit
« les deux ouvertures par où l’animal sortoit la tête, les épaules et les bras,
« les pattes et la queue ; le dessous de l’écailie est plat et divisé d’abord en
« quatre parties, qui se coupent à angles droits, et qui sont réunies par
« des sutures. On voit encore du côté des deux ouvertures, et toujours sur
« le test inférieur, deux petites pièces réunies aux autres , et sur l ’une des-
« quelles il y a un petit enfoncement, d’où partoit probablement une des lice
gatures qui tenoient l’animal attaché à sa carapace ou écaille. L a con-
<c formité de ce test à celui des tortues vivantes, ne sauroit être plus parce
faite. De chaque côté partent cinq lames qui servent à réunir le dessus
cc de l’écaille avec le dessous; elles sont recourbées et liées ensemble par des
ce sutures, ainsi qu’avec le test i n f é r i e u r ; elles ont sept à huit lignes de lar-
cc geur sur plus d’un pouce et demi de longueur : d’autres lames plus lar-
cc ges , et qui vont en se recourbant jusqu’à la partie la plus élevée de l ’é-
« caille, s’engrainent avec elles. L ’endroit de la jonction des lames supé-
cc neures et inférieures se distingue par une suture fortement prononcée : on
cc y apperçoit quatre petits creux de chaque côté où étoient les attaches de
cc l’animal. Il y a huit de ces lames de chaque côté; elles sont très-recour-
cc bees, et aboutissent à de petites pièces qui sont rangées longitudinale-
c< ment, et séparées par un sillon assez profond. Ces pièces sont, pour
cc ainsi dire , la clef de la voûte. Il n’est pas inutile de remarquer que ces
celâmes ne sont pas de la même largeur dans toute leur longueur; elles
et vont en se rétrécissant et s’emboîtent les unes dans les autres, de façon
te qu’après une base vient un sommet, et ainsi de suite. Toutes les lames
« et sutures ne paroissent dans la tortue pétrifiée qu’après en avoir enlevé
cc ce qui reste de l’écaille, qui est crayeuse comme le sont tous les osse-
cc mens de la carrière.
cc La matière du rocher étant encore molle a pris la place de l’animal et
te formé un noyau sur lequel on distingue parfaitement toutes les parties
cc de l’écaille. C’est ainsi qu’on voit sur les noyaux d’oursins les empreintes
cc des mamelons. Les morceaux de l’écaille étoient en trop petite quantité
« sur ce noyau, pour pouvoir juger de leur figure extérieure. On a pu re-
ct marquer dans nos tortues que la partie intérieure dePécaille n’est point
cc divisée comme la partie extérieure. Toutes les sutures qu’on voit en de-
cc dans paroissent le plus souvent au-deliors ; mais il y a un grand nora-
DE L A M O N T A G N E DE S.-PIERRE. 6y
« bre de rainures très-apparentes à l’extérieur et qui forment des hexago-
« nés qui ne pénètrent point jusqu’à l’intérieur. Il n’y a même que la grande
« rainure transversale qui réponde à une suture intérieure. M. de la Tourte
d’Aigue en a une depuis long-tems dans son cabinet, et en naturaliste ins-
tt truit il ne l’a pas regardé comme une tête humaine; il a même été le prête
mier à lui donner sa véritable dénomination. Je fis voir celle que je poste
sède à M. Adanson à son passage à A ix , et il me dit tout de suite que ce
et corps étoit une tortue pétrifiée ; il ajouta qu’il ne la croyoit pas marine,
te Cette tortue pétrifiée, réduite au tiers dans le dessin, a près de sept pou-
tt ces de hauteur sur une largeur de six pouces à sa base : on ne connoît
te point de tortue existante dont la convexité soit si grande, et elle paroît
et être du nombre de ces animaux dont les analogues vivans n’existent
et plus. On peut donc la nommer Cheloîielithes aquensîs anomites maxi-
ee mè arcuatus. On n’a trouvé des pétrifications de ce genre dans aucun au-
ec tre lieu de la France (i). »
L ’on voit, en effet, d’une manière distincte, dans les trois figures données
par Lamanon à la suite de son mémoire, que les tortues pétrifiées
trouvées dans les environs do la ville d'Aix, ne peuvent se rapporter à aucunes
de celles que nous connoissons ; c’est pourquoi j’ai cru que la description
de cette espèce de tortue tirée du mémoire de Lamanon, méritoit
d’être rapportée ic i, afin qu’on puisse voir, pour ainsi dire, d’un même
coup-d’oeil tout ce que l’on connoît de plus exact sur les tortues fossiles ou
pétrifiées.
Il nous reste à dire un mot de celles dont François-Xavier Burtin fait
mention dans son Oryctographie de Bruxelles, et qui furent trouvées
dans les pierres calcaires des environs do Melabioeck. (2). Ce naturaliste
a fait graver et colorier le bouclier d’une de ces tortues, vu du côté intérieur
; mais cette gravure auroit pu être plus exacte ; car l ’original est
beaucoup mieux caractérisé que la figure, et les tortues de Melsbroeck
étant d’une fort belle conservation.
Avant que l’ouvrage de Burtin parut, Buchoz avoit publié dans sa collection
enluminée la même tortue dont le naturaliste de Bruxelles lui avoit
permis de faire prendre un dessin.
( i ) Journal de p hy s iq ue e t d ’histoire n aturelle, tome X V I , page 4
mémoire la figure de cette tortue.
8, où l’on Toit à la suite du
(2) Oryctographie de B r u x e lle s , ou Description des fo s s ile s tant naturels qu’ a ccidentels, découverts
ju s q u ’ à ce jo u r dans les environs d e cette v ille , par François-Xavier Burtin. Bruxelles, 1784,
in -fo lio , avec ligures en couleur.