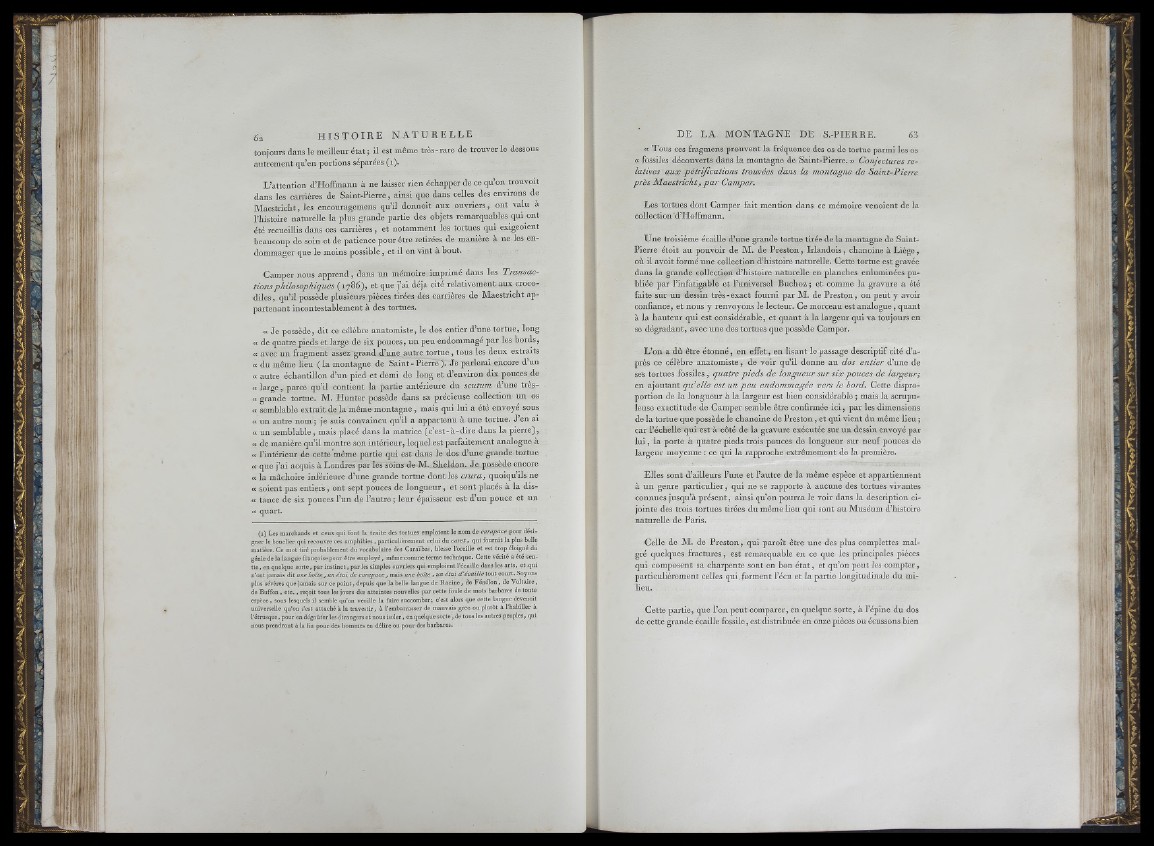
'’iü
IMi
toujours dans le meilleur état ; il est même très-rare de trouver le dessous
autrement qu’en portions séparées (i).
L ’attention d’Hoffmann à ne laisser rien échapper de ce qu’on trouvoit
dans les carrières de Saint-Pierre, ainsi que dans celles des environs de
Maestricht, les encouragemens qu’il donnoit aux ouvriers, ont valu à
l’histoire naturelle la plus grande partie des objets remarquables qui ont
été recueillis dans ces carrières, et notamment les tortues qui exigeoient
beaucoup de soin et de patience pour être retirées de manière à ne les endommager
que le moins possible, et il en vint à bout.
Camper nous apprend, dans un mémoire imprimé dans les Transactions
philosophiques (1786), et que j’ai déjà cité relativement aux crocodiles
, qu’il possède plusieurs pièces tirées des carrières de Maestricht appartenant
incontestablement à des tortues.
« Je possède, dit ce célèbre anatomiste, le dos entier d’une tortue, long
« de quatre pieds et large de six pouces, un peu endommagé par les bords,
« avec un fragment assez grand d’une autre tortue, tous les deux extraits
« du même lieu ( la montagne de Saint-Pierre). Je parierai encore d’un
« autre échantillon d’un pied et demi de long et d’environ dix pouces de
cc large, parce qu’il contient la partie antérieure du scutum d’une tres-
« grande tortue. M. Hunter possède dans sa précieuse collection un os
cc semblable extrait de la même montagne, mais qui lui a été envoyé sous
cc un autre nom ; je suis convaincu qu’il a appartenu à une tortue. J’en ai
« un semblable, mais placé dans la matrice (c’est-à-dire dans la pierre),
cc de manière qu’il montre son intérieur, lequel est parfaitement analogue à
cc l’intérieur de cette même partie qui est dans le dos d’une grande tortue
a que j’ai acquis à Londres par les soins de M. Sheldon. Je possède encore
« la mâchoire inférieure d’une grande tortue dont les crura, quoiqu’ils ne
cc soient pas entiers, ont sept pouces de longueur, et sont placés à la dis-
cc tance de six pouces l’un de l ’autre ; leur épaisseur est d’un pouce et un
« quart.
( i ) Les marcbaûcis et ceux qui font la tra ite des tortues emploient le nom de carapace pour désigner
le bouclier qui recouvre ces amphibies, particulièrement celui du ca re t, qui fournit la plus belle
matière. Ce mot tiré probablement du vocabulaire des Caraïbes, blesse l ’oreille et est trop éloigné du
génie de la langue françoise pour être employé, même comme terme technique. Cette vérité a été sent
ie , en quelque sorte, par instinct, par les simples ouvriers qui emploient l’é caille dans les arts, et qui
n’ont jamais dit une boîte , un étui de carapace, mais une boîte , un étui d ’ é caille XoMicaoti. Soyons
plus sévères que jamais sur ce point, depuis que la belle langiie de R a c in e , de Fénélon, de Vo ltaire ,
de Buffon , e t c . , reçoit tous les jours des atteintes nouvelles par cette foule de mots barbares de toute
espèce, sous lesquels il semble qu’on veuille la faire succomber; c’est alors que cette langue deveuoit
universelle qu’on s’est attaché à la travestir, à l’embarrasser de mauvais grec ou plutôt à l ’habiller à
l ’étrusque, pour en dégoûter les étrangers et nous isoler, en quelque sorte, de tous les autres peuples, qui
nous prendront à la fin pour des hommes en délire ou pour des barbares.
« Tous ces fragmens prouvent la fréquence des os de tortue parmi les os
« fossiles découverts dans la montagne de Saint-Pierre. » Conjectures relatives
aux pétrifications trouvées dans la montagne de Saint-Pierre
près Maestricht, par Camper.
Les tortues dont Camper fait mention dans ce mémoire venoient de la
collection d’Hoffmann.
Une troisième écaille d’une grande tortue tirée de la montagne de Saint-
Pierre étoit au pouvoir de M. de Preston, Irlandois, chanoine à Liège,
où il avoit formé une collection d’histoire naturelle. Cette tortue est gravée
dans la grande collection d’histoire naturelle en planches enluminées publiée
par l’infatigable et l’universel Buchoz ; et comme la gravure a été
faite sur un dessin très-exact fourni par M. de Preston, on peut y avoir
confiance, et nous y renvoyons le lecteur. Ce morceau est analogue, quant
à la hauteur qui est considérable, et quant à la largeur qui va toujours en
se dégradant, avec une des tortues que possède Camper.
L ’on a dû être étonné , en effet, en lisant le passage descriptif cité d’après
ce célèbre anatomiste, de voir qu’il donne au dos entier d’une de
se's tortues fossiles, quatre pieds de longueur sur six pouces de largeur^
en ajoutant qVelle est un peu endommagée vers le bord. Cette disproportion
de la longueur à la largeur est bien considérable ; mais la scrupuleuse
exactitude de Camper semble être confirmée ic i, par les dimensions
de la tortue que possède le chanoine de Preston, et qui vient du même lieu ;
car l’échelle qui est à côté de la gravure exécutée sur un dessin envoyé par
lu i, la porte à quatre pieds trois pouces de longueur sur neuf pouces de
largeur moyenne : ce qui la rapproche extrêmement de la première.
Elles sont d’ailleurs l’une et l’autre de la même espèce et appartiennent
à un genre particulier, qui ne se rapporte à aucune des tortues vivantes
connues jusqu’à présent, ainsi qu’on pourra le voir dans la description ci-
jointe des trois tortues tirées du même lieu qui sont au Muséum d’iiistoire
naturelle de Paris.
Celle de M. de Preston, qui paroît être une des plus complettes malgré
quelques fractures, est remarquable en ce que les principales pièces
qui composent sa charpente sont en bon état, et qu’on peut les compter,
particulièrement celles qui forment l’écu et la partie longitudinale du milieu.
Cette partie, que l’on peut comparer, en quelque sorte, à l’épine du dos
de cette grande écaille fossile, est distribuée en onze pièces ou écussons bien