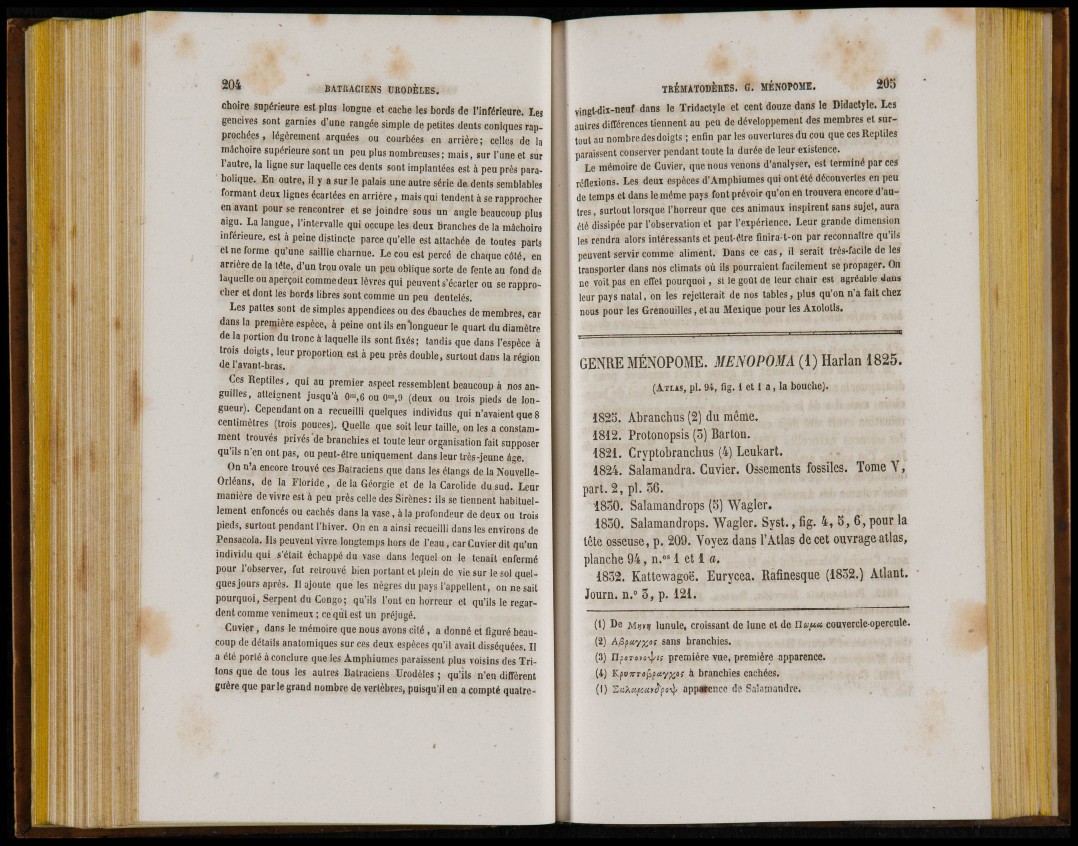
'L I I 'I
i l 1
2 0 4 BATRACIEîiS URODÈLES.
choire sap6rieure est plas longue et cache les bords de l'inférieure, les
gencives sont garnies d'une rangée simple de petites dents coniques rapprochées,
légèrement arquées ou courbées en arrière; celles de la
mâchoire supérieure sont un peu plus nombreuses; mais, sur l'une et sur
l'autre, la ligne sur laquelle ces dents sont implantées est à peu près parabolique.
En outre, il y a sur le palais une autre série da dents semblables
formant deux lignes écartées en arriére, mais qui tendent à se rapprocher
en avant pour se rencontrer et se joindre sous un angle beaucoup plus
aigu. La langue, l'intervalle qui occupe les deux branches de la mâchoire
inférieure, est à peine distincte parce qu'elle est attachée de toutes parts
et ne forme qu'une saillie charnue. Le cou est percé de chaque côté, en
arrière de la téle, d'un trou ovale un peu oblique sorte de fente au fond de
laquelle ou aperçoit commedeui lèvres qui peuvent s'écarter ou se rapprocher
et dont les bords libres sont comme un peu dentelés.
Les pattes sont de simples appendices ou des ébauches de membres, car
dans la première espèce, à peine ont ils en longueur le quart du diamètre
de la portion du tronc à laquelle ils sont fixés ; tandis que dans l'espèce à
trois doigts, leur proportion est à peu près double, surtout dans la région
de l'avant-bras.
Ces Reptiles, qui au premier aspect ressemblent beaucoup à nos anguilles,
atteignent jusqu'à 0%6 ou On-.O (deux ou trois pieds de longueur).
Cependant on a recueilli quelques individus qui n'avaient que 8
centimètres (trois pouces). Quelle que soit leur taille, on les a constamment
trouvés privés de branchies et toute leur organisation fait supposer
qu'ils n'en ont pas, ou peut-être uniquement dans leur très-jeune âge.
On n' a encore trouvé ces Batraciens que dans les étangs de la Nouvelle-
Orléans, de la Floride, de la Géorgie et de la Carolide du sud. Leur
manière de vivre est à peu près celle des Sirènes : ils se tiennent habituellement
enfoncés ou cachés dans la vase , à la profondeur de deux ou trois
pieds, surtout pendant l'hiver. On en a ainsi recueilli dans les environs de
Pensacola. Ils peuvent vivre longtemps hors de l'eau , car Cuvier dit qu'un
individu qui s'était échappé du vase dans lequel on le tenait enfermé
pour l'observer, fut retrouvé bien portant et plein de vie sur le sol quelques
jours après. II ajoute que les nègres du pays l'appellent, on ne sait
pourquoi, Serpent du Congo; qu'ils l'ont en horreur et qu'ils le regardent
comme venimeux ; ce qui est un préjugé.
Cuviçr, dans le mémoire que nous avons cité , a donné et figuré beaucoup
de détails anatomiques sur ces deux espèces qu'il avait disséquées. Il
a été porté à conclure que les Amphiuraes paraissent plus voisins des Tritons
que de tous les ûutrGS BtitrücÍ6ns Urodèlcs j Qu'ils n'en diffèront
guère que par le grand nombre de vertèbres, puisqu'il en a compté quatret
r é m à t o d è r e s . g. MÉNOPOME. 203
v i n g t - d i i - n e u f dans le Tridactyle et cent douze dans le Didactyle. Les
autres différences t iennent au peu de développement des membres et surt
o u t au nombre des doigts ; enfin par les ouvertures du cou que ces Reptiles
paraissent conserver pendant toute la durée de leur existence.
Le mémoire de Cuvier, que nous venons d'analyser, est terminé par ces
réflexions. Les deux espèces d'Amphiumes qui ont été découvertes en peu
de temps et dans le m ême pays font prévoir qu'on en trouvera encore d'autres
, surtout lorsque l'horreur que ces animaux inspirent sans sujet, aura
été dissipée par l'observation et par l'expérience. Leur grande dimension
les rendra alors intéressants et peut-être finira-t-on par reconnaître qu'ils
p e u v e n t servir comme aliment. Dans ce cas, il serait très-facile de les
transporter dans nos climats où ils pourraient facilement se propager. On
i ne voit pas en effet pourquoi , si le goût de leur chair est agréable dans
; leur pays natal, on les rejetterait de nos tables, plus qu'on n' a fait chez
i nous pour les Grenouilles, et au Mexique pour les Axolotls.
GENRE MÉNOPOME. MENOPOMA (1) Harlan 1825.
(ATLAS, pl. 94, fig. 1 et 1 a , la bouche).
1828. Abranchus (2) du même.
1812. Protonopsis (3) Barton.
1821. Cryptobranchus (4) Leukart.
1824. Salamandra. Cuvier. Ossements fossiles. Tome Y,
part. 2 , pl. 36.
1850. Salamandrops (5) Wagler.
1850. Salamandrops. Wagler. Syst., fig. 4, b, 6, pour la
tête osseuse, p. 209. Voyez dans l'Atlas de cet ouvrage atlas,
planche 94, n."' 1 et 1 a.
1832. Kattewagoë. Eurycea. Rafinesque (1852.) Atlant.
Journ. n.° 3, p. 121.
(1) De um lunule, croissant de lune et de nafta couyercle-opercule.
(2) sans branchies.
(3) nforoio^i ç première vue, première apparence.
(4) ICfU7rr<!j3(Jiiy;ii0f à branchies cachées.
(I) SsiAiitiiiy^^fsi}/ apparence de Salamandre.
) • ìli
ï • Í ,