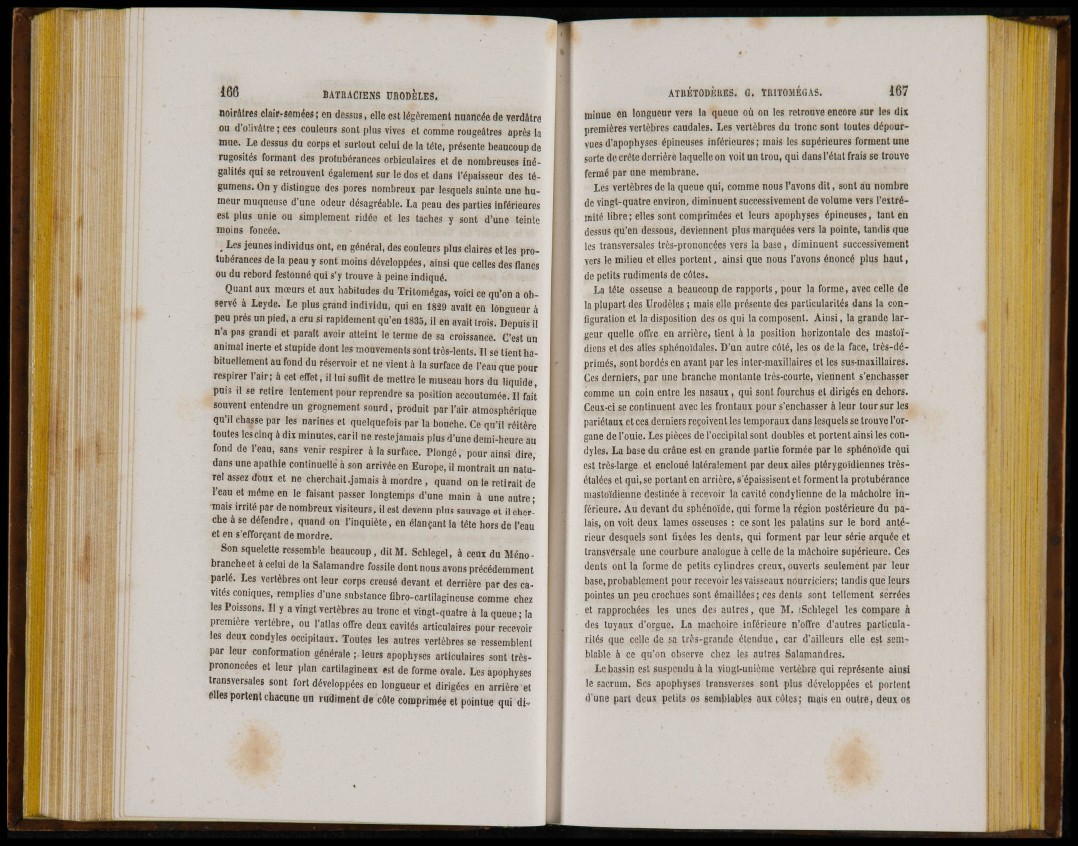
n t' ^ '
1 6 6 BATRACIENS UBODÈLES.
noirâtres clair-semées; en dessus, elle est légèrement nuancée de verdâire
ou d'olivâtre ; ces couleurs sont plus vives et comme rougeâtres après la
mue. Le dessus du corps et surtout celui de la téte, présente beaucoup de
rugosités formant des protubérances orbiculaires et de nombreuses inégalités
qui se retrouvent également sur le dos et dans l'épaisseur des tégumens.
On y distingue des pores nombreux par lesquels suinte une humeur
muqueuse d'une odeur désagréable. La peau des parties inférieures
est plus unie ou simplement ridée et les taches y sont d'une teinte
moins foncée.
, Les jeunes individus ont, en général, des couleurs plus claires et les protubérances
de la peau y sont moins développées, ainsi que celles des flancs
ou du rebord festonné qui s'y trouve à peine indiqué.
Quant aux moeurs et aux habitudes du Tritomégas, voici ce qu'on a observé
à Leyde. Le plus grand individu, qui en 1829 avait en longueur à
peu prés un pied, a cru si rapidement qu'en 1835, il en avait trois. Depuis il
n'a pas grandi et paraît avoir atteint le terme de sa croissance. C'est un
animal inerte et stupide dont les mouvements sont très-lents. Il se tient habituellement
au fond du réservoir et ne vient à la surface de l'eau que pour
respirer l'air; à cet elîet, il lui suffit de mettre le museau hors du liquide,
puis il se relire lentement pour reprendre sa position accoutumée. II fait
souvent entendre un grognement sourd, produit par l'air atmosphérique
qu'il chasse par les narines et quelquefois par la bouche. Ce qu'il réitère
toutes les cinq à dix minutes, caril ne restejamais plus d'une demi-heure au
fond de l'eau, sans venir respirer à la surface. Plongé, pour ainsi dire,
dans une apathie continuelle à son arrivée en Europe, il montrai t un naturel
assez doux et ne cherchait .jamais à mordre , quand on le retirait de
l'eau et même en le faisant passer longtemps d'une main à une autre ;
mais irrité par de nombreux visiteurs, il est devenu plus sauvage et il cherche
à se défendre, quand on l'inquiète, en élançant la téte hors de l'eau
et en s'efforçant de mordre.
Son squelette ressemble beaucoup, dit M. Schlegel, à ceux du Ménobrancheet
àcelui de la Salamandre fossile dont nous avons précédemment
parlé. Les vertèbres ont leur corps creusé devant et derrière par des cavités
coniques, remplies d'une substance iibro-cartilagineuse comme chez
les Poissons. Il y a vingt vertèbres au tronc et vingt-quatre à la queue ; la
première vertèbre, ou l'atlas offre deux cavités articulaires pour recevoir
les deux condyles occipitaux. Toutes les autres vertèbres se ressemblent
par leur conformation générale ¡ leurs apophyses articulaires sont trèsprononcées
et leur plan cartilagineux est de forme ovale. Les apophyses
transversales sont fort développées en longueur et dirigées en arrière et
elles portent chacune un rudiment de côte comprimée et pointue qui djv
ATUÉTODKUES. G. TIlIïOllÉGAS. 16 7
minue en longueur vers la queue où on les retrouve encore sur les dix
premières vertèbres caudales. Les vertèbres du tronc sont toutes dépourvues
d'apophyses épineuses inférieures ; mais les supérieures forment une
sorte de crête derrière laquelle on voit un trou, qui dans l'état frais se trouve
fermé par une membrane.
Les vertèbres de la queue qui, comme nous l'avons di t , sont au nombre
de vingt-quatre environ, diminuent successivement de volume vers l'extré-
¡ïiité libre; elles sont comprimées et leurs apophyses épineuses, tant en
dessus qu'en dessous, deviennent plus marquées vers la pointe, tandis que
les transversales très-prononcées vers la base, diminuent successivement
vers le milieu et elles portent , ainsi que nous l'avons énoncé plus haut,
de petits rudiments de côtes.
La téte osseuse a beaucoup de rapports, pour la forme, avec celle de
la plupart des Urodèles ; mais elle présente des particularités dans la configuration
et la disposition des os qui la composent . Ainsi, la grande largeur
quelle ofiVe en arrière, tient à la position horizontale des mastoïdiens
et des atles sphénoïdales. D'un autre côté, les os de la face, très-déprimés,
sont bordés en avant par les inter-maxillaires et les sus-maxillaires.
Ces derniers, par une branche montante très-courte, viennent s'enchâsser
comme un coin entre les nasaux , qui sont fourchus et dirigés en dehors.
Ceux-ci se continuent avec les frontaux pour s'enchâsser à leur tour sur les
pariétaux et ces derniers reçoivent les temporaux dans lesquels se trouve l'organe
de l'ouie. Les pièces de l'occipital sont doubles et portent ainsi les condyles.
La base du crâne est en grande partie formée par le sphénoïde qui
est très-large et encloué latéralement par deux ailes ptérygoïdiennes trèsétalées
et qui, se portant en arrière, s épaissisent et forment la protubérance
mastoïdienne destinée à recevoir la cavité condylienne de la mâchoire inférieure.
Au devant du sphénoïde, qui forme la région postérieure du palais,
on voit deux lames osseuses : ce sont les palatins sur le bord antérieur
desquels sont fixées les dénis, qui forment par leur série arquée et
transversale une courbure analogue à celle de la mâchoire supérieure. Ces
dents ont la forme de petits cylindres creux, ouverts seulement par leur
base, p robablement pour recevoir les vaisseaux nourriciers; tandis que leurs
pointes un peu crochues sont émaillées; ces dents sont tellement serrées
et rapprochées les unes des autres, que M. iSchlegel les compare à
des tuyaux d'orgue. La mâchoire inférieure n'offre d'autres particularilés
que celle de sa très-grande étendue, car d'ailleurs elle est semblable
à ce qu'on observe chez les autres Salamandres.
Le bassin est suspendu à la vingt-unième vertèbre qui représente ainsi
le sacrum. Ses apophyses transverses sont plus développées et portent
d'une part deux petits os semblables aux côtes; mais eu outre, deux os
;
ivJ(i
: i ^ ; fil
l i i i l
t,
I . • •
l l
i !
L
ïi