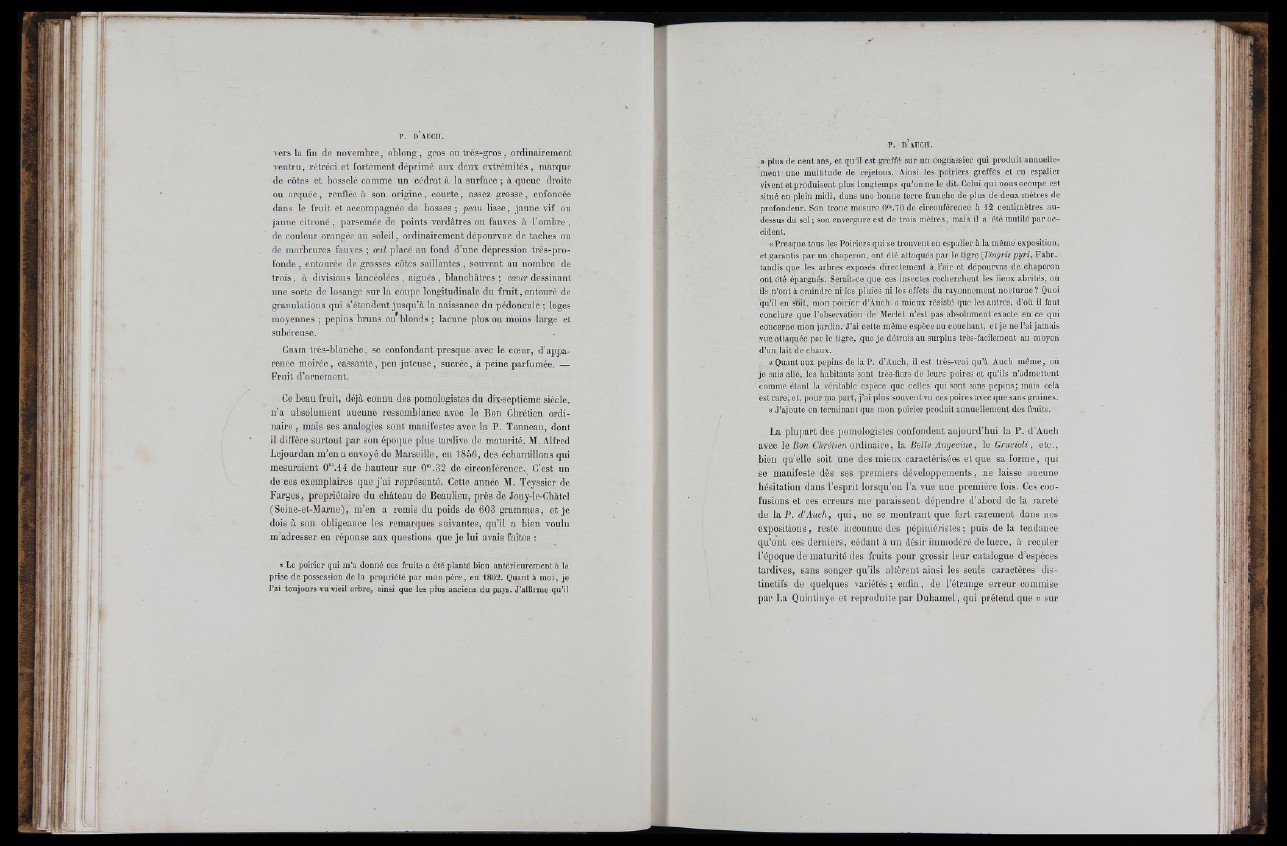
I
p . D A U C H .
vers la fin de novembre, oblong , gros ou très-gros, ordinairement
ventru, rétréci et fortement déprimé aux deux extrémités , marqué
de côtes et bosselé comme un cédrat à la surface ; à queue droite
ou iirquée, renflée à son origine, courte, assez grosse, enfoncée
dans le fruit et accompagnée de bosses ; peau lisse, jaune vif ou
jaune citroné , parsemée de points verdâtres ou fauves à l ’ombre ,
«le couleur orangée au soleil, ordinairement dépourvue de taches ou
de marbrures fauves ; oeil placé au fond d’une dépression très-profonde,
entourée de grosses côtes saillantes, souvent au nombre de
trois, à divisions lancéolées, aiguës, blanchâtres; coeur dessinant
une sorte de losange sur la coupe longitudinale du fruit, entouré de
granulations qui s’étendent jusqu’à la naissance du pédoncule ; loges
moyennes ; pépins bruns ou blonds ; lacune plus ou moins large et
subéreuse.
Chair très-blanche, se confondant presque avec le coeur, d’apparence
moirée, cassante, peu juteuse, sucrée, à peine parfumée. —
Fruit d’ornement.
Ce beau fruit, déjà connu des pomologistes du dix-septième siècle,
n’a absolument aucune ressemblance avec le Bon Chrétien ordinaire,
mais ses analogies sont manifestes avec la P. Tonneau, dont
il diffère surtout par son époque plus tardive de maturité. M. Alfred
Lejourdan m’en a envoyé de Marseille, en 1856, des échantillons qui
mesuraient 0“M4 de hauteur sur 0“ .32 de circonférence. C’est un
de ces exemplaires que j’ai représenté. Cette année M. Teyssier de
Farges, propriétaire du château de Beaulieu, près de Jouy-le-Châtel
(Seine-et-Marne), m’en a remis du poids de 603 grammes, et je
dois à son obligeance les remarques suivantes, qu’il a bien voulu
m’adresser en réponse aux questions que je lui avais faites :
« Le p o irie r qui m ’a donné ces fru its a été p lan té bien a n té rie u rem e n t à la
p rise de possession de la p ro p rié té p a r mon p è r e , en 1802. Quant à m o i, je
l'a i to u jo u rs vu vieil a rb re , ainsi q u e les plus anciens d u pays. J ’affirme q u ’il
i!
a plus de c e n t ans, e t q u ’il e st greffé su r un cogna ssie r qui p ro d u it annue llem
e n t une m u ltitu d e de re je tons. Ainsi les p o iriers greffés e t en espa lie r
vivent et p ro d u is e n t plus longtemps q u ’on n e le dit. Celui qui n ous o ccu p e est
situé en plein m id i, d an s u n e bonne te rr e fran ch e d e plus de deux m è tre s de
pro fo n d eu r. Son tronc m e su re 0“ .70 d e circonfé renc e à 12 ce n tim è tre s a u -
dessus du sol ; son enve rgure est de trois m è tre s , mais il a été mutilé p a r accident.
« P resque tous les Po irie rs qui se tro u v en t en e sp a lie r à la môme exposition,
e t garantis p a r un ch ap ero n , o n t é té attaq u é s p a r le tig re {Tingris p y r i, F a b r.
tandis que les a rb re s exposés d ire c tem en t à Fair e t d épourvus d e ch a p ero n
o n t é té épa rgnés. S erait-ce q u e ces in secte s re c h e rc h e n t les lieux ab rité s , où
ils n ’o n t à c rain d re ni les p lu ie s ni lés effets d u ra y onnement n o c tu rn e ? Quoi
q u ’il en sbit, mon p o irie r d ’Auch a m ieux ré s is té que les au tre s , d ’où il faut
conc lure q u e l’observation d e Merlet n ’est pas ab so lum en t exacte en ce qui
co n c e rn e mon ja rd in . J ’ai c e lte même espèce au co u c h an t, e t je ne l’ai jam ais
vue a lla q u é e p a r le tigre, que j e d étru is au su rp lu s très-facilement au moyen
d 'u n lait de chaux.
a Quant aux pép in s de la P. d ’Auch, il est très-vrai q u ’à Auch m êm e , où
je suis allé, les h abitants so n t très-fiers de leu rs poires e t q u ’ils n ’adm e tte n t
comme é ta n t la véritable espèce que celles qui sont sans p é p in s ; mais cela
est ra re , e t, p o u r m a p a rt, j ’ai plus souvent vu ces po ires avec que sans g ra in e s.
« J ’a jo u te en te rm in an t q u e mon p o irie r p ro d u it an n u e llem en t d e s fruits.
La plupart des pomologistes confondent aujourd’hui la P. d’Auch
avec le Bon Chrétien ordinaire, la Belle Angevine, le Gracioli, etc.,
bien qu’elle soit une des mieux caractériséos et que sa forme, qui
se manifeste dès ses premiers développements, ne laisse aucune
hésitation dans l ’esprit lorsqu’on l ’a vue une première fois. Ces confusions
et ces erreurs me paraissent dépendre d’abord de la rareté
de la P. d’Auch, qui, ne se montrant que fort rarement dans nos
expositions, reste inconnue des pépiniéristes; puis d e là tendance
qu’ont ces derniers, cédant à un désir immodéré de lucre, à reculer
l’époque de maturité des fruits pour grossir leur catalogue d’espèces
tardives, sans songer qu’ils altèrent ainsi les seuls caractères distinctifs
de quelques variétés; enfin, de l’étrange erreur commise
par La Quintinye et reproduite par Duhamel, qui prétend que « sur
' f
j . : :