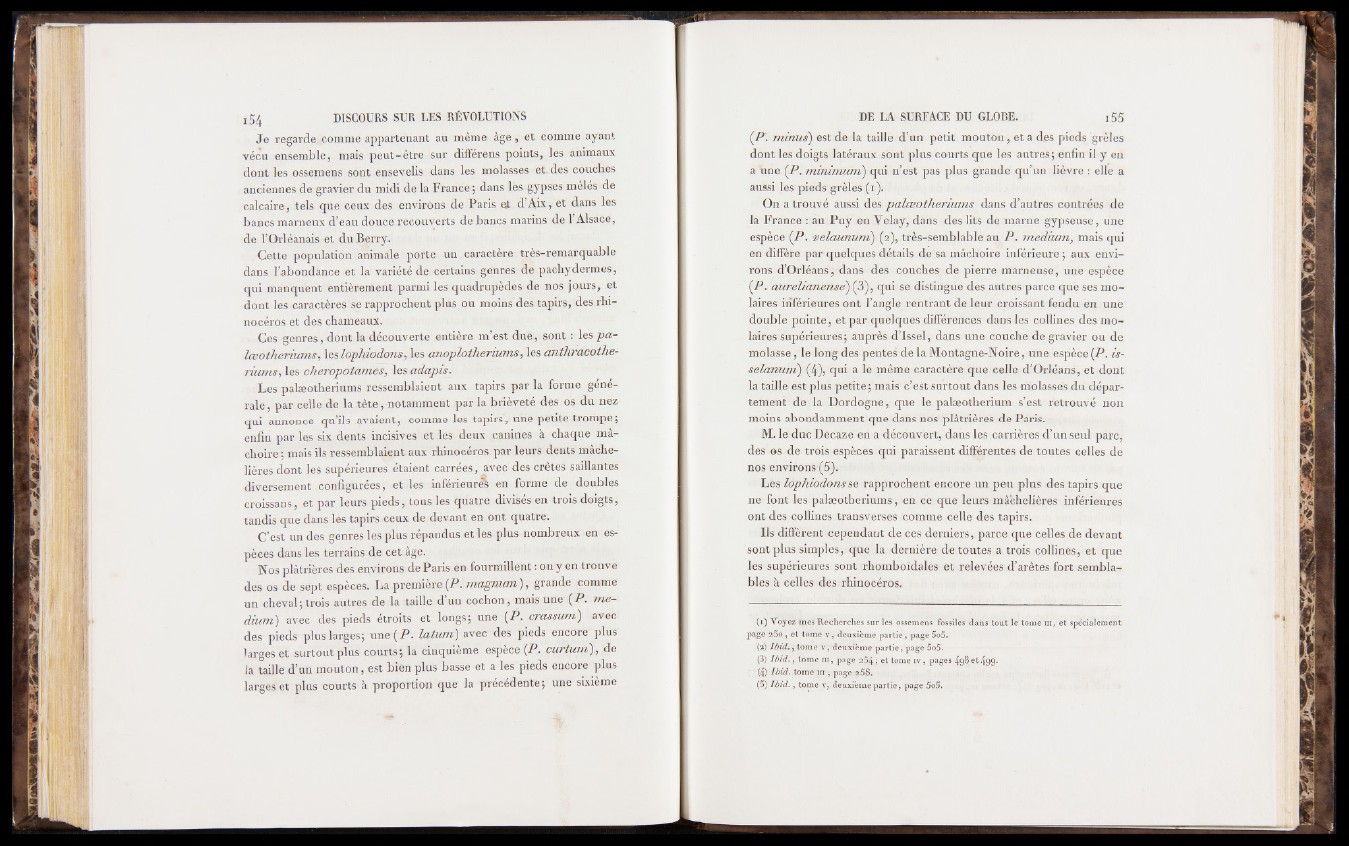
Je regarde comme appartenant au même âge, et comme ayant
vécu ensemble, mais peut-être sur différens points, les animaux
dont les ossemens sont ensevelis dans les molasses et. des couches
anciennes de gravier du midi de la France ; dans les gypses meles de
calcaire, tels que ceux des environs de Paris et d’Aix, et dans les
bancs marneux d’eau douce recouverts de bancs marins de l’Alsace,
de l’Orléanais et du Berry.
Cette population animale porte un caractère très-remarquable
dans l’abondance et la variété de certains genres de pachydermes,
qui manquent entièrement parmi les quadrupèdes de nos jours, et
dont les caractères se rapprochent plus ou moins des tapirs, des rhinocéros
et des chameaux.
Ces genres, dont la découverte entière m’est due, sont : les pa-
loeotheriums, les lophiodo?is, les anoplotheriums, les anthracothe-
riums, les cheropotames, les adapis.
Les palæotheriums ressemblaient aux tapirs par la forme générale,
par celle de la tête, notamment par la brievete des os du nez
qui annonce qu’ils avaient, comme les tapirs', une petite trompe;
enfin par les six dents incisives et les deux canines à chaque mâchoire
; mais ils ressemblaient aux rhinocéros par leurs dents mâche-
hères dont les supérieures étaient carrées, avec des crêtes saillantes
diversement configurées, et les inférieur® en forme de doubles
croissans, et par leurs pieds, tous les quatre divisés en trois doigts,
tandis que dans les tapirs ceux de devant en ont quatre.
C’est un des genres les plus répandus et les plus nombreux en espèces
dans les terrains de cet âge.
Nos plâtrières des environs de Paris en fourmillent : ony en trouve
des os de sept espèces. La première (P . magnum,'), grande comme
un cheval; trois autres de la taille d uu cochon, mais une (P. medium)
avec des pieds étroits et longs; une (P . crassum) avec
des pieds plus larges; une (P . latum) avec des pieds encore plus
larges et surtout plus courts; la cinquième espèce (P. curtum), de
la taille d’un mouton, est bien plus basse et a les pieds encore plus
larges et plus courts à proportion que la précédente; une sixième
(Pi minus) est de la taille d’un petit mouton, et a des pieds grêles
dont les doigts latéraux sont plus courts que les autres; enfin il y en
a une (P. minimum) qui n’est pas plus grande qu’un lièvre : elle a
aussi les pieds grêles ( rrjjdn
On a trouvé aussi des palæotheriums dans d’autres contrées de
la France : au Puy en Yelay, dans des lits de marne gypseuse, une
espèce (P. velaununi) (2), très-semblable au P . medium, mais qui
en diffère par quelques détails de sa mâchoire inférieure ; aux environs
d’Orléans, dans des couches de pierre marneuse, une espèce
(P. aurelianense) (3); qui se distingue des autres parce que ses molaires
inférieures ont l’angle rentrant de leur croissant fendu en une
double pointe, et par quelques différences dans les collines des molaires
supérieures; auprès d’Issel, dans une couche de gravier ou de
molasse, le long des pentes de la Montagne-Noire, une espèce (P. is-
selanurri) (4), qui a le même caractère que celle d’Orléans, et dont
la taille est plus petite; mais c’est surtout dans les molasses du département
de la Dordogne, que le palæotherium s’est retrouvé non
moins abondamment que dans nos plâtrières de Paris.
M. le duc Décaze en a découvert, dans les carrières d’un seul parc,
des as de trois espèces qui paraissent différentes de toutes celles de
nos environs-(S).
Les lophiodons se rapprochent encore un peu plus des tapirs que
ne font les palæotheriums, en ce que leurs mâchelières inférieures
ont des collines transverses comme celle des tapirs.
Us diffèrent cependant de ces derniers, parce que celles de devant
sont plus simples, que la dernière de toutes a trois collines, et que
les supérieures sont rhomboïdales et relevées d’arêtes fort semblables
à celles des rhinocéros. 1
(1) Voyez mes Recherches sur les ossemens fossiles dans tout le tome ni, et spécialement
page a5o , et tome v , deuxième partie, page 5o5.
(a) Ibid. , tome y , deuxième partie, pagé 5o5.
(3) Ibid., tome ni, page 254 ; et tome iv , pages 498 e t499*
(4) Ibid, tome m , page 258.
(5) Ibid. , tome v, deuxième partie, page 5o5.