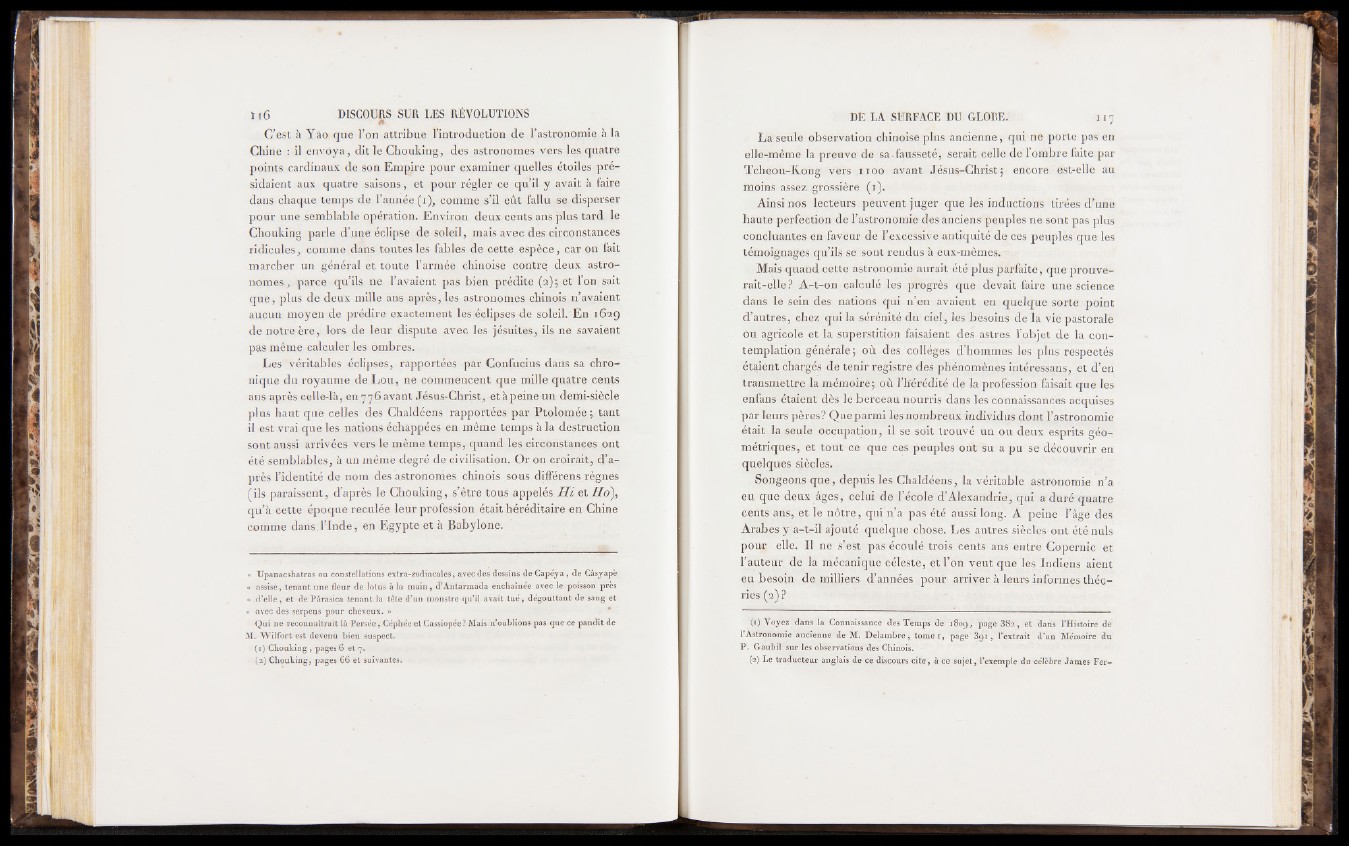
C’est à Yâo que l’on attribue l’introduction de l’astronomie k la
Chine : il envoya, dit le Chouking, des astronomes vers les quatre
points cardinaux de son Empire pour examiner quelles étoiles présidaient
aux quatre saisons, et pour régler ce qu’il y avait à faire
dans chaque temps de l’année (i), comme s’il eût fallu se disperser
pour une semblable opération. Environ deux cents ans plus tard le
Chouking parle d’une éclipse de soleil, mais avec des circonstances
ridicules, comme dans toutes les fables de cette espèce, car on fait
marcher un général et toute l’armée chinoise contre deux astronomes,
parce qu’ils ne l’avaient pas bien prédite (2) ; et l’on sait
que, plus de deux mille ans après, les astronomes chinois n’avaient
aucun moyen de prédire exactement les éclipses de soleil. En 1629
de notre ère, lors de leur dispute avec les jésuites, ils ne savaient
pas même calculer les ombres.
Les véritables éclipses, rapportées par Confucius dans sa chronique
du royaume de Lou, ne commencent que mille quatre cents
ans après celle-là, en 776avant Jésus-Christ, etàpeine un demi-siècle
plus haut que celles des Chaldéens rapportées par Ptolomée ; tant
il est vrai que les nations échappées en même temps à la destruction
sont aussi arrivées vers le même temps , quand les circonstances ont
été semblables, à un même degré de civilisation. Or on croirait, d’après
l’identité de nom des astronomes chinois sous différens règnes
(ils paraissent, d’après le Chouking, s’être tous appelés H t et Ho),
qu’à cette époque reculée leur profession était héréditaire en Chine
comme dans l’Inde, en Egypte et à Babylone.
« Upanacshatras ou constellations extra-zodiacales, avec des dessins de Capéya, de Câsyapè
« assise, tenant une fleur de lotus à la main, d’Àntarmada enchaînée avec le poisson près
«. d’elle, et de Pârasica tenant la tête d’un monstre qu’il avait tué, dégouttant de sang et
« avec des serpens pour cheveux. »
Qui ne reconnaîtrait là Persée, Céphée et Cassiopée? Mais n’oublions pas que ce pandit de
M. Wilfort est devenu bien suspect.
(1) Chouking, pages 6 et 7.
(2) Chouking, pages 66 et suivantes.
La seule observation chinoise plus ancienne, qui ne porte pas en
elle-même la preuve de sa-fausseté, serait celle de l’ombre faite par
Tcheou-Kong vers 1100 avant Jésus-Christ; encore est-elle au
moins assez grossière (i).
Ainsi nos lecteurs peuvent juger que les inductions tirées d’une
haute perfection de l’astronomie des anciens peuples ne sont pas plus
concluantes en faveur de l’excessive antiquité de ces peuples que les
témoignages qu’ils se sont rendus à eux-mêmescf-'y
Mais quand cette astronomie aurait été plus parfaite, que prouverait
elle? A-t-on calculé les progrès que devait faire une science
dans le sein des nations qui n’en avaient en quelque sorte point
d’autres, chez qui la sérénité du ciel, les besoins de la vie pastorale
ou agricole et la superstition faisaient des astres l’objet de la contemplation
générale; où des collèges d’hommes les plus respectés
étaient chargés de tenir registre des phénomènes intéressans, et d’en
transmettre la mémoire; où l’hérédité de la profession faisait que les
enfans étaient dès le berceau nourris dans les connaissances acquises
par leurs pères? Que parmi les nombreux individus dont l’astronomie
était la seule occupation, il se soit trouvé un ou deux esprits géométriques,
et tout ce que ces peuples ont su a pu se découvrir en
quelques siècles.
Songeons que, depuis les Chaldéens, la véritable astronomie n’a
eu que deux âges, celui de l’école d’Alexandrie, qui a duré quatre
cents ans, et le nôtre, qui n’a pas été aussi long. A peine l’âge des
Arabes y a-t—il ajouté quelque chose. Les autres siècles ont été nuis
pour elle. Il ne s’est pas écoulé trois cents ans entre Copernic et
l’auteur de la mécanique céleste, et l’on veut que les Indiens aient
eu besoin de milliers d’années pour arriver à leurs informes théories
(2)? *1
( 0 Voyez dans la Connaissance des Temps de 1 8 0 9 , page 3 8 a , et dans l’Histoire de
1 Astronomie ancienne de M. Delambre, tomeï, page 3 g i , l’extrait d’un Mémoire du
P. Gaubil sur les observations des Chinois.
(2) Le traducteur anglais de ce discours cite, à ce sujet, l’exemple du célèbre James Fer