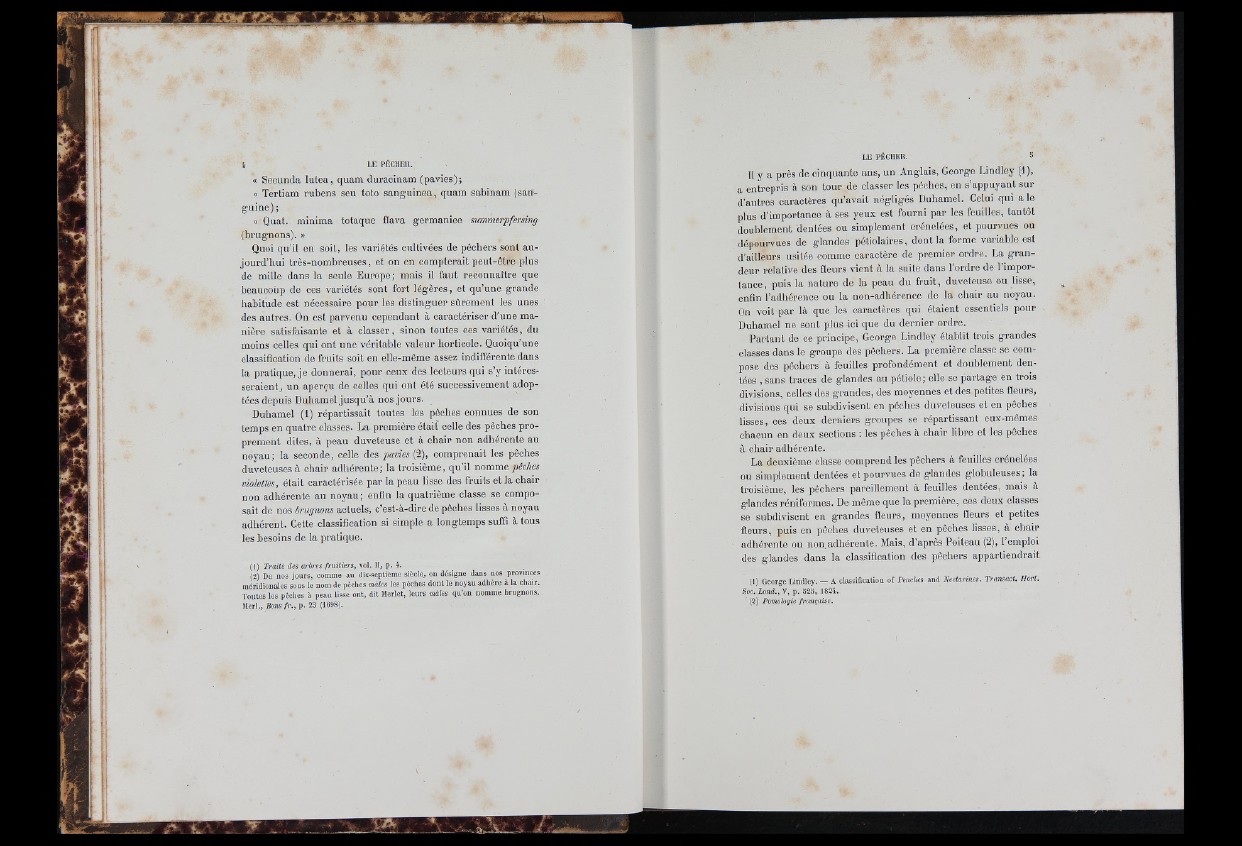
f *1
* LE PÉCHER.
tu Seounda lu te a , quam duracinam (p a v ie s);
0 Tertiam rubens seu loto sa n g u in e a , quam sabinam (saiï-
g u in e ) ;
Il Quat. minima totaque flava germanice summerpfersing
(b ru gnon s). »
Quoi q u ’il en so it, les variétés cu ltiv ées de pêchers sont aujou
rd ’hui tr ès-n om b reu ses, et on en compterait peut-être plus
de m ille dans la seule Europe; mais il faut reconnaître que
beaucoup de ce s variétés sont fort lé g è r e s , et q u ’une grande
habitude est néce ssair e pour le s d istin gu e r sûr ement les unes
des autres. On est parvenu cependant à caractériser d'une manièr
e satisfaisante et à c la ss e r , sinon toutes ces v a r ié té s, du
moins celles qui ont u n e véritable valeur horticole. Quoiqu’une
classification de fruits soit en e lle-mêm e assez indifférente dans
la pratique, j e donnerai, pour ceux des lecteurs qui s ’y intéresse
ra ien t, u n aperçu de c e lles qui ont été suc cessiv em en t adoptées
depuis Duhamel ju sq u ’à nos jours.
Duhamel (1) répartissait toutes le s pêches connues de son
temps en quatre classes. La première était celle des pêches proprement
d ites, à peau duve teuse e t à chair non adhérente au
noyau; la seconde, ce lle des pavies (2), comprenait le s pêches
duveteuses à chair adhérente; la tro isièm e , q u ’il nomme p k h e s
violettes, était caractérisée par la peau lisse des fruits et la chair
non adhérente au noyau; enfin la quatrième classe se composait
de nos brugnons actuels, c ’est-à-dire de pêches lisses à noyau
adhérent. Cette classification si simple a lon g tem p s suffi à tous
le s besoins de la pratique.
(1) Traité des arbres fruitiers, vol. H, p. 4.
(2) De nos jours, comme au dix-septième siècle, on désigne dans nos provinces
méridionales sous le nom de pèches mâles les pêches dont le noyau adhère à la chair.
Toutes les pêches à pean lisse ont, dit Merlet, leurs mâles qu’on nomme brugnons.
Meri., ions fr ., p. 23 (1098).
Il y a près de cinquante ans, un Anglais, George Lindley () ),
a entrepris à son tour de classer les p êches, en s ’appuyant sur
d’autres caractères qu’avait n é g lig é s Duhamel. Celui q ui a i e
plus d’importance à ses y eu x est fourni par le s feuilles, tantôt
doublement dentées ou simplement c r én e lé e s, et pourvues ou
dépourvues de g lan d e s p étio la ire s, dont la forme variable est
d’ailleurs usitée comme caractère de premier ordre. La g ra n deur
relative des fleurs v ient à la suite dans l’ordre de l ’importan
ce, puis la nature de la peau du fruit, duve teuse ou lisse,
enfin l ’adhérence ou la non-adhérence de la chair au noyau.
On voit par là que le s caractères qui étaient essentiels pour
Duhamel ne sont plus ici que du dernier ordre.
Partant de ce principe. George Lindley établit trois grandes
classes dans le groupe des pêchers. La première classe se compose
des pêchers à feu illes profondément e t doublement dentées
, sans traces de g lan d e s au pétiole; e lle se pa rta g e en trois
divisions, ce lles des g ran d es, des moyennes et des petites fleurs,
divisions qui se subdivisent en pêches duveteuses et en pêches
liss e s , ces deux derniers groupes se répartissant eux-mêmes
chacun en deux sections : les pêches à chair libre et le s pêches
à chair adhérente.
La deux ième classe comprend les pêchers à feu illes crénelées
ou simplement dentées et pourvues de g lan d es g lob u leu se s; la
troisième, le s pêchers pareillement à feuilles dentées, ma is à
g lan d es réniformes. De même que la première, ces deux classes
se subdivisent eu g ran d es fleur s, m o y en n es fleurs et petites
fleur s, puis en pêches duveteuses et en pêches liss e s , à chair
adhérente ou non.adhérente. Mais, d’après Poiteau (2), l ’emploi
des g’iandes dans la classification des pêchers appartiendrait
(1) George Lindley. — A classification ot teaches and Nectarines. Transact. liort.
Soc. Land., V, p. 52b, 1824.
(2) Pomologic française.
l! !
91