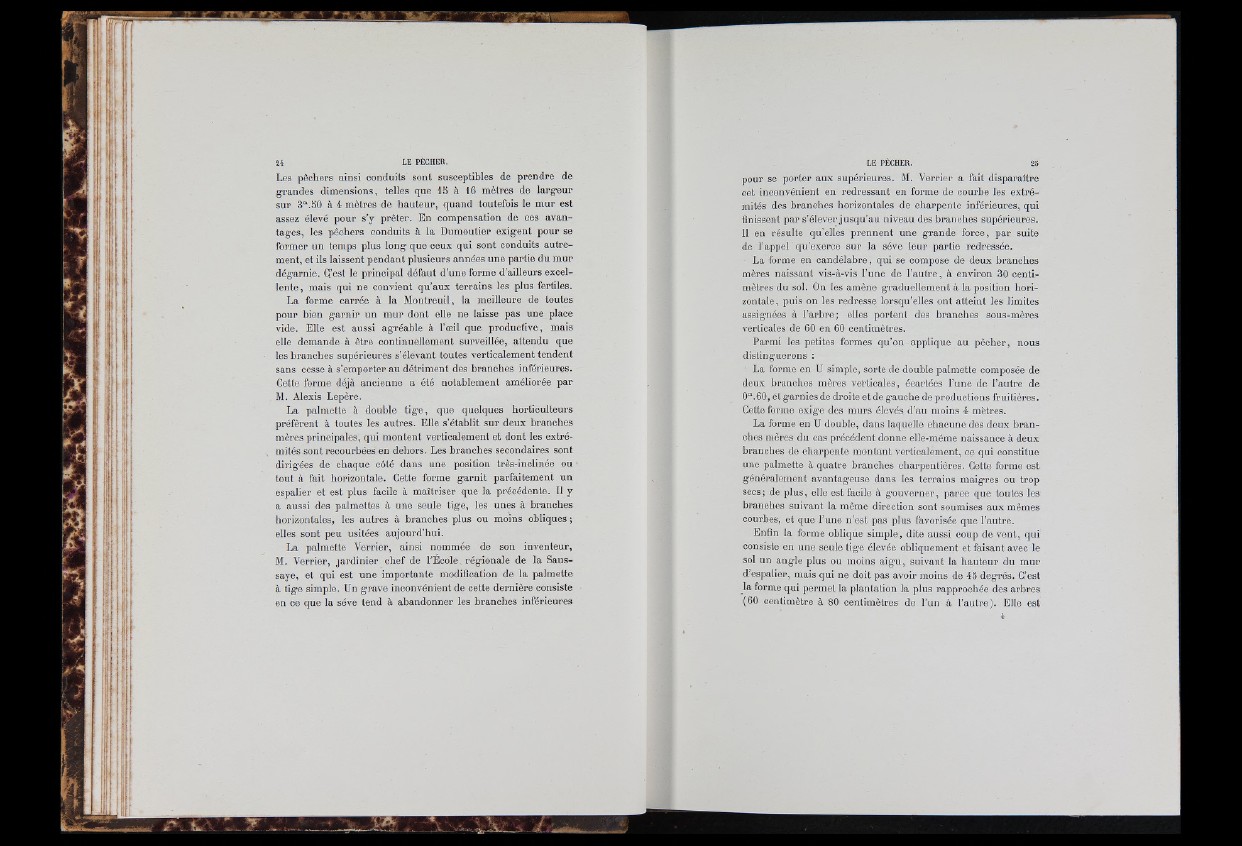
Les pêchers ainsi conduits sont susceptibles de prendre de
g'randes d im en sion s, telles que 15 à 16 mètres de largeur
sur 3 “ .50 à 4 mètres de hauteur, quand toutefois le mur est
assez é lev é pour s'y prêter. En compensation de ce s av an ta
g e s , le s pêchers conduits à la Dumoutier ex ig en t pour se
former un temps plus lo n g que c eux qui sont conduits autrement,
et ils laissent pendant plusieurs anné es une partie du mur
dégarnie . C’est le principal défaut d’une forme d’ailleurs ex c e lle
n te , mais qui n e convient q u ’aux terrains les plus fertiles.
La forme carrée à la Montreuil, la meilleur e de toutes
pour bien g a rn ir un mur dont e lle ne laisse pas une place
v ide. Elle est au ssi a g réable à Tceil que produc tiv e, mais
elle demande à être continuellement surveillée , attendu que
le s branches supérieures s ’élevant toutes v er ticalement tendent
sans ce sse à s’emporter au détriment des branches inférieures.
Cette forme déjà an cienn e a été notablement améliorée par
M. Alexis Lepère.
La palmette à double t ig e , que quelques horticulteurs
préfèrent à toutes le s autres. Elle s ’établit sur deux branches
mère s principales, qui montent verticalement et dont le s ex tr é mité
s sont recourbées en dehors. Les branches secondaires sont
d ir ig é e s de chaque côté dans une position très-inclinée ou
tout à fait horizontale. Cette forme g a rn it parfaitement un
espalier et est plus facile à maîtriser que la précédente. II y
a aussi des palmettes à une seu le tig e , le s une s à branches
horizontales, le s autres à branches plus ou moins obliques ;
elles sont peu usitées aujourd’hui.
La palmette Verrier, a insi nommée de son inventeur,
M. Verrier, ja rd in ie r c h e f de l'École r ég io n a le de la Saus-
saye, et qui est u ne importante modification de la palmette
à tig e simple. Un g ra v e in con v én ient de cette dernière consiste
en ce que la séve tend à abandonner les branches inférieures
pour se porter au x supérieures. M. Verrier a fait disparaître
cet inconv énient en redressant en forme de courbe les ex trémités
des branches horizontales de charpente inférieures, qui
finissent par s ’élever ju sq u ’au niveau des branches supérieures.
11 en ré sulte q u e lle s prennent une grande fo r c e , par suite
de l ’appel qu’exerce sur la séve leur partie redressée.
La forme en candélabre , qui se compose de deux branches
mères naissant vis-à -v is l ’une de l ’au tr e , à environ 30 c en timètres
du sol. On les amène g raduellement à la position horizontale,
puis on le s redresse lor squ’elles ont atteint le s limites
a ssign é e s à l ’arbre; elles portent des branches sous-mères
verticales de 60 en 60 centimètres.
Parmi les petites formes q u ’on applique au p ê ch e r , nous
distinguerons :
La forme en U simple, sorte de double palmette composée de
deux branches mère s ve r tica le s, écartées l ’une de l ’autre de
0 “.60, et g a rn ie s de droite et de g au ch e de p roductions fruitières.
Cette forme e x ig e des murs élevés d ’au moins 4 mètres.
La forme en U double, dans laquelle chacune des deux branches
mères du cas précédent donne elle-même naissance à deux
branches de charpente montant verticalement, ce qui constitue
une palmette à quatre branches charpenlières. Cette forme est
g én éra lem en t avanta g euse dans le s terrains m a ig r e s ou trop
secs; de p lu s, e lle est facile à g ou v e rn e r , parce que toutes les
branches suivant la même direction sont soum ise s au x mêmes
courbes, et que l ’une n ’est pas plus favorisée que l ’autre.
Enfin la forme oblique s im p le , dite aussi coup de v en t, qui
consiste en u ne seu le tig e élevée obliquement et faisant avec le
sol un a n g le plus ou moins a ig u , suivant la hauteur du mur
d’espalier, mais qui ne doit pas avoir moins de 45 d eg r é s. C’est
la forme qui permet la plantation la plus rapprochée des arbres
(60 centimètre à 80 centimètres de l’un à l ’au tr e ). Elle est
4