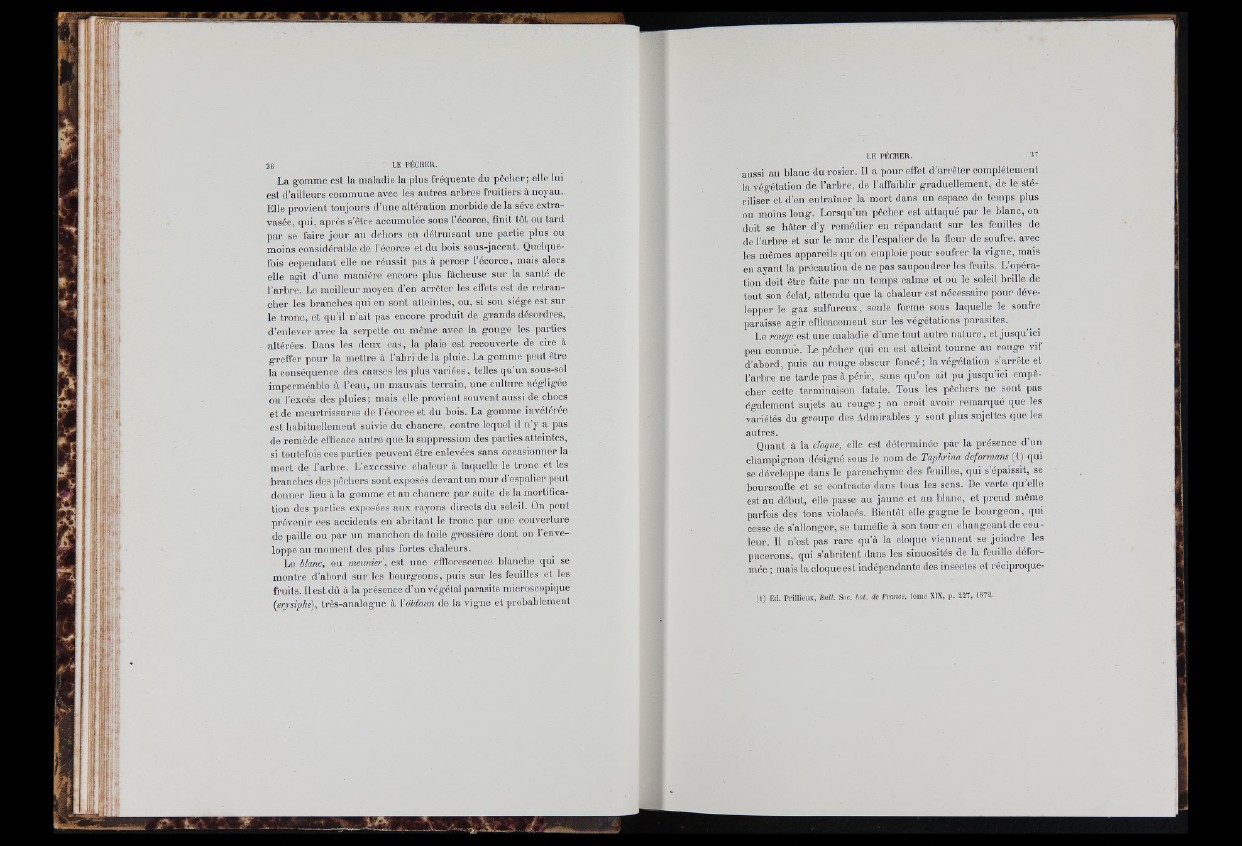
La gom me est la maladie la plus fréquente du pêcher; elle lui
est d’ailleurs commune avec les autres arbres fruitiers à noyau.
Elle provient toujours d’une altération morbide de la séve extravasée,
q ui, après s ’êlre accumulée sous l ’écorce, finit tôt ou tard
par se faire jo u r au dehors en détruisant une partie plus ou
moins considérable de l’éoorce et du bois sous-jacent. Quelquefois
cependant elle ne réussit pas à percer l’é c o r c e , mais alors
e lle agit d’une manière encore plus fâcheuse sur la santé de
l ’arbre. Le m eilleur moyen d’en arrêter le s effets est de retrancher
les branches qui en sont atteintes, ou, si son s iè g e est sur
le trono, et q u ’il n ’ait pas encore produit de grands désordres,
d ’enlever avec la serpette ou même avec la g o u g e les parties
altérées. Dans les deux ca s , la plaie est recouverte de cire à
gre ffe r pour la metlre à l ’abri de la pluie. La g om me peut être
la conséquenc e des causes le s plus v a r ié e s , telles qu’im sous-sol
imperméable à l ’eau, un mauvais terrain, une culture n é g lig é e
ou l ’exc ès des pluies; ma is e lle provient souvent aussi de chocs
et de meurtrissures de l ’écorce et du bois. La g omm e invétérée
est tiabituellement suivie du chancre, contre lequel il n ’y a pas
de remède efficace autre que la suppression des parties atteintes,
si toutefois ces parties peuvent être enlevées sans occasionner la
mort de l ’arbre. L’ex c essiv e clialeur à laquelle le trono et les
branches des pêchers sont exposés dev a iitun mur d’espalier peut
donner lieu à la gomme et au cliancre par suite de la mortification
des parties exposées au x rayons directs du soleil. On peut
prévenir ces accidents en abritant le tronc par une couverture
de paille ou par un manchon de toile g rossièr e dont on l ’enveloppe
au mom ent des plus fortes chaleurs.
Le Manc, ou meunier', est une efflorescence blanche qui se
montre d ’abord sur les b o u r g eo n s, puis sur les feuilles et les
fruits. Il est dû à la présence d’un v ég é ta l parasite microscopique
[erjsiphe), tr è s-an a lo gu e à l ’oïdium de la v ig n e et probablement
aussi au blanc du rosier. 11 a pour effet d’arrêter oomplétenient
la végétation de l ’arbre, de l’affaiblir graduellement, de le sté riliser
et d’en entraîner la morl dans un espace de temps plus
ou moins lo n g . Lorsqu'un pêcher est attaqué par le blanc, on
doit se hâter d’y remédier en répandant sur le s feuilles de
de l’arbre et sur le mur de l’espalier de la fleur de soufre, avec
les mêmes appareils qu’on emploie pour soufrer la v ig n e , mais
en ayant la précaution de ne pas saupoudrer les fruits. L’opération
doit être faite par un temps calme et où le soleil b rille de
tout son éclat, attendu que la chaleur est néce ssair e pour développer
le g a z sulfur eu x , seule forme sous laquelle le soufre
paraisse a g ir efficacement sur les v ég é ta lion s parasites.
Le rouge est une maladie d’une tout autre n a tur e , et ju sq u ’ici
peu con n ue . Le pêcher qui en est atteint tourne au rou g e v if
d’abord, puis au rou g e obscur foncé; la v ég é ta tion s ’arrête et
l’arbre ne tarde pas à périr, sans qu’on ait pu ju sq u ’ic i empêcher
cette terminaison fatale. Tous le s p êcliers ne sont pas
ég a lem en t sujets au rou g e ; on croit avoir remarqué que les
variétés du groupe des Admirables y sont plus sujettes que les
autres.
Quant à la cloque, elle est déterminée par la présence d'un
ch ampignon d é sig n é sous le nom de Taphrina déformons (1) qui
se développe dans le parenoliyme des feuilles, qui s’épaissit, se
boursoufle et se contracte dans tous le s sens. De verte qu elle
est au début, elle passe au ja u n e et au blanc, et prend même
parfois des tons violacés. Bientôt e lle g a g n e le b o u r g eo n , qui
ce sse de s ’a llong e r, se tuméfie à son tour en ch an g ean t de c o u leur.
Il n’est pas rare qu’à la cloque v ienn en t se jo in d re les
pucerons, qui s’abritent dans le s sinuosités de la feuille déformée
; mais la cloque est indépendante des insecte s et réciproque-
(1) Ed. Prillieiix, BiiH. Soc. bot. de France, tome XIX, p. 227, 1872.
grl.: