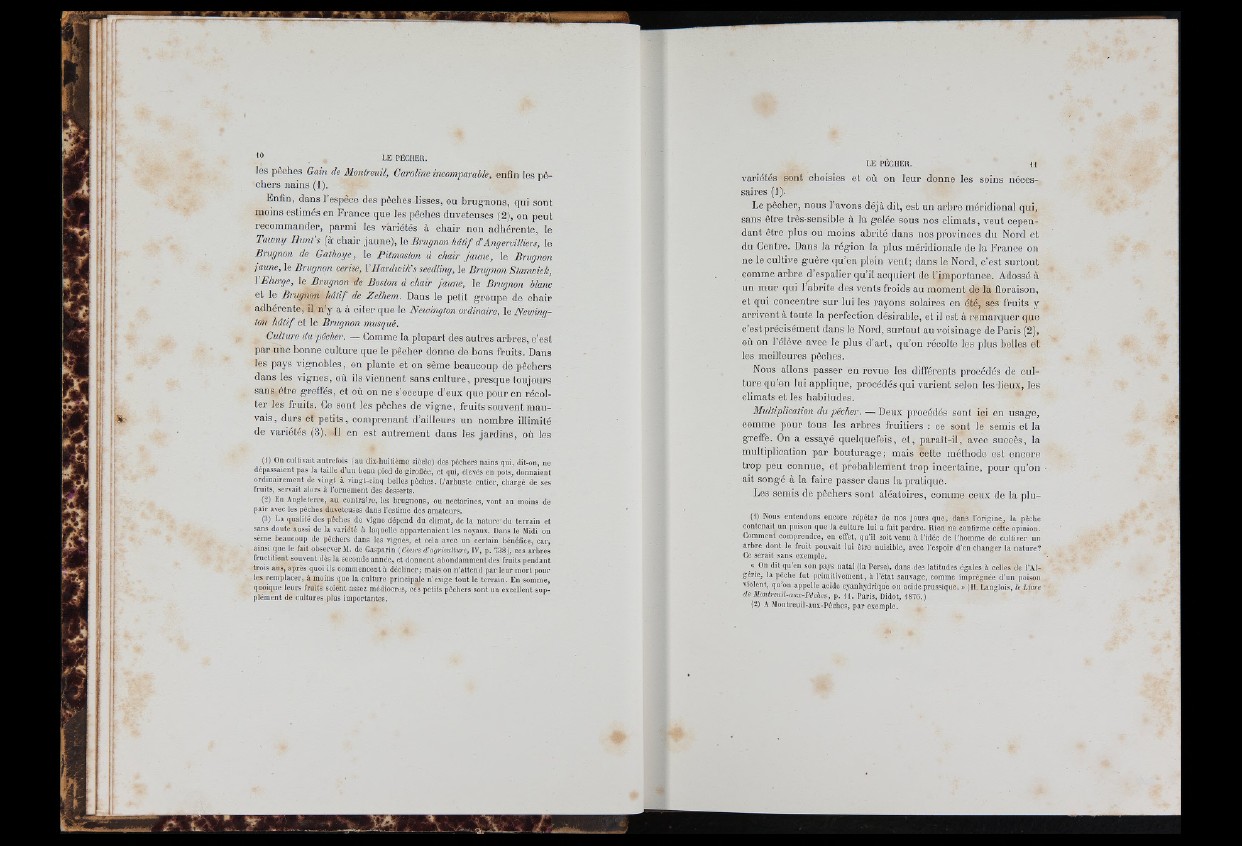
'<* LE PÊCHEIL
les pêches Gain de Monireuil, Caroline incomparable, enfin les pêchers
nains ( i) .
Enfin, dans l ’espèce des pêches lisse s, ou b ru gnon s, qui sont
moins estimés en France que les pêches duveteuses (2), on peut
recommander, parmi les variétés à chair non adhérente, le
T aw n y H u n t's (à chair jaune ), le Brugnon h â tif d'Angermlliers, le
Brugnon de Gathoye, le Pitmaston à chair ja u n e , le Brugnon
jaune, le Brugnon cerise, VHardwik's seedling, le Brugnon Slanwick,
VElurge, le Brugnon de Boston d chair jaune, le Brugnon blanc
et le Brugnon h â tif de Zelh em. Dans le petit groupe de chair
adhérente, il n’y a à citer que le Newington ordinaire, le Newing-
ton h â ti f et le Brugnon musqué.
Culture du -pêcher. — Comme la plupart des autres arbres, c ’est
par une bonne culture que le pêcher donne de bons fruits. Dans
le s pays v ig n o b le s , on plante et on sème beaucoup de pêchers
dans le s v ig n e s , où ils v ienn en t sans culture , presque toujours
sans être g r e ffé s, et où on ne s ’occupe d’eux que pour en ré colter
les fruits. Ce sont les pêches de v ig n e , fruits souvent mauv
a is , durs et p e tits, comprenant d’ailleurs un nombre illimité
de variétés (3). Il en est autrement dans le s ja rd in s, où les
(1) On cultivait autrefois (au dix-hiiitiome siècle) des pêchers nains qui, dit-on, ne
dépassaient pas la taille d’un beau pied de giroflée, et qui, élevés en pots, donnaient
ordinairement de vingt à vingt-cinq belles pèches. L’arbuste entier, chargé de ses
fruils, servait alors à rornement des desserts.
(2) En Angleterre, au contraire, les brugnons, ou nectarines, vont au moins de
pair avec les pèches dnveteuses dans l'estime des amateurs.
(3) La qualité des pêches de vigne dépend du climat, de la nature du terrain et
sans doute aussi de la variété à laquelle appartenaient les noyaux. Dans le Midi on
sème beaucoup de pêchers dans les vignes, et cela avec un certain bénéfice, car,
ainsi que le fait observerM. de Gasparin {Cours d’agriculture, IV, p. 738), ces arbres
fructifient souvent dès la seconde année, et donnent abondamment dos fruits pendant
trois ans, après quoi ils commencent à décliner; mais on n’attend par leur mort pour
les remplacer, à moins que la culture principale n’exige tout le terrain. En somme,
quoique leurs fruits soient assez médiocres, ces petits pêchers sont un excellent supplément
de cultures plus importantes.
variétés sont choisies et où on leur donne les so ins n éce ssaires
(!)■
Le pêcher, nous l ’avons déjà dit, est un arbre méridional qui,
sans être très-sensible à la g e lé e sous nos c lim a ts, v eut cependant
être plus ou moins abrité dans nos provinces du Nord et
du Centre. Dans la rég ion la plus méridionale de la France on
ne le cultive gu è r e ({u’en plein vent; dans le Nord, c ’est surtout
comme arbre d’espalier q u ’il acquiert de l ’importance. Adossé à
un mur qui l ’abrite des vents froids au moment de la floraison,
et qui concentre sur lui les rayons solaires en été, ses fruits y
arrivent à toute la perfection désirable, et il est à remarquer que
c ’est précisément dans le Nord, surtout au v o isin a g e de Paris (2),
où on l ’élève a vec le plus d’a r t, q u ’on récolte les plus belles et
les meilleures pêches.
Nous allons passer en revue le s différents procédés de cu lture
q u ’on lui applique, procédés qui varient selon le s lieu x , les
climats et le s habitudes.
Multiplication du pêcher. — Deux procédés sont ic i en u sa g e ,
comme pour tous le s arbres fruitiers ; ce sont le semis et la
greffe. On a essayé q ue lq u efo is, e t , p a ra ît-il, avec suc c è s, la
multiplication par boutura g e ; ma is cette méthode est encore
trop peu connue , et probablement trop incertaine, pour q u ’on
ait s o n g é à la faire passer dans la pratique.
Les semis de pêchers sont aléatoires, comme c eux de la p lu -
(1) Nous entendons encore répéter de nos jours que, dans l'origine, la pêche
contenait un poison que la culture lui a fait perdre. Rien ne confirme cette opinion.
Comment comprendre, en effet, qu’il soit venu à l’idée de l’homme de cultiver un
arbre dont le fruit pouvait lui être nuisible, avec l'espoir d’en changer la nature?
Ce serait sans exemple.
On dit qu’on son pays natal (la Perse), dans des latitudes égaies à celles de l'Algérie,
la pèche fut primitivement, à l’état sauvage, comme imprégnée d'un poison
violent, qu’on appelle acide cyanhydrique ou acide prussique. « ( II. Langlois, le Livre
de Montreuil-aux-Péches, p. H . Paris, Didot, I87C.)
(2) A Moutreuil-aux-Pèches, par exemple.
I I