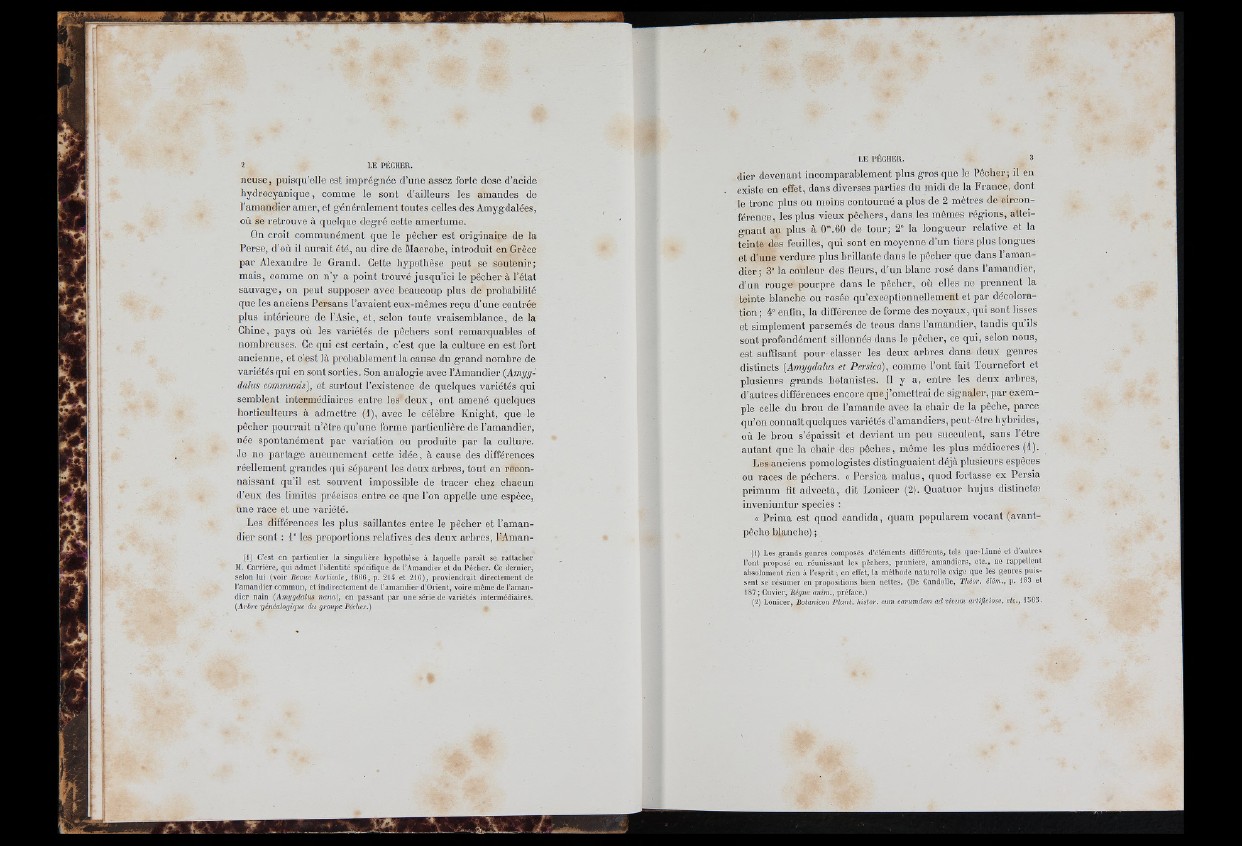
i I!
2 LE PÊCHER.
neuse, puisqu’elle est imprcg’née d’une assez forte dose d’acide
hydrocyanique, comme le sont d’ailleurs les amandes de
l’amandier amer, et g*énéralement toutes celles des Amyg’dalées,
où se retrouve à quelque degré cette amertume.
On croit communément que le p êcher est orig“inaire de la
Perse, d’où il aurait été, au dire de Maerobe, introduit en Grèce
par Alexandre le Grand. Celte hypothèse peut se soutenir;
m a is, comme on n ’y a point trouvé ju sq u ’ici le p é ch e r a l ’état
sauvag'e, on peut supposer avec beaucoup plus de probabilité
que le s anciens Persans l ’avaient eu x -m êm e s reçu d’une contrée
plus intér ieure de l ’Asie, e t, selon toute vraisemblance, de la
Chine, pays où le s variétés de pêchers sont remarquables et
nombr euse s. Ce qui est ce rta in, c ’e st que la culture en est fort
an cienn e, et c ’est là probablement la cause du g ran d nombre de
variétés qui en sont sorties. Son a n a lo g ie avec l’Amandier {Amtjg-
dahis com)nu7iis), et surtout l ’existenc e de quelques variétés qui
semblent intermédiaires entre le s d e u x , ont amené quelques
horticulteurs à admettre (1), avec le célèbre K n igb t, que le
pêcher pourrait n ’être q u ’une forme particulière de l ’amandier,
née spontanément par variation ou produite par la culture.
Je ne p artage aucunement cette id é e , à cause des diÎTérences
réellement grandes qui séparent le s deux arbres, tout en reconnaissant
qu’il est souvent impossible de tracer chez chacun
d’eu x des limites précises entre ce que l ’on appelle une espèce,
u ne race et une variété.
Les différences les plus saillantes entre le pêcher et l’amandier
sont : 1“ les proportions relatives des deux arbres, l ’Aman-
(1) C’est en paiTiculier la singulière hypothèse à laquelle paraît se rattacher
M. Carrière, qui admet l’identité spécifique de l’Amandier et du Pécher. Ce dernier,
selon lui (voir Revue horticole, 1806, p. 214 et 216), proviendrait directement de
l’amandier commun, et indirectement de l ’amandier d’Orient, voire môme de l’amandier
nain {Amijgdaliis nana), en passant par une série de variétés intermédiaires.
{Arère généalogique du groupe Pécher.)
LE PÊCHER. 3
dier devenant incomparablement plus gro s que le Pêcher; il en
existe en effet, dans diverses parties du midi de la France, dont
le tronc plus ou moins contourné a plus de 2 mètres de circonférenc
e, le s plus v ieu x p ê ch e r s, dans les mêmes r é g io n s, atteign
a n t au plus à O^.eO do tour; 2” la lo n gu eu r relative et la
teinte des feuilles, qui sont en moyenne d’un tiers plus lon g u e s
et d’une verdure plus brillante dans le pêcher que dans 1 amandier
; 3 “ la couleur des fleurs, d ’un blanc rosé dans l’amandier,
d’un rou g e pourpre dans le pêcher, où elles ne prennent la
teinte blanche ou rosée q u ’exc eptionne llement et par décoloration;
4° enfin, la différence de forme des n oyaux, qui sont lisses
et simplement parsemés de trous dans l ’amandier, tandis qu’ils
sont profondément sillonnés dans le pêcher, ce q ui, selon nous,
est suffisant pour classer les deux arbres dans deux g en r e s
distincts {Amggdahis et Persica), comme fo n t fait Tournefort et
plusieurs gran d s botanistes. Il y a, entre le s deu x arbres,
d’autres différences encore que j ’omettrai de sign a le r , par exemple
celle du brou de l’amande avec la chair de la pêche, parce
qu’on connaît quelques variétés d’amandiers, peut-être hybrides,
où le brou s’épaissit et devient un peu suc culent, sans l ’être
autant que la chair des p ê ch e s, môme les plus médiocres (1).
I^es anciens pomologâstes d istin gu a ien t déjà plusieurs espèces
ou races de pêchers. « Persica m a lu s , quod fortasse ex Persia
primum fit advecta, dit Lonicer (2). Quatuor hujus dislinclEe
inv eniuntur species :
« Prima est quod Candida, quam populärem vocant (avant-
pêche blanche) ;
(1) Les grands genres composés d’éléments différenls, tels quc>Linné et d’autres
l’ont proposé en réunissant les pêchers, pruniers, amandiers, etc., ne rappellent
absolument rien à l’esprit ; en eiTct, la méthode naturelle exige que les genres puissent
se résumer en propositions bien iicllcs. (De Candolle, Tkéor. élém., p. 163 et
187; Cuvicr, Régne anim., préface.)
(2) Lonicer, Rotanicon Plant, histor. cmn earumdem advivum artificiose, etc., lô6o.