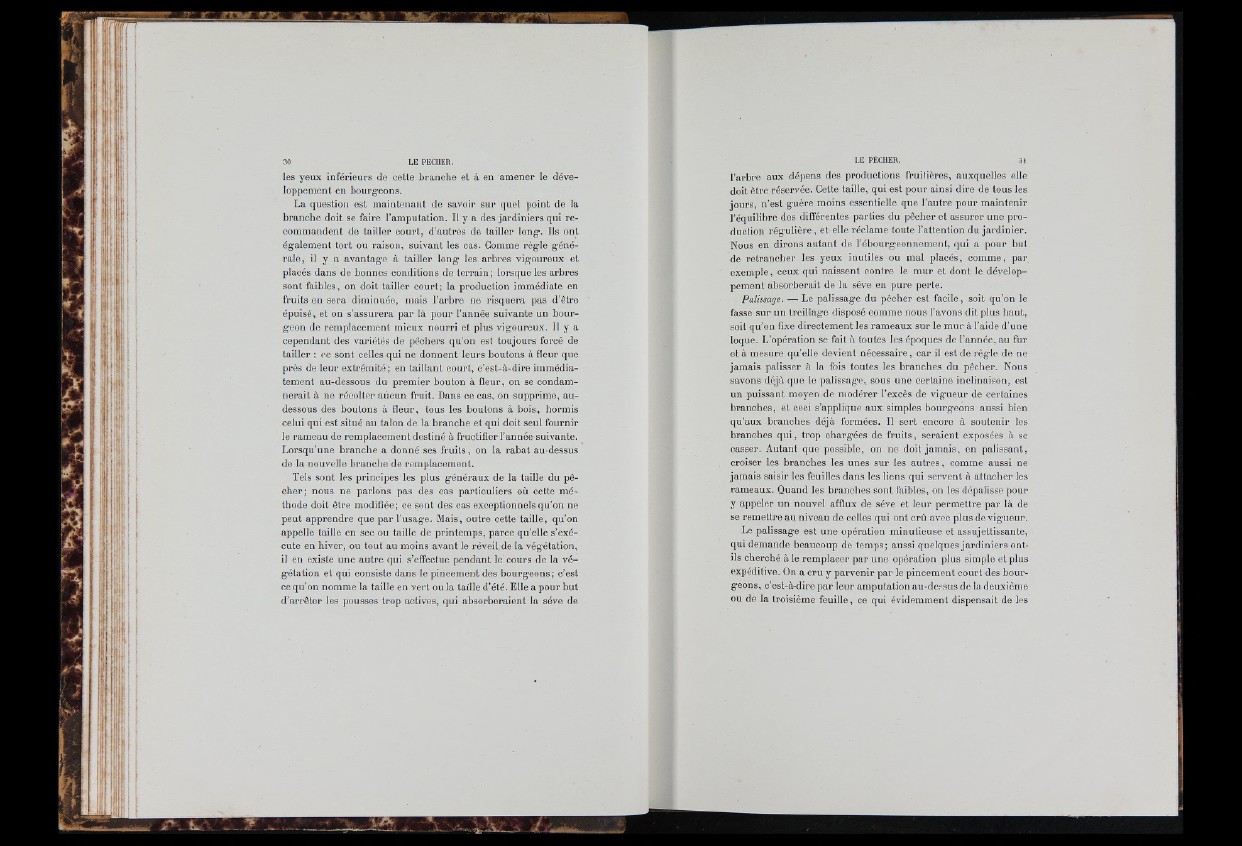
il
ii|;i 1
lli
' I I :
les yeux inférieurs de cette branche et à en amener le développement
en bourgeons.
La question est maintenant de savoir sur quel point de la
branche doit se faire l ’amputation. Il y a des jardiniers qui recommandent
de tailler court, d’autres de tailler lo n g . Ils ont
ég a lem en t tort ou raison, suivant les cas. Comme r è g le g é n é rale,
il y a a v an ta g e à tailler lo n g le s arbres v ig ou r eu x et
placés dans de bonnes conditions de terrain; lorsque les arbres
sont fa ible s, on doit tailler court; la production immédiate en
fruits en sera diminuée, mais l ’arbre ne risquera pas d’être
ép u isé , et on s ’assurera par là pour l ’anné e suivante un bourg
eon de remplacement mieux nourri et plus v ig ou r eux . Il y a
cependant des variétés de pêchers qu’on est toujours forcé de
tailler : ce sont celles qui ne donnent leurs boulons à fleur que
près de leur extrémité; en taillant court, c ’e st-à -d ir e immédiatement
au-dessous du premier bouton à fleur, on se condamnerait
à ne récolter aucun fruit. Dans ce cas, on supprime, au-
dessous des boutons à fleur , tous le s boutons à b o is, hormis
ce lui qui est situé au talon de la branche et qui doit seul fournir
le rameau de remplacement destiné à fructifier l ’année suivante.
Lorsqu’une branche a donné ses fru its, on la rabat au dessus
de la nouve lle branche de remplacement.
Tels sont le s principes les plus g én é raux de la taille du pêcher
; nous ne parlons pas des cas particuliers où cette m é thode
doit être modifiée; ce sont des cas exceptionnels q u ’on ne
peut apprendre que par l’u sa g e . Mais, outre cette ta ille , qu’on
appelle taille en sec ou taille de printemps, parce q u ’elle s’ex écute
en h iv er , ou tout au moins avant le réveil de la v égé tation,
il en existe u n e autre qui s ’effectue pendant le cours de la vég
étation et qui consiste dans le p incement des b ou rg eon s; c ’est
ce qu ’on nomme la taille en vert ou la taille d’été. Elle a pour but
d’arrêter les pousses trop actives, qui absorberaient la séve de
l ’arbre aux dépens des productions fruitières, auxquelles e lle
doit être réservée. Cette taille, qui est pour ainsi dire de tous les
jours, n’est g u è r e moins e ssentielle que l ’autre pour maintenir
l’équilibre des différentes parties du pêcher et assurer une production
r é g u liè r e , et e lle réclame toute l ’attention du jardinie r.
Nous en dirons autant de l ’ébourg eonnement, qui a pour but
de retrancher les y eu x inutile s ou mal pla c é s, com m e , par
ex emp le , ceux qui na issent contre le mur et dont le développement
absorberait de la séve en pure perte.
Palissage. — Le p a lissa g e du pêcher est fa c ile , soit qu’on le
fasse sur un treilla g e disposé comme nous l’avons dit plus haut,
soit qu’on fixe directement le s rameaux sur le mur à l ’aide d ’une
loque. L’opération se fait à toutes le s époques de l ’année, au fur
et à mesure q u e lle devient n é c e ssa ir e , car il est de r è g le de ne
jamais palisser à la fois toutes les branches du pêcher. Nous
savons déjà que le p a lissa g e , sous une certaine inclinaison, est
un puissant moyen de modérer l ’excès de v ig u eu r de certaines
branches, et ceci s ’applique aux simples bourg eon s aussi bien
qu’aux branches déjà formées. Il sert encore à soutenir les
branches q u i, trop ch a rg é e s de fru its, seraient exposées à se
casser. Autant que p ossible, on ne doit jam a is, en pa lissan t,
croiser le s branches les une s sur les au tr e s, comme au ssi ne
jamais saisir le s feuilles dans les lien s qui servent à attacher les
rameaux. Quand les branches sont faibles, on le sd ép a iisse pour
y appeler un nouvel afflux de séve et leur permettre par là de
se remettre au niveau de celles qui ont crû avec plus de v igu eu r .
Le p a lissa g e est une opération m in u tieu se et assujettissante,
qui demande beaucoup de temps; aussi quelques ja rd in ie rs ont-
ils cherché à le remplacer par u ne opération plus simple et plus
expéditive. On a cru y parvenir par le p incement court des bourg
eon s, c’est-à-dire par leur amputation au-de.-sus de la d euxième
ou de la troisième feu ille , ce qui év idemment dispensait de les