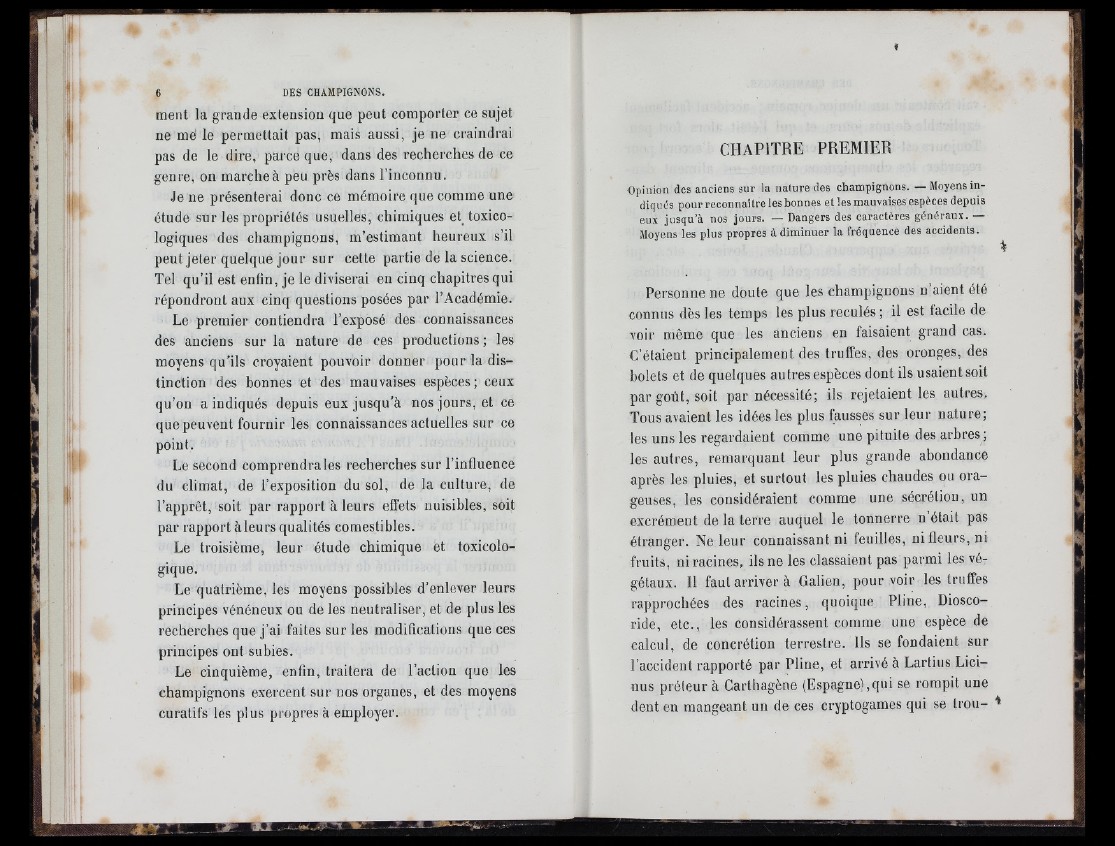
ment la grande extension que peut comporter ce sujet
ne më le permettait pas, mais aussi, je ne craindrai
pas de le dire, parce que, dans des recherches de ce
genre, on marche à peu près dans l ’inconnu.
Je ne présenterai donc ce mémoire que comme une
étude sur les propriétés usuelles, chimiques et toxico-
logiques des champignons, m ’estimant heureux s’il
peut je te r quelque jo u r su r celte partie de la science.
Tel q u ’il est enfin, je le diviserai en cinq chapitres qui
répondront aux cinq questions posées par l ’Académie.
Le premier contiendra l ’exposé des connaissances
des anciens sur la n atu re de ces productions ; les
moyens q u ’ils croyaient pouvoir donner pour la distinction
des bonnes et des mauvaises espèces; ceux
q u ’on a indiqués depuis eux ju sq u ’à nos jours, et ce
que peuvent fo u rn ir les connaissances actuelles sur ce
point.
Le second comprendra les recherches sur l ’influence
du climat, de l ’exposition du sol, de la culture , de
l ’apprêt, soit p ar rapport à leurs effets nuisibles, soit
par rapport à leu rs qualités comestibles.
Le troisième, leu r étude chimique et toxicologique.
Le quatrième, les moyens possibles d ’enlever leurs
principes vénéneux ou de les neutraliser, et de plus les
recherches que j ’ai faites sur les modifications que ces
principes ont subies.
Le cinquième, enfin, traitera de l ’action que les
champignons exercent sur nos organes, et des moyens
curatifs les plus propres à employer.
CHAPITRE PREMIER
O p in io n des a n c ie n s s u r la n a tu r e d e s c h am p ig n o n s . — Moyens in d
iq u a s p o u r r e c o n n a ître le s b o n n e s e t le s m au v a ise s e sp è c e s d e p u is
eux ju s q u ’à no s jo u r s . — D an g e rs d e s c a r a c tè r e s g é n é r a u x . —
Moyens les p lu s p ro p re s à d im in u e r la f ré q u e n c e d e s a c c id e n ts .
Personne ne doute que les champignons n ’aient été
connus dès les temps les plus re culés; il est facile de
voir même que les anciens en faisaient grand cas.
C’étaient principalement des truffes, des oronges, des
bolets et de quelques autres espèces dont ils usaient soit
par goût, soit par nécessité; ils rejetaient les autres.
Tous avaient les idées les plus fausses sur leu r n a tu re ;
les uns les regardaient comme une pituite des arbres ;
les autres, rema rquant leu r plus grande abondance
après les pluies, et surtout les pluies chaudes ou orageuses,
les considéraient comme une sécrétion, un
excrément de la te rre auquel le tonnerre n était pas
étranger. Ne leu r connaissant ni feuilles, ni fleurs, ni
fruits, ni racines, ils ne les classaient pas parmi les végétaux.
Il faut arriver à Galien, p o u rv o ir les truffes
rapprochées des ra c in e s, quoique Pline, Diosco-
ride, etc., les considérassent comme une espèce de
calcul, de concrétion te rre stre . Ils se fondaient sur
l ’accident rapporté par Pline, et arrivé à Lartius Lici-
nus p ré teu r à Carthagène (Espagne),qui se rompit une
dent en mangeant un de ces cryptogames qui se tro u - ^