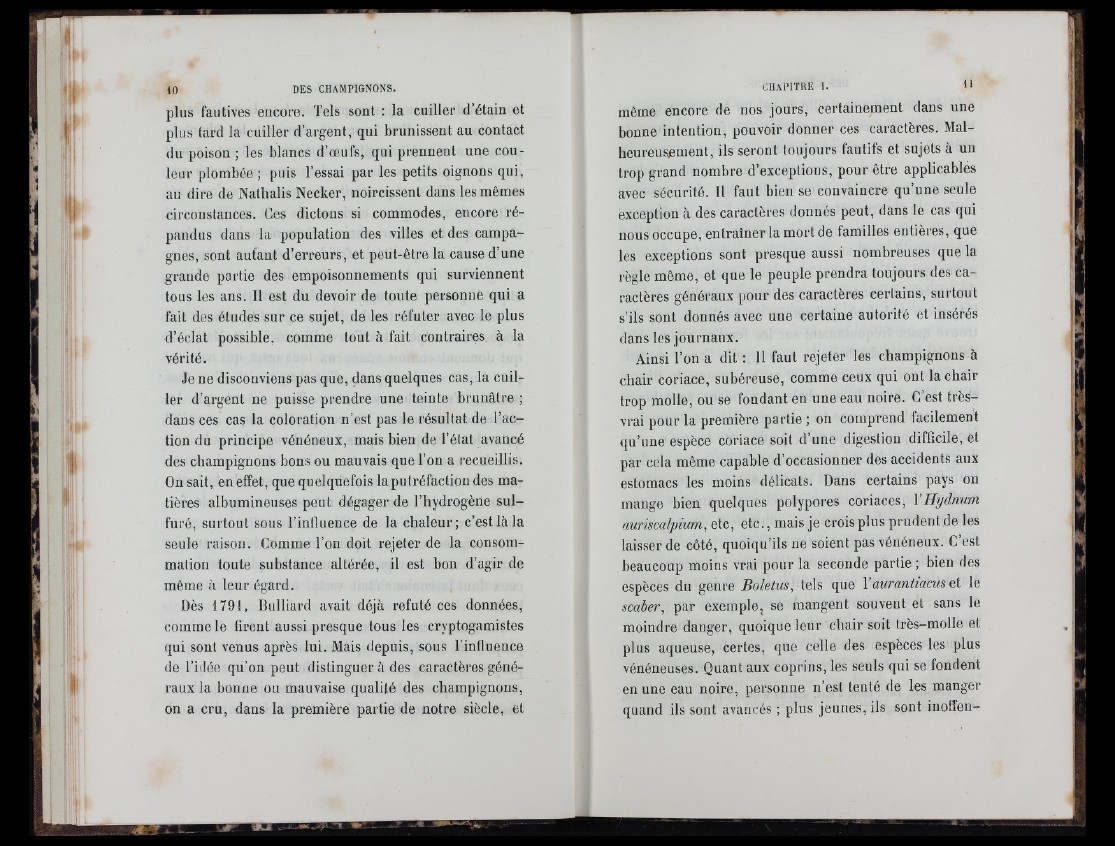
plus fautives encore. Tels sont : la cuiller d ’étain et
plus tard la cuiller d ’argent, qui brunissent au contact
du poison ; les blancs d ’oeufs, qui prennent une co u leur
plombée ; puis l ’essai p ar les petits oignons qui,
au dire de Nallialis Necker, noircissent dans les mômes
circonstances. Ces dictons si commodes, encore répandus
dans la population des villes et des campagnes,
sont autant d ’erreu rs, et peut-être la cause d ’une
grande partie des empoisonnements qui surviennent
tous les ans. Il est du devoir de toute personne qui a
fait des études sur ce sujet, de les ré fu ter avec le plus
d ’éclat possible, comme tout à fait contraires à la
vérité.
Je ne disconviens pas que, dans quelques cas, la cuiller
d ’argent ne puisse prendre une teinte b ru n â tre ;
dans ces cas la coloration n ’est pas le résultat de l ’action
du principe vénéneux, mais bien de l’élat avancé
des champignons bons ou mauvais que l’on a recueillis.
On sait, en effet, que quelquefois la putréfaction des matières
albumineuses peut dégager de l ’hydrogène sulfuré,
surtout sous l ’iniluence de la ch a leu r; c’est là la
seule raison. Comme l ’on doit rejeter de la consommation
toute substance altérée, il est bon d’agir de
même à leur égard.
Dès 1791, Bulliard avait déjà refuté ces données,
comme le firent aussi presque tous les cryptogamistes
qui sont venus après lui. Mais depuis, sous l ’influence
de l’idée q u ’on peut distinguer à des caractères géné-
l’aux la bonne ou mauvaise qualité des champignons,
on a cru, dans la première partie de notre siècle, et
même encore de nos jo u rs, certainement dans une
bonne intention, pouvoir donner ces caractères. Malheureusement,
ils seront toujours fautifs et sujets à un
trop grand nombre d ’exceptions, pour être applicables
avec sécurité. Il faut bien se convaincre q u ’une seule
exception à des caractères donnés peut, dans le cas qui
nous occupe, entra îner la mort de familles entières, que
les exceptions sont presque aussi nombreuses que la
règle même, et que le peuple p ren d ra toujours des caractères
généraux pour des caractères certains, surtout
s’ils sont donnés avec une certaine autorité et insérés
dans les jo u rn au x .
Ainsi l’on a dit : 11 faut rejeter les champignons à
chair coriace, subéreuse, comme ceux qui ont la chair
trop molle, ou se fondant en une eau noire. C’est trè s-
vrai pour la première p a rtie ; on comprend facilement
q u ’une espèce coriace soit d ’une digestion difficile, et
par cela même capable d ’occasionner des accidents aux
estomacs les moins délicats. Dans certains pays on
mange bien quelques polypores coriaces, VHydnum
auriscalpium, etc, e tc ., mais je crois plus p ru d en t de les
laisser de côté, quoiqu’ils ne soient pas vénéneux. C’est
beaucoup moins vrai pour la seconde partie ; bien des
espèces du genre Boletus, tels que Yaurantiacus et le
scaber, par exemplCj se mangent souvent et sans le
moindre danger, quoique leu r cha ir soit très-molle et
plus aqueuse, certes, que celle des espèces les plus
vénéneuses. Quant aux coprins, les seuls qui se fondent
en une eau noire, personne n ’est tenté de les manger
quand ils sont avancés ; plus jeu n es, ils sont iuoffeu