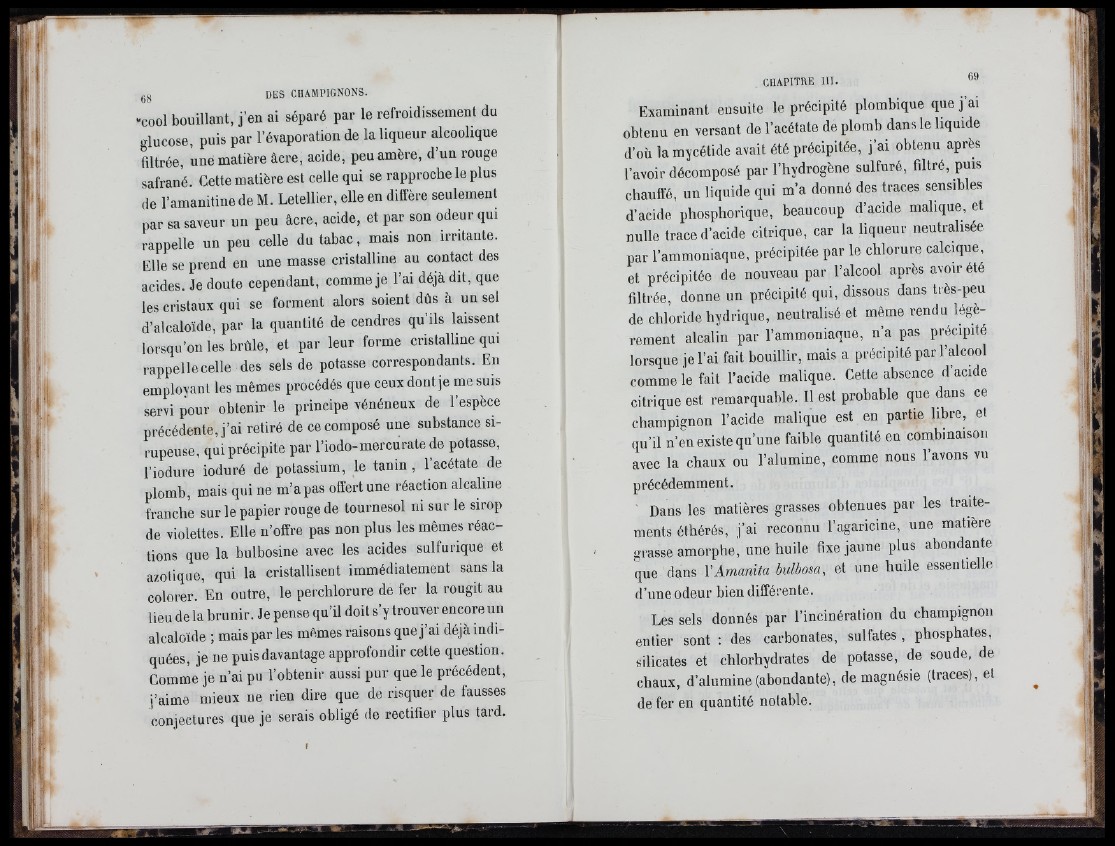
h i
lu
lil? .
m
¡ 1
d e s c h a m p ig n o n s .
'■cool bouillant, j ’en ai séparé par le refroidissement du
glucose, puis par l’évaporation de la liqueur alcoolique
filtrée, une matière âcre, acide, peu amère, d u n rouge
safrané. Cette m atière est celle qui se rapproche le plus
de l’amanifine de M. Letellier, elle en diffère seulement
par sa saveur u n peu âcre, acide, et par son odeur qui
rappelle un peu celle du tab a c , mais non irritante.
Elle se prend en une masse cristalline au contact des
acides. Je doute cependant, comme je l ’ai déjà dit, que
les cristaux qui se forment alors soient dûs à u n sel
d ’alcaloïde, p a r la quantité de cendres q u ’ils laissent
lorsqu’on les brûle, et p a r leu r forme cristalline qui
rap p e lle celle des sels de potasse correspondants. En
employant les mêmes procédés que c eu x d o n tje me suis
servi pour obtenir le principe vénéneux de 1 espèce
précédente, j ’ai retiré de ce composé une substance sirupeuse,
qui précipite p ar F iodo-mer eu rate de potasse,
l’iodure ioduré de potassium, le tanin , l ’acétate de
plomb, mais qui ne m ’a pas offert une réaction alcaline
franche sur le papier rouge de tournesol ni sur le sirop
de violettes. Elle n ’offre pas non plus les mêmes réactions
que la bulbosine avec les acides sulfurique et
azotique, qui la cristallisent immédiatement sans la
colorer. En outre, le perchlorure de fer la rougit au
lieu de la b ru n ir. Je pense qu’il doit s’y trouver encore un
alcaloïde ; mais par les mêmes raisons que j ’ai déjà indiquées,
je ne puis davantage approfondir cette question.
Comme je n ’ai pu l’obtenir aussi p u r que le précédent,
j ’aime mieux ne rien dire que de risquer de fausses
conjectures que je serais obligé de rectifier plus tard.
Examinant ensuite le précipité plombique que j ai
obtenu en versant de l ’acétate de plomb dans le liquide
d’où la mycétide avait été précipitée, j ’ai obtenu après
l’avoir décomposé par l ’hydrogène sulfuré, filtré, puis
chauft'é, un liquide qui m ’a donné des traces sensibles
d’acide phosphorique, beaucoup d ’acide malique, et
nulle trace d’acide citrique, car la liqueur neutralisée
par l’ammoniaque, précipitée par le chlorure calcique,
et précipitée de nouveau par l ’alcool après avoir été
filtrée, donne un précipité qui, dissous dans très-peu
de chloride hydrique, neutralisé et même rendu légèrement
alcalin par l ’ammoniaque, n ’a pas précipité
lorsque je l ’ai fait bouillir, mais a précipité p ar l ’alcool
comme ie fait l’acide malique. Cette absence d ’acide
citrique est remarquable. Il est probable que dans ce
champignon l ’acide malique est en partie libre, et
qu ’il n ’en existe q u ’une faible quantité en combinaison
avec la chaux ou l ’alumine, comme nous l ’avons vu
précédemment.
Dans les matières grasses obtenues p ar les traitements
éthérés, j ’ai reconnu l’agaricine, un e matière
grasse amorphe, une huile fixe jau n e plus abondante
que dans Y Amanita bulbosa, et une huile essentielle
d ’une odeur bien différente.
Les sels donnés par l ’incinération du champignon
entier sont : des carbonates, sulfates , phosphates,
silicates et chlorhydrates de potasse, de soude, de
chaux, d’alumine (abondante), de magnésie (traces), et
de fer en quantité notable.
iiii: