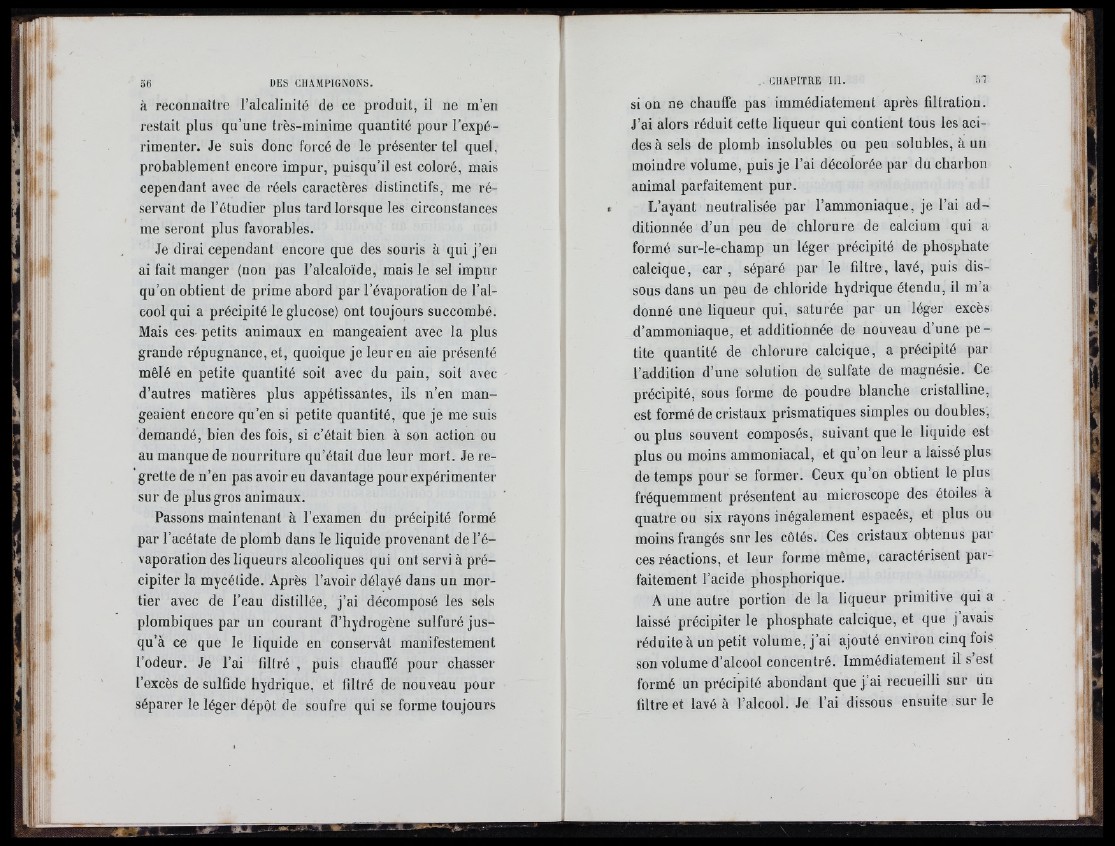
'l i '
à reconnaître l ’alcalinité de ce p roduit, il ne m ’en
restait plus q u ’une très-minime quantité pour l’expérimenter.
Je suis donc forcé de le présenter tel quel,
probablement encore impur, puisqu’il est coloré, mais
cependant avec de réels caractères distinctifs, me ré servant
de l ’étndier plus tard lorsque les circonstances
me seront plus favorables.
Je dirai cependant encore que des souris à qui j ’en
ai fait manger (non pas l ’alcaloïde, mais le sel impur
q u ’on obtient de prime abord p ar l ’évaporation de l’alcool
qui a précipité le glucose) ont toujours succombé.
Mais ces petits animaux en mangeaient avec la plus
grande répugnance, et, quoique je leur en aie présenté
mêlé en petite quantité soit avec du pain, soit avec
d ’autres matières plus appétissantes, ils n ’en mangeaient
encore q u ’en si petite quantité, que je me suis
demandé, bien des fois, si c’était bien à son action ou
au manque de n o u rritu re q u ’était due leu r mort. Je regrette
de n ’en pas avoir eu davantage pour expérimenter
sur de plus gros animaux.
Passons maintenant à l ’examen du précipité formé
par l ’acétate de plomb dans le liquide provenant de l ’évaporation
des liqueurs alcooliques qui ont servi à précipiter
la mycétide. Après l ’avoir délayé dans un mortier
avec de l ’eau distillée, j ’ai décomposé les sels
plombiques par un courant d ’hydrogène sulfuré ju s q
u ’à ce que le liquide en conservât manifestement
l ’odeur. Je l ’ai filtré , puis chauffé pour chasser
l’excès de sulfide hydrique, et filtré de nouveau pour
séparer le léger dépôt de soufre qui se forme toujours
CHAPITRE I II . 37
si on ne chauffe pas immédiatement après filtration.
J’ai alors réduit cette liqueur qui contient tous les acides
à sels de plomb insolubles ou peu solubles, à un
moindre volume, puis je l ’ai décolorée par du charbon
animal parfaitement p u r.
L’ayant neutralisée par l ’ammoniaque, je f a i ad ditionnée
d ’un peu de ch lo ru re de calcium qui a
formé sur-le-champ un léger précipité de phosphate
calcique, c a r , séparé par le filtre , lavé, puis dissous
dans u n peu de chloride hydrique étendu, il m ’a
donné une liqueur qui, saturée p ar un léger excès
d ’ammoniaque, et additionnée de nouveau d ’une p e tite
quantité de chlorure calcique, a précipité par
l ’addition d’un e solution de sulfate de magnésie. Ce
précipité, sous forme de poudre blanche cristalline,
est formé de cristaux prismatiques simples ou doubles,
ou plus souvent composés, suivant que le liquide est
plus ou moins ammoniacal, et q u ’on leu r a laissé plus
de temps pour se former. Ceux q u ’on obtient le plus
fréquemment présentent au microscope des étoiles à
quatre ou six rayons inégalement espacés, et plus ou
moins frangés snr les côtés. Ces cristaux obtenus par
ces réactions, et leu r forme même, caractérisent parfaitement
l’acide phosphorique.
A une autre portion de la liqueur primitive qui a
laissé précipiter le phosphate calcique, et que j ’avais
réduite à un petit volume, j ’ai ajouté environ cinq fois
son volume d ’alcool concentré. Immédiatement il s’est
formé un précipité abondant que j ’ai recueilli sur ün
filtre et lavé à l ’alcool. Je f a i dissous ensuite sur le
zll