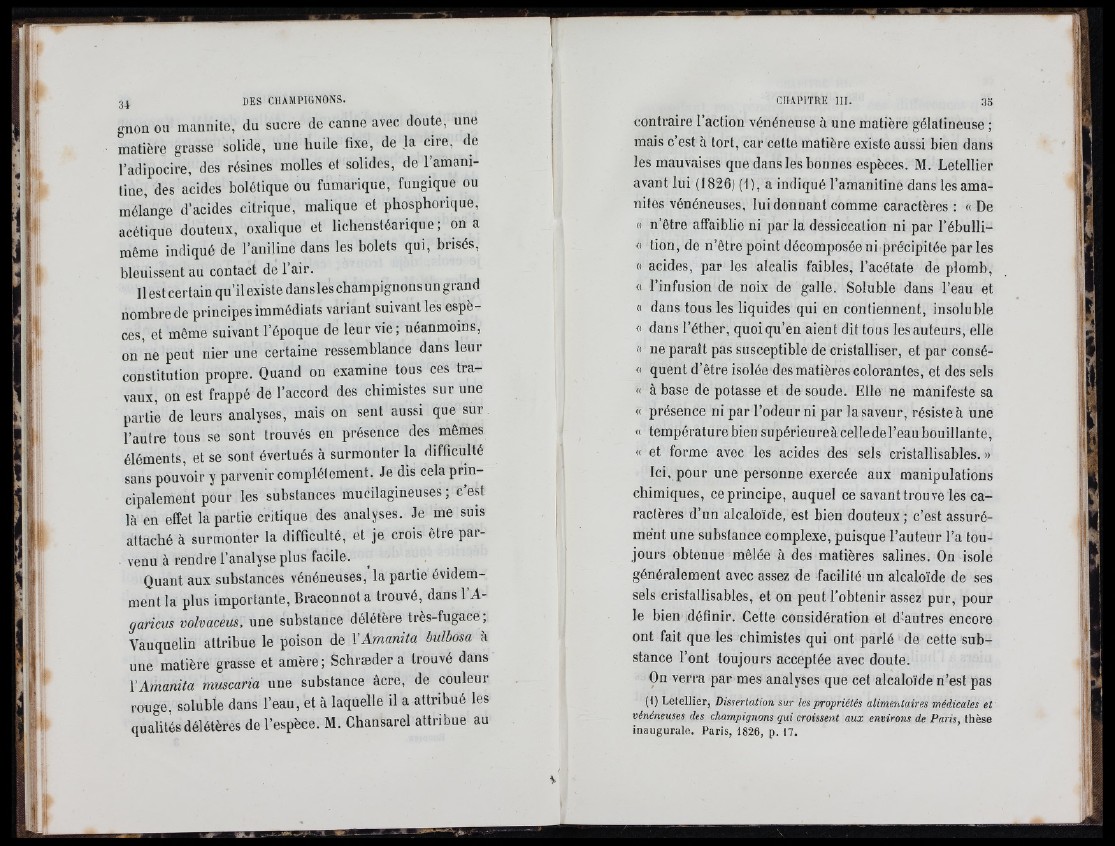
^I r-:.
1:^ I
14
gnon oil mannite, du sucre de canne avec doute, une
matière grasse solide, une huile fixe, de ]a cire, de
l ’adipocire, des résines molles et solides, de 1 amani-
tine, des acides bolétique ou fumarique, fungique ou
mélange d’acides citrique, malique et phosphorique,
acétique douteux, oxalique et lich en sté a riq u e ; on a
même indiqué de l’aniline dans les bolets qui, brisés,
bleuissent au contact de 1 air.
11 est certain q u ’il existe dansles champignons un grand
nombre de principes immédiats variant suivant les espèces,
et même suivant l ’époque de leu r vie; néanmoins,
on ne peut nier une certaine ressemblance dans leui
constitution propre. Quand on examine tous ces tra vaux,
on est frappé de l ’accord des chimistes su r une
partie de leurs analyses, mais on sent aussi que sur
l ’autre tous se sont trouvés en présence des mêmes
éléments, et se sont évertués à su rm o n ter la difficulté
sans pouvoir y parvenir coraplélcment. Je dis cela p rin cipalement
pour les substances mucilagineuses ; c’est
Icà en effet la partie critique des analyses. Je me suis
attaché à surmonter la difficulté, et je crois être p arvenu
à rendre l’analyse p lus facile.
Quant aux substances vénéneuses, la partie évidemment
la plus importante, Braconnot a trouvé, dans l ’A-
garicus volvaceus, une substance délétère très-fugace,
Vauquelin attrib u e le poison de VAmanita bulbosa à
une matière grasse et amère; Schræder a trouvé dans
XAmanita muscaria une substance âcre, de couleur
rouge, soluble dans l ’eau, et à laquelle il a attrib u é les
qualités délétères de l ’espèce. M. Chansarel attribue au
contraire l ’action vénéneuse à une matière gélatineuse ;
mais c’est à tort, car cette matière existe aussi bien dans
les mauvaises que dansles bonnes espèces. M. Letellier
avant lui (1826) (1), a indiqué l ’amanitine dans les amanites
vénéneuses, lui donnant comme caractères : « De
« n ’être affaiblie ni par la dessiccation ni par l ’éb u lli-
« tion, de n ’être point décomposée ni précipitée p a rle s
« acides, p ar les alcalis faibles, l’acétate de plomb,
« l ’infusion de noix de galle. Soluble dans l ’eau et
« dans tous les liquides qui en contiennent, insoluble
« dans l ’éther, q u o iq u ’en aient dit tous les auteurs, elle
« ne paraît pas susceptible de cristalliser, et p a r consé-
« quent d ’être isolée des matières colorantes, et des sels
« à base de potasse et de soude. Elle ne manifeste sa
« présence ni par l’odeur ni p a r la saveur, résiste à une
« température bien supérieureà celle de l’eau bouillante,
« et forme avec les acides des sels cristallisables.»
Ici, p o u r une personne exercée aux manipulations
chimiques, ce principe, auquel ce savant trouve les caractères
d ’un alcaloïde, est bien d o u teu x ; c’est assurément
une substance complexe, puisque l ’au teu r l ’a toujo
u rs obtenue mêlée à des matières salines. Ou isole
généralement avec assez de facilité un alcaloïde de ses
sels cristallisables, et on peut l’obtenir assez p u r, pour
le bien définir. Cette considération et d ’autres encore
ont fait que les chimistes qui ont parlé de cette substance
l ’ont toujours acceptée avec doute.
On verra par mes analyses que cet alcaloïde n ’est pas
(I) L e te llie r, Dissertation sur les propriétés alimentaires médicales et
vénéneuses des champignons qui croissent a u x environs de P a ris, th è s e
in a u g u r a le . P a r is , 1826, p . 17.
'i l
ni