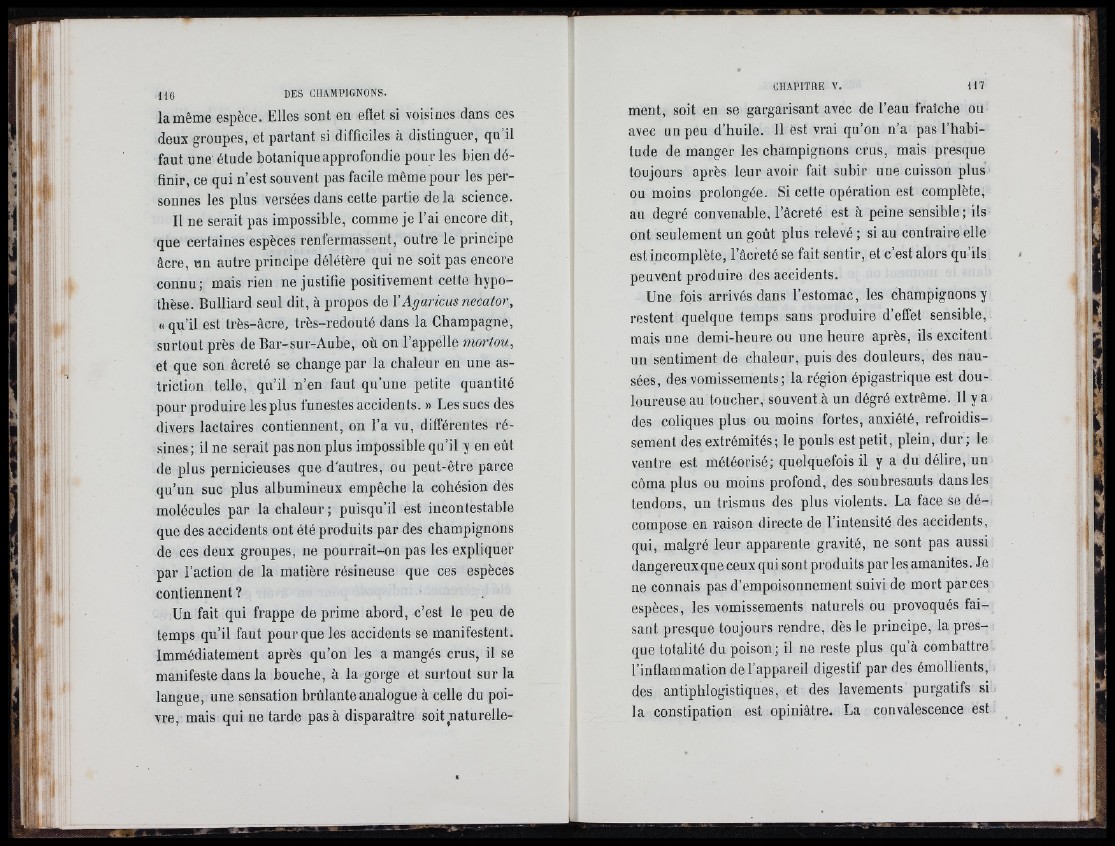
G
la même espèce. Elles sont en effet si voisines dans ces
deux groupes, et partant si difficiles à distinguer, qu ’il
faut une étude botanique approfondie pour les bien définir,
ce qui n ’est souvent pas facile même pour les personnes
les plus versées dans celte partie de la science.
Il ne serait pas impossible, comme je l’ai encore dit,
que certaines espèces renfermassent, outre le principe
âcre, un autre principe délétère qui ne soit pas encore
connu; mais rien ne justifie positivement cette hypothèse.
Bulliard seul dit, à propos de YAgaricus nccator,
« q u ’il est très-âcre, très-redouté dans la Champagne,
surtout près de B ar-sur-Aube, où on l ’appelle mortou,
et que son âcreté se change par la chaleur en une as-
triction telle, qu ’il n ’en faut qu’une petite quantité
pour produire les plus funestes accidents. » Les sucs des
divers lactaires contiennent, on l ’a vu, différentes ré sines;
il ne serait pas non plus impossible qu’il y en eût
de plus pernicieuses que d'autres, ou peut-être parce
qu’un suc plus albumineux empêche la cohésion des
molécules par la chaleur; puisqu’il est inconlestable
que des accidents ont été produits par des champignons
de ces deux groupes, ue pourrait-on pas les expliquer
par l ’action de la matière résineuse que ces espèces
contiennent ?
Un fait qui frappe de prime abord, c’est le peu de
temps qu’il faut pour que les accidents se manifestent.
Immédiatement après qu ’on les a mangés crus, il se
manifeste dans la bouche, à la gorge et surtout sur la
langue, une sensation brûlante analogue à celle du poivre,
mais qui ne tarde pas à disparaître soit^naturellement,
soit en se gargarisant avec de l’eau fraîche ou
avec un peu d’huile. Il èst vrai qu’on n ’a pas l ’habitude
de manger les champignons crus, mais presque
toujours après leur avoir fait subir une cuisson plus
ou moins prolongée. Si cette opération est complète,
au degré convenable, l ’âcreté est à peine sensible ; iis
ont seulement un goût plus relevé ; si au contraire elle
est incomplète, l ’âcreté se fait sentir, et c ’est alors qu’ils
peuvent produire des accidents.
Une fois arrivés dans l ’estomac, les champignons y
restent quelque temps sans produire d’effet sensible,
mais une demi-heure ou une heure après, ils excitent
un sentiment de chaleur, puis des douleurs, des nausées,
des vomissements; la région épigastrique est douloureuse
au toucher, souvent à un dégré extrême. Il y a
des coliques plus ou moins fortes, anxiété, refroidissement
des extrémités; le pouls est petit, plein, d u r ; le
ventre est météorisé; quelquefois il y a du délire, un
corna plus ou moins profond, des soubresauts dansles
tendons, un trismus des plus violents. La face se décompose
en raison directe de l ’intensité des accidents,
qui, malgré leur apparente gravité, ne sont pas aussi
dangereuxque ceux qui sont produits par les amanites. Je
ne connais pas d ’empoisonnement suivi de mort par ces
espèces, les vomissements naturels ou provoqués faisant
presque toujours rendre, dès le principe, la presque
totalité du poison; il ne reste plus qu’à combattre
l’inflammation de l’appareil digestif par des émollients,
des antiphlogistiques, et des lavements purgatifs si
la constipation est opiniâtre. La convalescence est