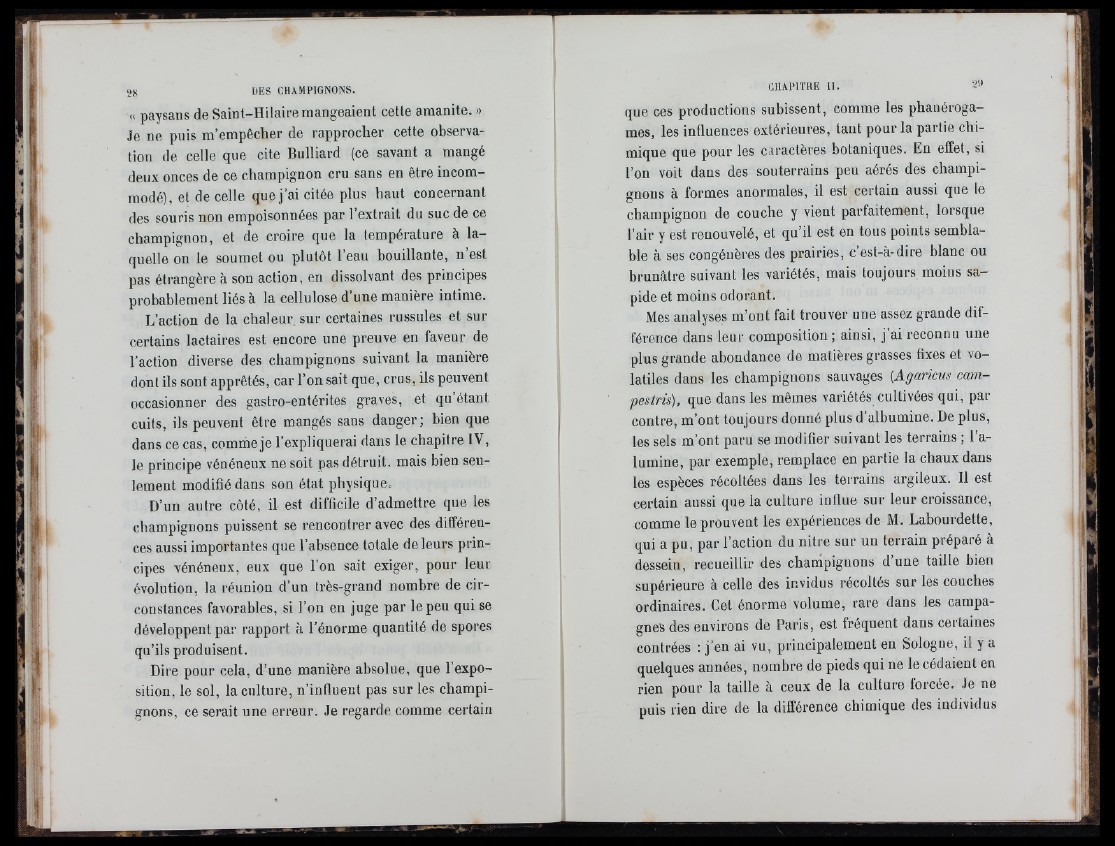
ï i i
t■K•‘I
?
G
( .
(( paysans de Saint-Hilaire mangeaient cette amanite. »
Je ne puis m ’empêcher de rapprocher cette observation
de celle que cite Bulliard (ce savant a mangé
deux onces de ce champignon cru sans en être incommodé),
et de celle que j ’ai citée plus h au t concernant
des souris non empoisonnées par l’extrait du suc de ce
champignon, et de croire que la température à laquelle
on le soumet ou plu tô t l ’eau bouillante, n ’est
pas étrangère à son action, en dissolvant des principes
probablement liés à la cellulose d’une manière intime.
L’action de la ch a leu r su r certaines russules et sur
certains lactaires est encore une preuve en faveur de
Faction diverse des champignons suivant la manière
dont ils sont apprêtés, car l’on sait que, crus, ils peuvent
occasionner des gastro-entérites graves, et q u ’étant
cuits, ils peuvent être mangés sans d an g e r; bien que
dans ce cas, comme je l ’expliquerai dans le chapitre IV,
le principe vénéneux ne soit pas d étru it, mais bien seulement
modifié dans son état physique.
D’un autre côté, il est difficile d ’admettre que les
champignons puissent se rencontrer avec des différences
aussi importantes que l ’absence totale de leurs p rin cipes
vénéneux, eux que l’on sait exiger, pour leur
évolution, la réunion d ’un très-grand nombre de circonstances
favorables, si l’on en juge p a r le peu qui se
développent par rapport à l’énorme quantité de spores
q u ’ils produisent.
Dire pour cela, d ’une manière absolue, que l ’exposition,
le sol, la culture , n ’influent pas sur les champignons,
ce serait un e e rreu r. Je regarde comme certain
CHAPITRE II.
que ces productions subissent, comme les phanérogames,
les influences extérieures, tan t pour la partie chimique
que pour les caractères botaniques. En effet, si
l’on voit dans des souterrains peu aérés des champignons
à formes anormales, il est certain aussi que le
champignon de couche y vient parfaitement, lorsque
l’air y est renouvelé, et q u ’il est en tous points semblable
à ses congénères des prairies, c’est-à-dire blanc ou
brunâtre suivant les variétés, mais toujours moins s a -
pide et moins odorant.
Mes analyses m’ont fait trouver une assez grande différence
dans leu r composition; ainsi, j ’ai reconnu une
plus grande abondance de matières grasses fixes et volatiles
dans les champignons sauvages {Agaricus campestris),
que dans les mêmes variétés cultivées qui, par
contre, m ’ont toujours donné plus d ’albumine. De plus,
les sels m ’ont paru se modifier suivant les terrains ; l ’alumine,
par exemple, remplace en partie la chaux dans
les espèces récoltées dans les terrains argileux. Il est
certain aussi que la cu ltu re influe sur leur croissance,
comme le prouvent les expériences de M. Labourdette,
qui a pu, p ar l ’action du n itre sur u n terrain préparé à
dessein, recueillir des champignons d’une taille bien
supérieure à celle des invidus récoltés sur les couches
ordinaires. Cet énorme volume, rare dans les campagnes
des environs de Paris, est fréquent dans certaines
contrées ; j ’en ai vu, principalement en Sologne, il y a
quelques années, nombre de pieds qui ne le cédaient en
rien pour la taille à ceux de la culture forcée. Je ne
puis rien dire de la différence chimique des individus