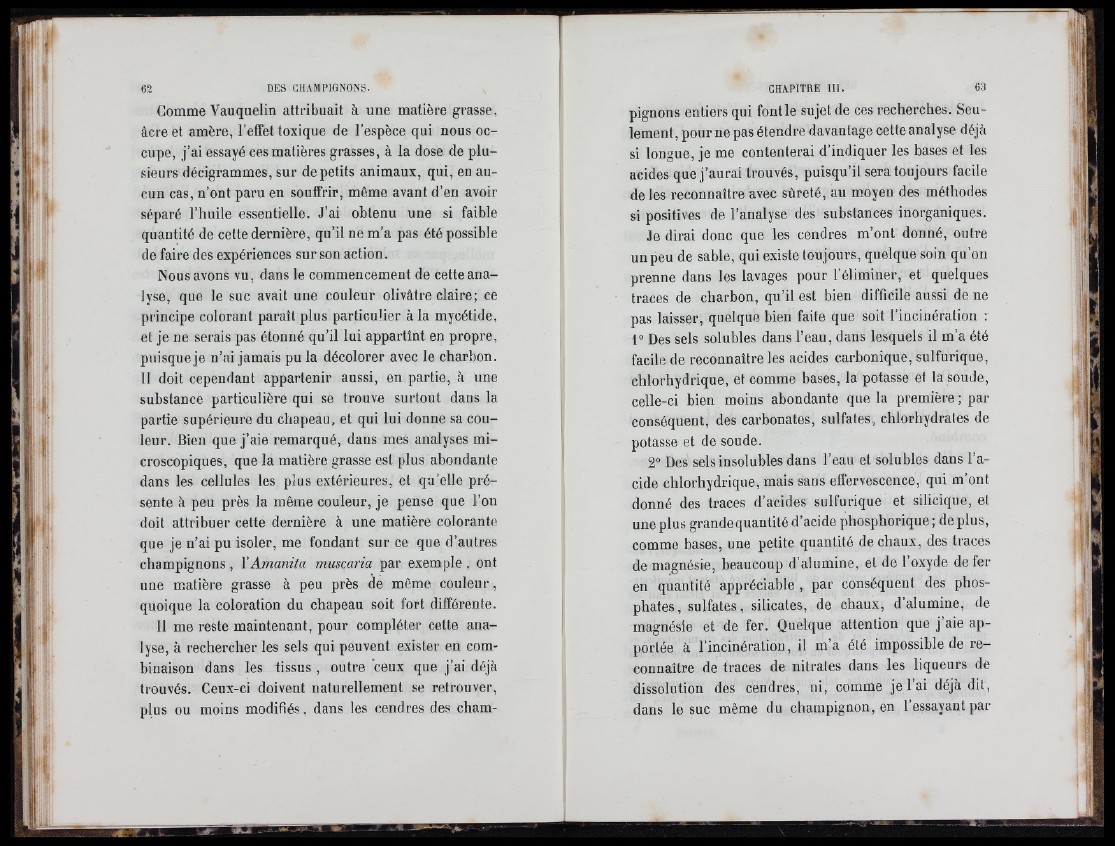
62 DES CHAMPIGNONS.
Comme Vauquelin attribuait à une matière grasse,
âcre et amère, l ’effet toxique de l ’espèce qui nous occupe,
j ’ai essayé ces m atières grasses, à la dose de p lu sieurs
décigrammes, sur de petits animaux, qui, en aucun
cas, n ’ont paru en souffrir, même avant d ’en avoir
séparé l ’huile essentielle. J ’ai obtenu un e si faible
quantité de cette d ernière, q u ’il ne m’a pas été possible
de faire des expériences sur son action.
Nous avons vu, dans le commencement de cette analyse,
que le suc avait une couleur olivâtre claire; ce
principe colorant paraît plus particulier à la mycétide,
et je ne serais pas étonné q u ’il lui appartînt en propre,
puisque je n ’ai jamais pu la décolorer avec le charbon.
11 doit cependant appartenir aussi, en partie, à une
substance particulière qui se trouve surtout dans la
partie supérieure du chapeau, et qui lui donne sa couleu
r. Bien que j ’aie remarqué, dans mes analyses microscopiques,
que la matière grasse est plus abondante
dans les cellules les plus extérieures, et q u ’elle p résente
à peu près la même couleur, je pense que l ’on
doit a ttrib u er cette dernière à une matière colorante
que je n ’ai pu isoler, me fondant sur ce que d ’autres
champignons , Y Amanita muscaria p ar exemple , ont
une matière grasse à peu près de même c o u le u r,
quoique la coloration du chapeau soit fort différente.
Il me reste maintenant, pour compléter cette analyse,
à rechercher les sels qui peuvent exister en combinaison
dans les tissus , outre ceux que j ’ai déjà
trouvés. Ceux-ci doivent naturellement se retrouver,
plus ou moins modifiés, dans les cendres des cham-
CHAPITRE I I I . 63
pignons entiers qui font le sujet de ces recherches. Seulement,
pour ne pas étendre davantage cette analyse déjà
si longue, je me contenterai d’indiquer les bases et les
acides que j ’aurai trouvés, puisqu’il sera toujours facile
de les reconnaître avec sûreté, au m.oyen des méthodes
si positives de l ’analyse des substances inorganiques.
Je dirai donc que les cendres m’ont donné, outre
un peu de sable, qui existe toujours, quelque soin q u ’on
prenne dans les lavages pour l’éliminer, et quelques
traces de charbon, q u ’il est bien difficile aussi de ne
pas laisser, quelque bien faite que soit l ’incinération :
1“ Des sels solubles dans l’eau, dans lesquels il m ’a été
facile de reconnaître les acides carbonique, sulfurique,
chlorhydrique, et comme bases, la potasse et la soude,
celle-ci bien moins abondante que la première ; p ar
conséquent, des carbonates, sulfates, chlorhydrafes de
potasse et de soude.
T Des sels insolubles dans l ’eau et solubles dans l ’acide
chlorhydrique, mais sans effervescence, qui m’ont
donné des traces d ’acides sulfurique et silicique, et
une plus grande quantité d ’acide phosphorique; de plus,
comme bases, une petite quantité de chaux, des traces
de magnésie, beaucoup d ’alumine, et de 1 oxyde de fer
en quantité appréciable , p ar conséquent des phosp
h a te s, sulfates, silicates, de chaux, d ’alumine, de
magnésie et de fer. Quelque attention que j ’aie apportée
à l’incinération, il m’a été impossible de re connaître
de traces de nitrates dans les liqueurs de
dissolution des cendres, ni, comme je 1 ai déjà dit,
dans le suc même du champignon, en l ’essayant par