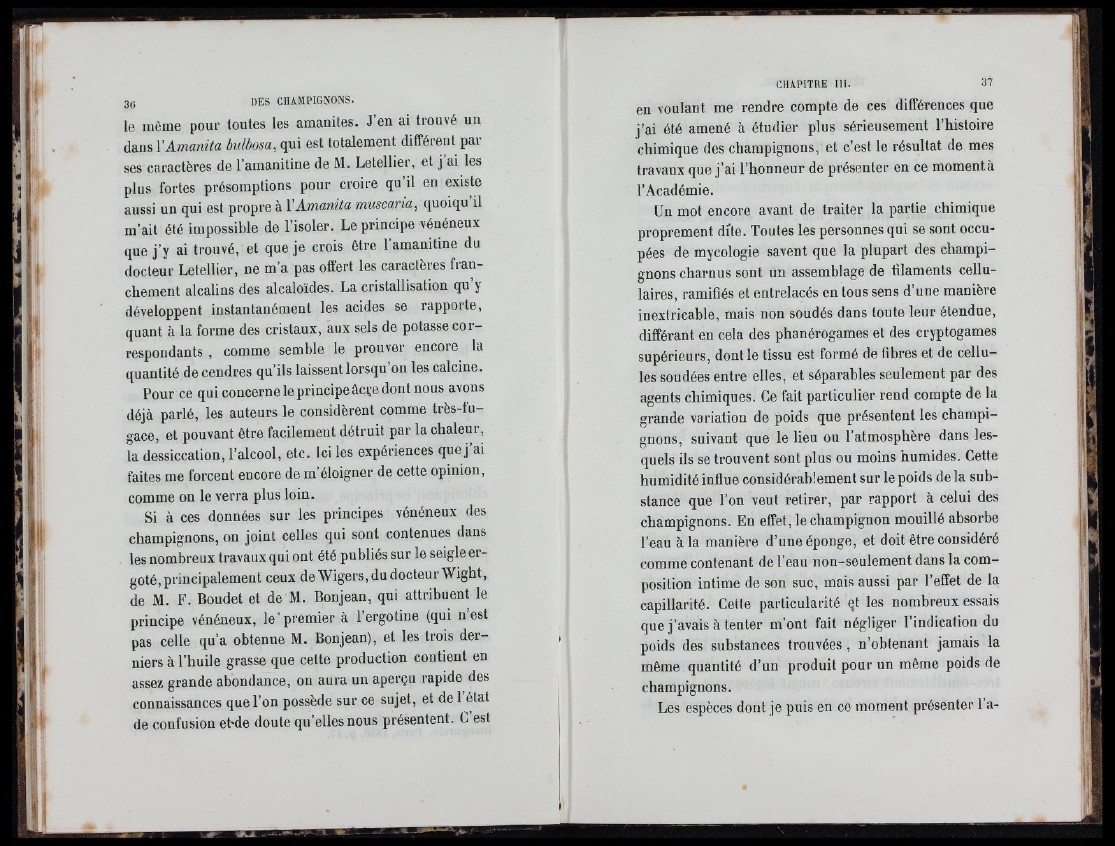
JV
I f !
Î :
1«
FF
M's
ir II
le même pour toutes les amanites. J ’en ai trouvé u n
dans VAmanita bulbosa, qui est totalement différent par
ses caractères de l ’amanitine de M. Letellier, et j ai les
plus fortes présomptions pour croire q u ’il en existe
aussi un qui est propre à VAmanita muscaria, quoiqu’il
m’ait été impossible de l’isoler. Le principe vénéneux
que j ’y ai trouvé, et que je crois être l’amanitine du
docteur Letellier, ne m’a pas offert les caractères fran chement
alcalins des alcaloïdes. La cristallisation q u ’y
développent instantanément les acides se rapporte,
quant à la forme des cristaux, aux sels de potasse c o rrespondants
, comme semble le prouver encore la
quantité de cendres q u ’ils laissent lorsqu’on les calcine.
Pour ce qui concerne le principe âcçe dont nous avons
déjà parlé, les auteurs le considèrent comme trè s -tu -
gace, et pouvant être facilement d é tru it p ar la chaleur,
la dessiccation, l ’alcool, etc. Ici les expériences que j ai
faites me forcent encore de m’éloigner de cette opinion,
comme on le verra plus loin.
Si à ces données sur les principes vénéneux des
champignons, on joint celles qui sont contenues dans
les nombreux travaux qui ont été publiés sur le seigle ergoté,
principalement ceux de Wigers, du docteur Wight,
de M. F. Boudet et de M. Bonjean, qui attribuent le
principe vénéneux, le ’ premier à l ’ergotine (qui n ’est
pas celle qu’a obtenue M. Bonjean), et les trois derniers
à l ’huile grasse que cette production contient en
assez grande abondance, on aura un aperçu rapide des
connaissances que l ’on possède sur ce sujet, et de 1 état
de confusion ebde doute q u ’elles nous présentent. C est
en voulant me rendre compte de ces différences que
j’ai été amené à étudier plus sérieusement l ’histoire
chimique des champignons, et c’est le résultat de mes
travaux que j ’ai l’ho n n eu r de présenter en ce momenta
l ’Académie.
Un mot encore avant de traiter la partie chimique
proprement dite. Toutes les personnes qui se sont occupées
de mycologie savent que la plupart des champignons
charnus sont un assemblage de filaments cellulaires,
ramifiés et entrelacés en tous sens d’une manière
inextricable, mais non soudés dans toute leu r étendue,
différant en cela des phanérogames et des cryptogames
supérieurs, dont le tissu est formé de fibres et de cellules
soudées entre elles, et séparables seulement p ar des
agents chimiques. Ce fait particulier rend compte de la
grande variation de poids que présentent les champignons,
suivant que le lieu ou l ’atmosphère dans lesquels
ils se trouvent sont plus ou moins humides. Cette
humidité influe considérablement sur le poids de la substance
que l’on veut re tire r, p ar rapport à celui des
champignons. En effet, le champignon mouillé absorbe
l’eau à la manière d ’une éponge, et doit être considéré
comme contenant de l ’eau n o n-seulement dans la composition
intime de son suc, mais aussi par l ’effet de la
capillarité. Cette particula rité qt les nombreux essais
que j ’avais à tenter m’ont fait négliger 1 indication du
poids des substances trouvées , n ’obtenant jamais la
même quantité d ’un produit p o u r un même poids de
champignons.
Les espèces dont je puis en ce moment présenter l’a-
F