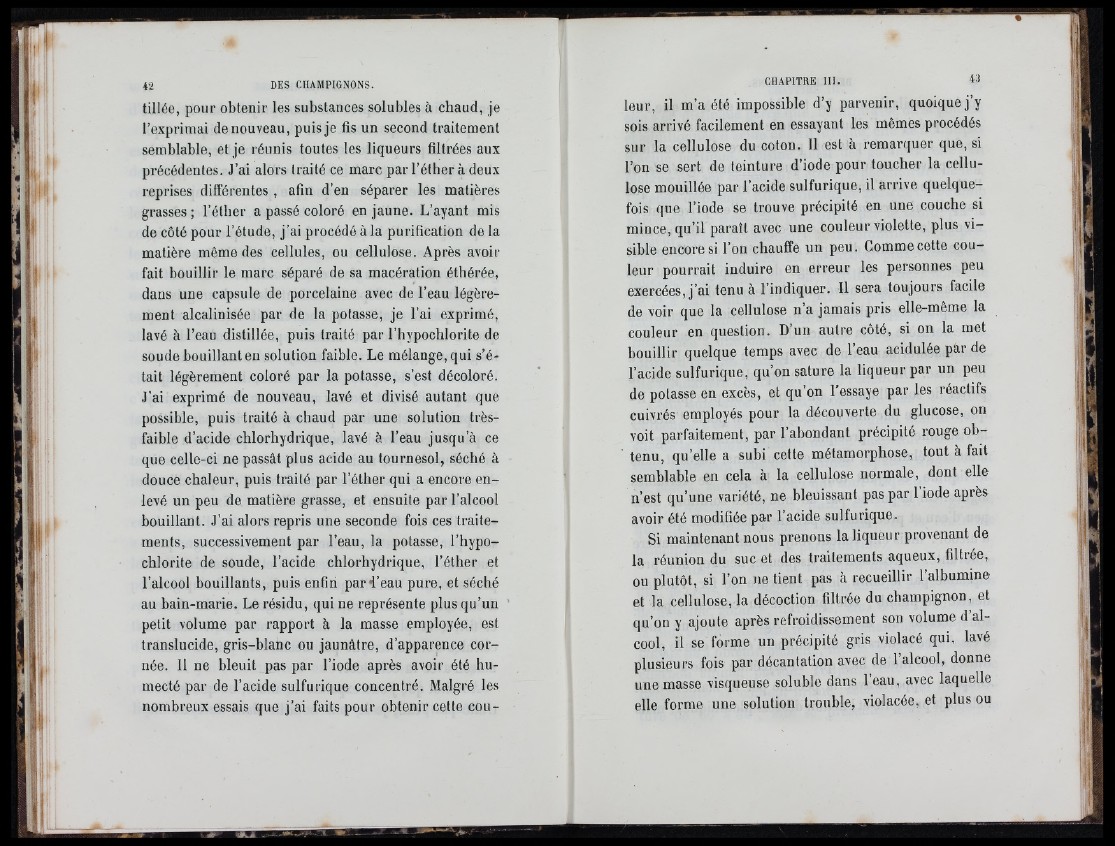
« 5 ’
Ì\ '
II-'
1*i 1&
Èli;
tillée, pour obtenir les substances solubles à chaud, je
l’exprimai de nouveau, puis je fis un second traitement
semblable, et je réunis toutes les liqueurs filtrées aux
précédentes. J ’ai alors traité ce marc p a r l ’éth er à deux
reprises différentes , afin d ’en séparer les matières
grasses ; l ’étlier a passé coloré en jau n e . L’ayant mis
de côté pour l ’étude, j ’ai pi'océdé à la purification de la
matière même des cellules, ou cellulose. Après avoir
fait bouillir le marc séparé de sa macération éthérée,
dans une capsule de porcelaine avec de l ’eau légèrement
alcalinisée p ar de la potasse, je l ’ai exprimé,
lavé à l ’eau distillée, puis traité par l ’hypochlorite de
soude bouillant en solution faible. Le mélange, qui s’é tait
légèrement coloré par la potasse, s ’est décoloré.
J ’ai exprimé de nouveau, lavé et divisé autant que
possible, puis traité à chaud p ar une solution très-
faible d’acide chlorhydrique, lavé à l’eau ju sq u ’à ce
que celle-ci ne passât plus acide au tournesol, séché à
douce chaleur, puis traité par l ’éth er qui a encore en levé
un peu de matière grasse, et ensuite p a r l ’alcool
b ouillant. J ’ai alors repris une seconde fois ces traitements,
successivement p ar l ’eau, la potasse, l ’hy p o -
chlorite de soude, l ’acide chlorhydrique, l’éth er et
l ’alcool bouillants, puis enfin p ar i ’eau pu re , et séché
au bain-marie. Le résidu, qui ne représente plus q u ’un
petit volume par rapport à la masse employée, est
translucide, gris-b lan c ou jau n â tre , d ’apparence cornée.
Il ne bleuit pas par l’iode après avoir été humecté
par de l’acide sulfurique concentré. Malgré les
nombreux essais que j ’ai faits pour obtenir cette co u leu
r, il m ’a été impossible d’y parvenir, quoique j ’y
sois arrivé facilement en essayant les mêmes procédés
su r la cellulose du coton. Il est à rema rq u er que, si
l ’on se sert de teinture d ’iode pour toucher la cellulose
mouillée par l ’acide sulfurique, il arrive quelquefois
que l ’iode se trouve précipité en une couche si
mince, q u ’il paraît avec une couleur violette, plus visible
encore si l’on chauffe u n peu. Comme cette couleur
pourrait induire en e rre u r les personnes peu
exercées, j ’ai tenu à l ’indiquer. Il sera toujours facile
de voir que la cellulose n ’a jamais pris elle-même la
couleur en question. D’un autre côté, si on la met
bouillir quelque temps avec de l’eau acidulée par de
l ’acide sulfurique, q u ’on sature la liq u eu r par u n peu
de potasse en excès, et q u ’on l ’essaye p a r les réactifs
cuivrés employés pour la découverte du glucose, on
voit parfaitement, par l’abondant précipité rouge obten
u , q u ’elle a subi cette métamorphose, tout à fait
semblable en cela à la cellulose normale, dont elle
n ’est q u ’une variété, ne bleuissant pas par l’iode après
avoir été modifiée par l’acide sulfurique.
Si maintenant nous prenons la liqueur provenant de
la réunion du suc et des traitements aqueux, filtrée,
ou plutôt, si l’on ne tient pas à recueillir l’albumine
et la cellulose, la décoction filtrée du champignon, et
q u ’on y ajoute après refroidissement son volume d alcool,
il se forme un précipité gris violacé qui, lavé
plusieurs fois par décantation avec de l’alcool, donne
une masse visqueuse soluble dans 1 eau, avec laquelle
elle forme une solution trouble, violacée, et plus ou