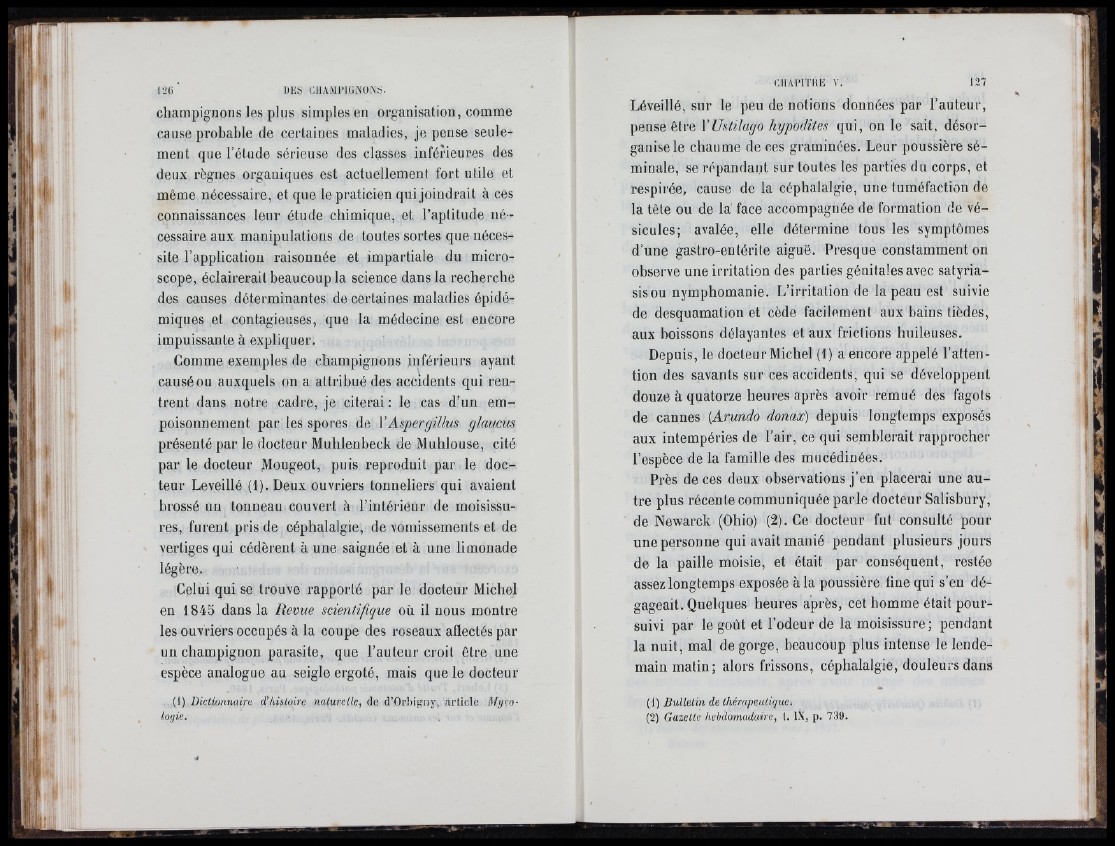
champignons les plus simples en organisation, comme
cause probable de certaines maladies, je pense seulement
que l’étude sérieuse des classes inférieures des
deux règnes organiques est actuellement fort utile et
même nécessaire, et que le praticien qui joindrait à ces
connaissances leur étude chimique, et l’aptitude n é cessaire
aux manipulations de toutes sortes que nécessite
l ’application raisonnée et impartiale du microscope,
éclairerait beaucoup la science dans la recherche
des causes déterminantes de certaines maladies épidémiques
et contagieuses, que la médecine est encore
impuissante à expliquer.
Comme exemples de champignons inférieurs ayant
causé ou auxquels on a attribué des accidents qui rentrent
dans notre cadre, je citerai : le cas d ’un empoisonnement
par les spores de VAspergillus glaucus
présenté par le docteur Muhlenbeck de Muhlouse, cité
par le docteur Mougeot, puis reproduit par le docteur
Leveillé (1). Deux ouvriers tonneliers qui avaient
brossé un tonneau couvert à l ’intérieur de moisissures,
furent pris de céphalalgie, de vomissements et de
vertiges qui cédèrent à une saignée et à une limonade
légère.
Celui qui se trouve rapporlé par le docteur Michel
en 1845 dans la Revue scientifique où il nous montre
les ouvriers occupés à la coupe des roseaux affectés par
un champignon parasite, que l ’auteur croit être une
espèce analogue au seigle ergoté, mais que le docteur
(1) Diclionnaire d ’hisloire naturelle, de d ’O rb ig n y , a r tic le M y c o logie.
Léveillé, sur le peu de notions données par l ’auteur,
pense être YUstilago hypodites qui, on le sait, désorganise
le chaume de ces graminées. Leur poussière séminale,
se répandant sur toutes les parties du corps, et
respirée, cause de la céphalalgie, une tuméfaction de
la tête ou de la face accompagnée de formation de vésicules;
avalée, elle détermine tous les symptômes
d ’une gastro-entérite aiguë. Presque constamment on
observe une irritation des parties génitales avec satyriasis
ou nymphomanie. L’irritation de la peau est suivie
de desquamation et cède facilement aux bains tièdes,
aux boissons délayantes et aux frictions huileuses.
Depuis, le docteur Michel (1) a encore appelé l ’attention
des savants sur ces accidents, qui se développent
douze à quatorze heures après avoir remué des fagots
de cannes {Arundo donax) depuis longtemps exposés
aux intempéries de l ’air, ce qui semblerait rapprocher
l’espèce de la famille des mucédinées.
Près de ces deux observations j ’en placerai une autre
plus récente communiquée par le docteur Salisbury,
de Newarck (Ohio) (2). Ce docteur fut consulté pour
une personne qui avait manié pendant plusieurs jours
de la paille moisie, et était par conséquent, restée
assez longtemps exposée à la poussière fine qui s’en dégageait.
Quelques heures après, cet homme était poursuivi
par le goût et l ’odeur de la moisissure; pendant
la nuit, mal dégorgé, beaucoup plus intense le lendemain
matin; alors frissons, céphalalgie, douleurs dans
(t) B u lle tin de thérapeutique-.
(2) Gazette hebdomadaire, t. l.\, p. 739.