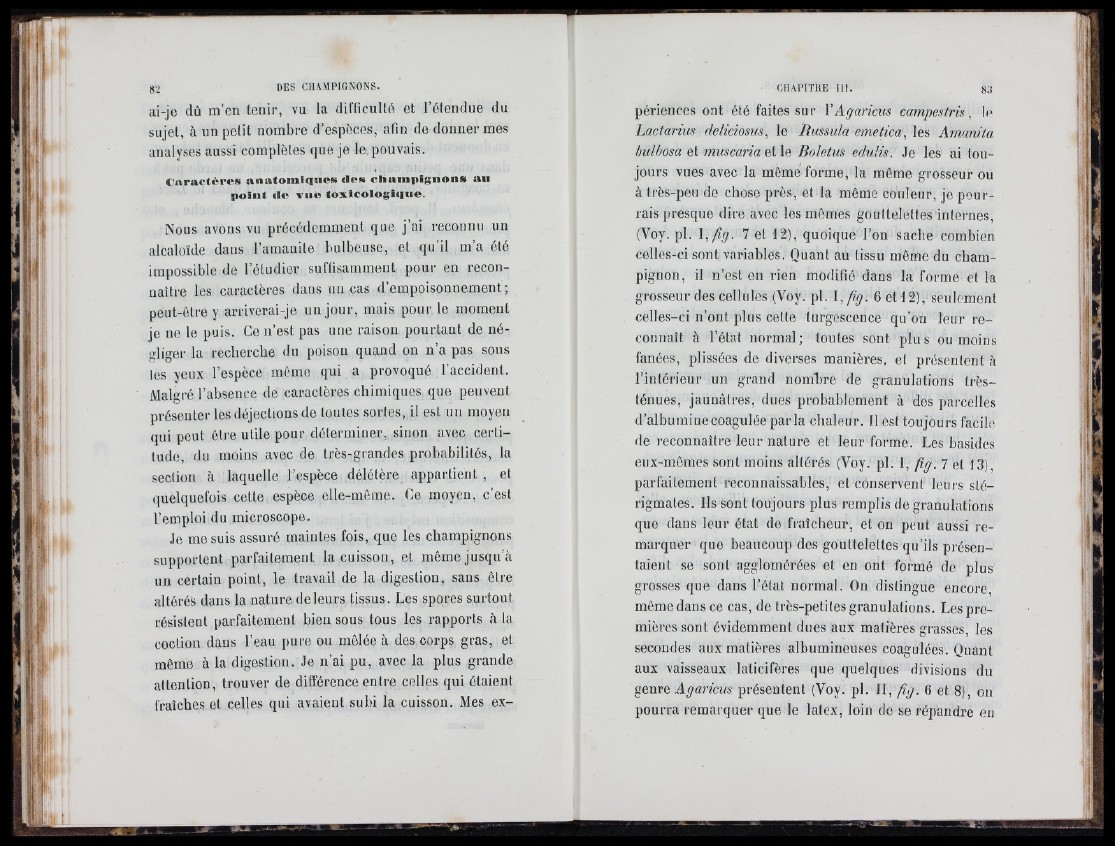
ai-je dû m’en tenir, vu la difficulté et l’étendue du
sujet, cà un petit nombre d’espèces, afin de donner mes
analyses aussi complètes que je le pouvais.
C aractères anatoiiiîawcs champignons an
point «le vue toxlcologi«i«ie.
Nous avons vu précédemment que j ’ai reconnu un
alccaloïde dans l ’amanite bulbeuse, et qu’il m’a élé
impossible de l’éludier suffisamment pour en reconnaître
les caractères dans un cas d ’empoisonnement;
peut-être y arriverai-je un jour, mais pour le moment
je ne le puis. Ce n ’est pas une raison pourtant de n é gliger
la recberclie du poison quand on n ’a pas sous
les yeux l’espèce môme qui a provoqué l ’accident.
Malgré l’abseace de caractères chimiques que peuvent
présenter les déjections de toutes .sortes, il est un moyeu
qui peut être utile pour délerminer, sinon avec certitude,
du moins avec de très-grandes probabilités, la
section à laquelle l ’espèce délétère iippartient , et
quelquefois celte espèce elle-même. Ce moyen, c’est
l’emploi du microscope.
Je me suis assuré maintes fois, que les champignons
supportent parfaitement la cuisson, et môme jusqu’à
un certain point, le travail de la digestion, sans être
altérés dans la nature de leurs tissus. Les spores surtout
résistent parfaitement bien sous tous les rapports à la
coclion dans l’eau pure ou mêlée à des corps gras, et
même à la digestion. Je n ’ai pu, avec la plus grande
attention, trouver de différence entre celles qui étaient
fraîches et celles qui avaient subi la cuisson. Mes expériences
ont été faites sur VAgaricus campestris, fi*
Lactarius deliciosus, le Russula emetica, les Amanita
bulbosa et muscaria et le Boletus edulis. Je les ai toujours
vues avec la même forme, la môme grosseur ou
à très-peu de chose près, et la môme couleur, je poui'-
rais presque dire avec les mêmes gouttelettes internes,
(Voy. pl. \, fig. 7 et 12), quoique l ’on sache combien
celles-ci sont variables. Quant au tissu même du champignon,
il n ’est en rien modifié dans la forme et la
grosseur des cellules (Voy. pl. I ,/iÿ . 6 et 12), seulement
celles-ci n ’ont plus cette turgescence qu ’on leur reconnaît
à l ’état normal; toutes sont p lu s ou moins
fanées, plissées de diverses manières, et présentent à
l ’intérieur un grand nombre de granulations très-
ténues, jaunâtres, dues probablement à des parcelles
d ’albumine coagulée p ar la chaleur. Il est toujours facile
de reconnaître leur nature et leur forme. Les basides
eux-mêmes sont moins altérés (Voy. pl. 1, fig, 7 et 13),
parfaitement reconnaissables, et conservent leurs sté-
rigmates. Ils sont toujours plus remplis de granulations
que dans leur état de fraîcheur, et on peut aussi remarquer
que beaucoup des gouttelettes qu ’ils présentaient
se sont agglomérées et en ont formé de plus
grosses que dans l ’état normal. On distingue encore,
même dans ce cas, de très-petites granulations. Les premières
sont évidemment dues aux matières grasses, les
secondes aux matières albumineuses coagulées. Quant
aux vaisseaux laticifères que quelques divisions du
Agaricus présentent (Voy. pl. II, fig . 6 et 8), on
pourra remarquer que le latex, loin de se répandre en