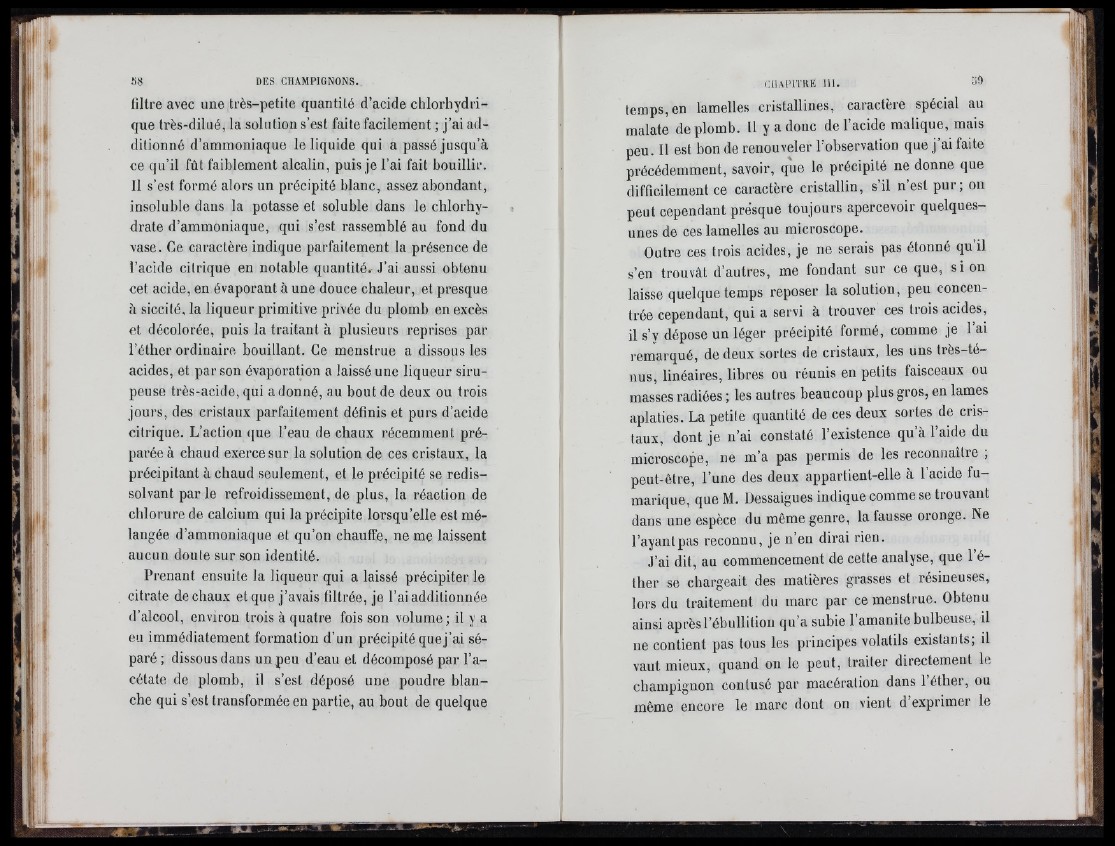
filtre avec une très-petite quantité d ’acide ctilo rh y d ri-
que très-dilué, la solution s’est faite facilement ; j ’ai ad ditionné
d ’ammoniaque le liquide qui a passé ju sq u ’à
ce q u ’il fût faiblement alcalin, puis je l’ai fait bouillir.
11 s’est formé alors un précipité blanc, assez abondant,
insoluble dans la potasse et soluble dans le chlorhydra
te d ’ammoniaque, qui s’est rassemblé au fond du
vase. Ce caractère indique parfaitement la présence de
l’acide citrique en notable quantité. J ’ai aussi obtenu
cet acide, en évaporant à une douce chaleur, et presque
à siccité, la liq u eu r primitive privée du plomb en excès
et décolorée, puis la traitant à plusieurs reprises p ar
l ’éther ordinaire bouillant. Ce menstrue a dissous les
acides, et p ar son évaporation a laissé une liq u eu r sirupeuse
très-acide, qui ad o n n é , au bout de deux ou trois
jo u rs, des cristaux parfaitement définis et purs d ’acide
citrique. L’action que l ’eau de chaux récemment p ré parée
à chaud exerce sur la solution de ces cristaux, la
précipitant à chaud seulement, et le précipité se redissolvant
par le refroidissement, de plus, la réaction de
ch lo ru re de calcium qui la précipite lo rsq u ’elle est mélangée
d ’ammoniaque et q u ’on chauffe, ne me laissent
au cu n doute sur sou identité.
Prenant ensuite la liqueur qui a laissé précipiter le
citrate de chaux et que j ’avais filtrée, je l’ai additionnée
d ’alcool, environ trois à quatre fois son volume; il y a
eu immédiatement formation d ’un précipité que j ’ai séparé
; dissous dans u n peu d’eau et décomposé p ar l’acétate
de plomb, il s ’est déposé une poudre blanche
qui s’est transformée en partie, au bout de quelque
temps, en lamelles cristallines, caractère spécial au
malate de plomb. Il y a donc de l’acide malique, mais
peu. Il est bon de renouveler Tobservatiou que j ’ai faite
précédemment, savoir, que le précipité ne donne que
difficilement ce caractère cristallin, s’il n ’est p u r ; on
peut cependant presque toujours apercevoir quelques-
unes de ces lamelles au microscope.
Outre ces trois acides, je ne serais pas étonné qu il
s’en trouvât d’autres, me fondant sur ce que, s i on
laisse quelque temps reposer la solution, peu concentrée
cependant, qui a servi à trouver ces trois acides,
il s’y dépose un léger précipité formé, comme je 1 ai
remarqué, de deux sortes de cristaux, les uns trè s -té nus,
linéaires, libres ou réunis en petits faisceaux ou
masses radiées ; les autres beaucoup plus gros, en lames
aplaties. La petite quantité de ces deux sortes de cristaux,
dont je n ’ai constaté l ’existence q u ’à l’aide du
microscope, ne m’a pas permis de les reconnaître ;
peut-être, l ’une des deux appartient-elle à l ’acide fumarique,
queM. üessaigues indique comme se trouvant
dans une espèce du même genre, la fausse oronge. Ne
l ’ayant pas reconnu, je n ’en dirai rien.
J ’ai dit, au commencement de cette analyse, que 1 é-
th e r se chargeait des matières grasses et résineuses,
lors du traitement du marc par ce menstrue. Obtenu
ainsi après l ’ébullition q u ’a subie 1 amanite bulbeuse, il
ne contient pas tous les principes volatils existants, il
vaut mieux, quand on le peut, traiter directement le
champignon conlusé par macération dans l’éther, ou
même encore le marc dont on vient d exprimer le