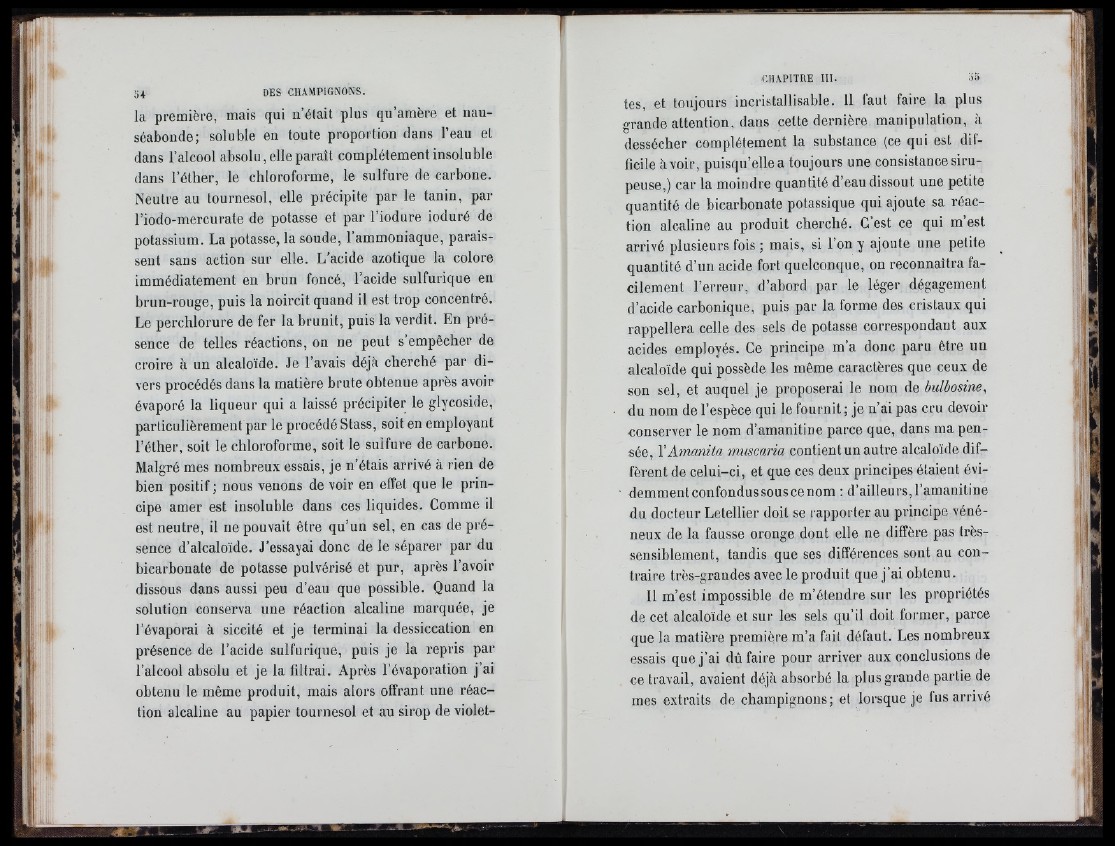
la première, mais qui n ’était plus q u ’amère et nauséabonde;
soluble en toute proportion dans l’eau et
dans l’alcool absolu, elle paraît complètement insoluble
dans l ’éther, le chloroforme, le sulfure de carbone.
Neutre au tournesol, elle précipite par le tanin, par
l ’iodo-mercurate de potasse et p ar l ’iodure ioduré de
potassium. La potasse, la soude, l ’ammoniaque, paraissent
sans action sur elle. L’acide azotique la colore
immédiatement eu b ru n foncé, l ’acide sulfurique en
brun-rouge, puis la noircit quand il est trop concentré.
Le perchlorure de fer la b ru n it, puis la verdit. En p ré sence
de telles réactions, on ne peut s’empêcher de
croire à un alcaloïde. Je l ’avais déjà cherché par d ivers
procédés dans la matière brute obtenue après avoir
évaporé la liqueur qui a laissé précipiter le glycoside,
particulièrement p ar le procédé Stass, soit en employant
l ’éther, soit le chloroforme, soit le sulfure de carbone.
Malgré mes nombreux essais, je n ’étais arrivé à rien de
bien positif; nous xenons de voir en effet que le prin cipe
amer est insoluble dans ces liquides. Comme il
est neutre , il ne pouvait être q u ’un sel, en cas de présence
d ’alcaloïde. J’essayai donc de le séparer par du
bicarbonate de potasse pulvérisé et p u r, après l ’avoir
dissous dans aussi peu d ’eau que possible. Quand la
solution conserva une réaction alcaline marquée, je
l ’évaporai à siccité et je terminai la dessiccation en
présence de l ’acide sulfurique, puis je la repris par
l’alcool absolu et je la filtrai. Après l ’évaporation j ’ai
obtenu le même produit, mais alors offrant une réaction
alcaline au papier tournesol et au sirop de violet-
CHAPITRE 111. .'io
tes, et toujours incristallisable. 11 faut faire la plus
grande attention, dans cette dernière manipulation, à
dessécher complètement la substance (ce qui est difficile
à voir, puisqu’elle a toujours une consistance sirupeuse,)
car la moindre quantité d ’eau dissout une petite
quantité de bicarbonate potassique qui ajoute sa réaction
alcaline au produit cherché. C’est ce qui m’est
arrivé plusieurs fois ; mais, si l’on y ajoute une petite
q uantité d ’un acide fort quelconque, on reconnaîtra facilement
l ’e rreu r, d ’abord par le léger dégagement
d ’acide carbonique, puis p ar la forme des cristaux qui
rappellera celle des sels de potasse correspondant aux
acides employés. Ce principe m’a donc paru être un
alcaloïde qui possède les même caractères que ceux de
son sel, et auquel je proposerai le nom de bulbosine,
d u nom de l’espèce qui le fournit ; je n ’ai pas cru devoir
conserver le nom d ’amanitine parce que, dans ma pen sée,
V Amanita muscaria contient un autre alcaloïde diffèrent
de celui-ci, et que ces deux principes étaient évidemment
confondussouscenom : d ’ailleurs, l’amanitine
du docteur Letellier doit se rapporter au principe vénéneux
de la fausse oronge dont elle ne diffère pas très-
sensiblement, tandis que ses différences sont au contraire
très-grandes avec le produit que j ’ai obtenu.
Il m’est impossible de m ’étendre sur les propriétés
de cet alcaloïde et sur les sels q u ’il doit former, parce
que la matière première m ’a fail défaut. Les nombreux
essais que j ’ai dû faire pour arriver aux conclusions de
ce travail, avaient déjà absorbé la plus g rande partie de
mes extraits de champignons; et lorsque je fus arrivé
'd I
■m
■'H