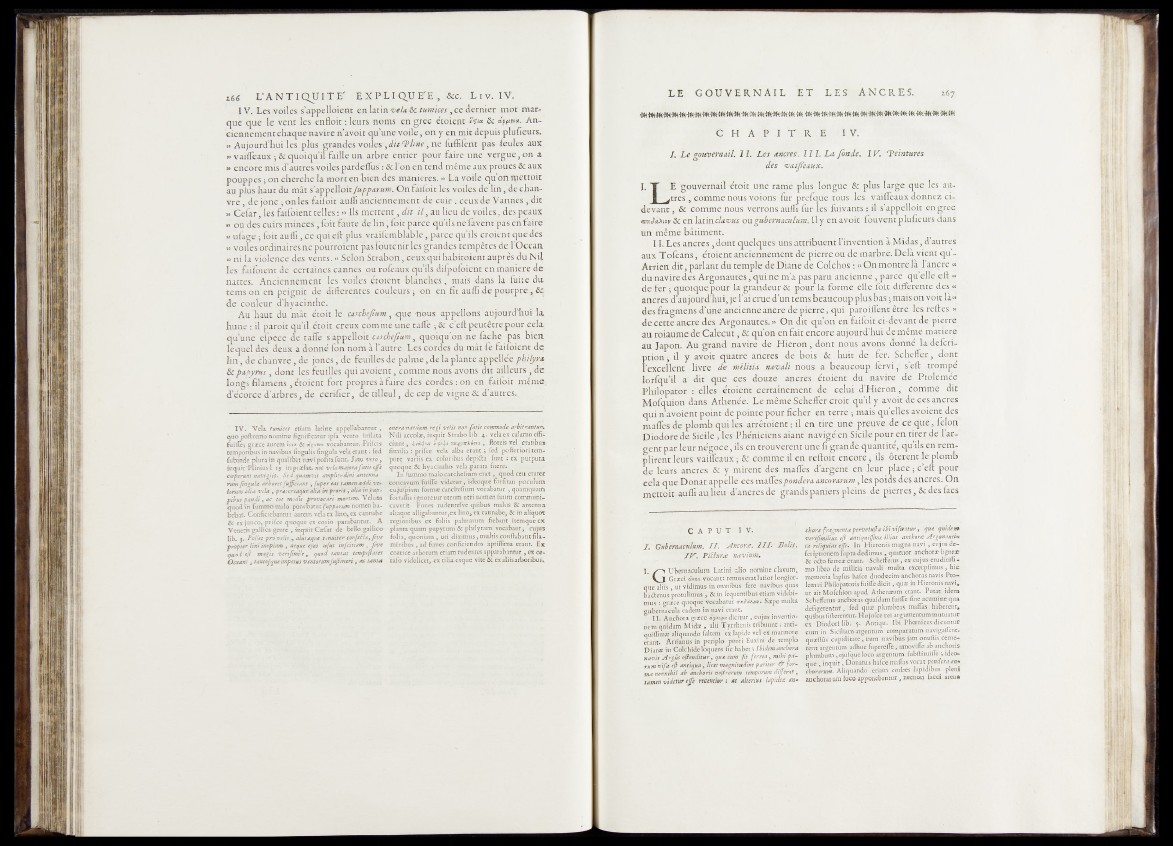
IV. Les voiles s’appelloient en latin 8c tumices , ce dernier mot marque
que le vent les enfloit : leurs noms en grec e'toient iVw & «V«»*- Anciennement
chaque navire n’avoit qu’une voile, on y en mit depuis plufieurs.
»> Aujourd’hui les plus grandes voiles y dit'Lime , ne fuffifent pas feules aux
» vaiffeaux -, & quoiqu’il faille un arbre entier pour faire une vergue, on a
» encore mis d’autres voiles pardeffus : & l’on en tend même aux proues & aux
pouppes ; on cherche la mort en bien des maniérés. » La voile qu’on ipettoit
au plus haut du mât s’a p p e l l o i t On f a i l o i t les voiles de lin, de chanvre
, de jonc ; on les faifoit auffi anciennement de cuir ; ceux de Vannes , dit
» Cefar, les faifoient telles : » Ils mettent, dit i l , au lieu de voiles, des peaux
» ou des cuirs minces , foit faute de lin, foit parce qu’ils nefavent pas enfaire
» ufàge ; foit auffi, ce qui eft plus vraifemblable, parce qu’ils croient que dès
» voiles ordinaires ne pourroient pasïdutenirles grandes tempêtes de l’Océan
» ni la violence des vents.» Selon Strabon, ceux qui habitoient auprès du Nil
les faifoient de certaines cannes ou roleaux qu’ils difpofoienr en maniéré de
nattes. Anciennement les voiles e'toient blanches , mais dans la fuite du
tems on en peignit de differentes couleurs ; on en fit auffi de pourpre, &c
de couleur d’hyacinthe.
Au haut du mât étoit le carchejium , que nous appelions aujourd'hui la
hune : il paroit qu’il étoit creux comme une taffe , & c’eft peutêtre pour cela
qu’une efpece de taffe s appelloit cxychefium., quoiqu’on ne fâche pas bien
lequel des deux a donné fon nom à l’autre Les cordes du mât fe faifoient de
lin , de chanvre, de joncs, de feuilles de palme, de la plante appellée philyra
& papyrus , donc les feuilles qui avoient, comme nous avons dit ailleurs, de
longs filamens , e'toient fort propres à faire des cordes : on en faifoit même,
d’écorce d’arbres, de ceri-fier, de tilleul, de cep de vigne8c d’autres.,
IV . Vela tumices etiam latine appellabantur ,
quo poftremo nomme fignificatur ipfa vento inflata
fui fie; gtæce aurera içi* & vocabantur. Prilcis
tempqribus in navibus fin gui is fingula vela erant ; fed
fubinde plura in qualfbet navi pofîta Tant. Jam vero,
inquh: rPlinius i 15 inpræfat. ncc velamajorafdris ejfe
coeperunt navigiis. Sed quamvn amplitudini antenna
rum fingula arbores fufficiant, fuper eas tamen addive*
lorum alia vela , pratereaque alia in prorit, aliatn 'pup-
pibus pandi , ac tot modis trrovocari mortem. Velum
quod in fummo tnalo ponebsturfupparum nomen na-
bebat. Conficiebantur aurem vela ex lino, ex cannabe
& ex junco, prifee quoque ex corio parabantur. A
Veneris gallica genre , inquit Czefar de bello gallico
lib. 3. Pelles pro velis ,, alutaque tmuiter confefta, five
•propter Uni inepiam , at que efus uftis infeitiam , five
quoi eft magis verifimUe, quod tant as tempe ft aies
O-csmi y tarn ofque impetus ventonanfuftineri, ac tanta
on era rt avium refit velis non fatis commode arbitrantun.
Nili accol*, inquit Strabo lib. 4. velaex cal am ö efE-
ciunc, » f'4 ' meovhhmx j ftorcis vel cratibus
fimilia : prifee vela alba erant j fed pofteriori tempore
variis ea coloribus depitta funt : ex purpura
quoque & hyacintho vela parata fuere.
In fummo malo carchefium erat, quod ceu crater
concavum fuifle videcur, ideoque forfitan poculum
cujufpiam forms carcbefium vocabatur , quämqüatfi
fortaflis ignoretur utrum utri nomen fuum communi-
caverit Funes rudcntefve quibus malus & antenna
aliaque alligabantur,ex lino, ex cannabe, & in aliquot
regionibus ex foliis palmarum fiebant itemque ex
planta quam papyrum & philyram vocabant, cujus
folia, quoniam , uti diximus, multis con ftabant fi la-
minibus , ad funes conficiendos aptiffima erant. Ex
cortice arborum etiam rudenres apparabantur , ex ce-
rafo videlicet, ex tilia exque vite ÖC ex aliisarboribus,.
C H A P I T R E IV .
ƒ, Le gouvernail. 11. Les antres. III. La Jbnde. IV. peintures
des ‘vaisseaux.
I. TT , E gouvernail étoit une rame plus longue & plus large que les ait-
|>tre s , comme nous voions fur prefque tous les vaiffeaux donnez ci-
devant, & comme nous verrons auffi fur les fuivants i il s’appelloit engreq
ismScbmov & en latin clavus ou gubernaculum. Il y en avoir fouvent plufieurs dans
un même bâtiment.
IL Les ancres , dont quelques- uns attribuent l’invention à Mid-as, d’autres
aux Tofcans, étoient anciennement de pierre ou de marbre. Delà vient qu -
Arrien dit, parlant du temple de Diane de Colchos : «• On montre là 1 ancre «
du navire des Argonautes, qui ne m’a pas paru ancienne , parce qu’elle eft «
de fer ; quoique pour la grandeur & pour la forme elle foit differenté des «
ancres d’aujourd’hui, je l’ai crue d’un tems beaucoup plus bas 5 mais on voit la«
des fragmens d’une ancienne ancre de pierre, qui paroiffent être les reftes «
de cette ancre des Argonautes. » On dit qu’on en faifoit ci-devant de pierre
au roiaume de Calecut, & qu’on en fait encore aujourd’hui de même matière
au Japon. Au grand navire de Hieron, dont nous avons donné la deferi-
ption ; il y avoir quatre ancres de bois & huit de fer. 'Scheffer, dont
l’excellent livre de militia na<vali nous a beaucoup f e r v i s ’eft trompe
lorfqu’il a dit que ces douze ancres étoient du navire de Ptolemee
Philopator : elles étoient certainement de celui d’Hieron, comme dit
Mofquion dans Athenée. Le même Scheffer croit qu’il y avoir de ces ancres
qui n’avoient point de pointe pour ficher en terre 5 mais quelles avoient des
maffes de plomb qui les arrêtoient : il en tire une preuve de ce que, félon
Diodore de Sicile , les Phéniciens aiant navigé en Sicile pour en tirer de I argent
par leur négoce, ils en trouvèrent une fi grande quantité, qu ils en remplirent
leurs vaiffeaux ; & comme il en reftoir encore, ils ôterent le plomb
de leurs ancres & y mirent des maffes d’argent en leur place ; c eft pour
cela que Donac appelle ces maffes pondéra ancorarum ,les poids des ancres. On
mettoit auffi au lieu d’ancres de grands paniers pleins de pierres ,& des facs
- C A P U T I V.
7 . Gubernaculum. I I . Ancône. I I I . So lis .
I V . liB u n e navium.
I . /— 1 Ubernaculum Latini alio nomine clavum.
V J Græci oiam vocant: remus erat latior longior-
que aliis, ut vidimus in omnibus fere navibus quas
ha&enus protulimus , & in fequentibus etiam videbi-
mus : græce quoque vocabatur shiJ'äAmv. Saîpe lïiulta
gubernacula eadem in navi cl’ànt.
I I. Anchora græce ayxip* dicitur, cujus inventio-
nem quidam Mi da:, alii T yrrhenis tribuunt ; artti-
quiffimæ aliquando faltem ex lapidb vel ex marmore
erant. Arriànus in periplo ponti Euxini de ternplô
Dianæ in Colchide lôquens fie habet ; Ibidem anchora
navis Argus oftenditur, qua cum fit ferrea, mihi pa-
rum Vi fa eft antiqua, licet magnitttdine pariter & forma
nonnihil ab anchoris noftrorum tcinponim difftnt,
tarnen videtur ejfe recentior ; at alteritts la pi de a anthora
fragmenta pervetufta ib't vifiintur, qua quident
verifimilius eft antiquiffima illius anchora Argonauti*
ca reliquiae ejfe. In Hieronis magna navi , cujus de-
feriptionem lupra dedimus , quatuor anchoræ ligne*
& odo ferre* erant. Schefferus , ex cujus eruditiffi-
mo libro dé militia navali multa excerpfimus, hie
memoria lapfus hafee duodecim 'anchoras navis Pto-
lemxi Philopatoris fuiflè d ielt, quæ in Hierônis navi,
ut ait Mofchion apud Athenæum erant. Putat idem
Schefferus ànehoras quafdâm fui fie fine acumine qua
defigerentur, fed qu* plumbéas mafias haberenr,
quibus fifterentur. Hujufce rei argumentummutuatur
ex Diodôri lib. 5. AntiqU. Ibi Phcenices dicuntuff
cumin Siciliamargentum comparatum navigafienc.
quæftûs cupiditace, bum navibus jam onuftis cérne-
irent argentum adhuc fuperefie, amovifie ab anchoris
plumbum , ejufque loco argentum fubftituifle ; ideo*
que , inquit, Donatus hafee mafias vocal Pondera an*
chttrarum. Aliquando etiam corbes lapidibus pleni
anchoraium loco apponebantur , necnon facci arena