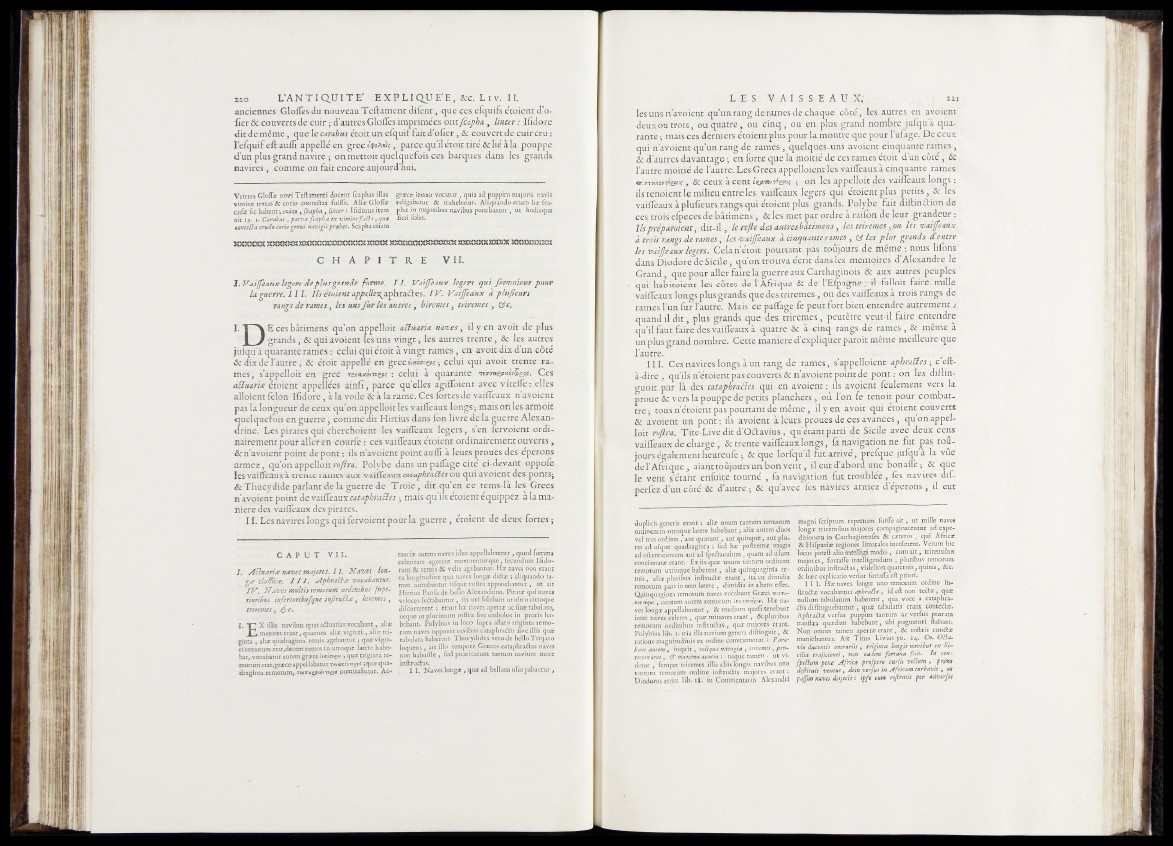
n o L’AN T I QU I T E' E X P L I Q U E 'E, &c. L i v. II.
anciennes Glofles du nouveau Teftament difent, que ces efquifs e'toient d’o-
fier & couverts de cuir ; d’autres Glofles imprimées ont fcaphii , /inter : Ifidore
dit de même, que le carabus étoic un efquif fait d’ofier , & couvert de cuir cru :
l’efquif eft aufli appelle en grec e<poA*>ç, parce qu’il étoit tiré & lié à la pouppe
d’un plus grand navire ; on mettoit quelquefois ces barques dans les grands,
navires , comme on fait encore aujourd’hui.
Yeteres Gloffæ novi Teftamenti do cent fcaphas illas græcc \qo\i )s vocatur , quia ad puppim majoris navis
vimine textas & corio concédas fuiffe. Aliæ Gloffæ religabatur & trahebatur. Aliquando eciam hæ fca-
cufæ fie habent ; o-xi?» , feapha, lin ter ; Ifidorus item phæ in majoribus navibus ponebantur, ut hodieque
ait 15. 1. Carabus, paru a feapha ex vimine fa lla , qua fieri lolec.
contefta crudo cono gémis navigii prabet. Scaphaetiam
C H A P I T R E V U .
I. Vaiffeaux légers de plus grande forme. I J. Vaijfeaux légers qui fer'v oient pour
la guerre. III. Ils étaient d^eZk^aphraétes. I V. Vaijfeaux a plufieurs
rangs de rames , les uns Jur les autres, biremes, triremes , c,
1.1 * \ E cesbâtimens qu'on appclloic actuariat naves 3 il y en avoit de plus
I J grands | & qui avoienc les uns vingt, les autres trente, & les autres
juiqu’à quarante rames : celui qui étoit à vingt rames , en avoit dix d un côte
& dix de l autre , ôc étoit appellé en grec iudooçÿç • celui qui avoit trente rames,
s’appelloit en grec ie*dLMrreçsç : celui à quarante 'mnmçsudvlo&ç. Ces
aEtuariee étoient appellées ainfi, parce qu’elles agifïbient avec vîtefTe: elles
alloient félon Ifidore , à la voile & à la rame. Ces fortes de vaifTeaux n avoienc
pas la longueur de ceux qu’on appelloit les vaifTeaux longs; mais on les armoic
quelquefois en guerre, comme dit Hirtius dans fon livre de la guerre Alexan-
drine. Les pirates qui cherchoient les vaifTeaux légers, s en iervoient ordinairement
pour aller en courfe : ces vaifTeaux étoient ordinairement ouverts ,
&n’avoient point de pont : ils n’avoient point auffi à leurs proues des eperons
armez, qu’on appelloit roflra. Polybe dans un paflage cite ci-devant oppofè
les vaifTeaux à crcntc ram e s au x vaifTeaux ceuuphraetês ou qui avoient des ponts;
& Thucydide parlant de la guerre de Troie, dit qu’en ce tems-là les Grecs
n’avoient point de vaifTeaux cataphracies ; mais qu’ils étoient équippez à la maniéré
des vaifTeaux des pirates.
II. Les navires longs qui fervoient pour la guerre, étoient de deux fortes;
C A P U T V I I .
7. Acluar'ue naves majores. 11. Haves Ion-
ye claljica. 111. Afhracia vocabantur.
XV. Haves mult is remorum ordinibus fupe-
rieribus inferioribufejue infiruEla, biremes ,
triremes, &c.
I. Hr? X illis navibus quasa&uarias vocabant, alia:
r / majores crane, quarum alia: viginti, alix tri-
ginta , alia:quadraginta remis agebantur ; qua: viginti
remorum erar,decern remos in utroque latere habc-
bat, vocabatur autem grzece uKomepi j quae triginta rc-
morum erat,graece appellabatur ruaxh-nes* iquae quadraginta
remorum, itoociffpYJDVTpyt nominabatur. Actuarial
autem naves ideo appellabantur , quod fumma
celeritate agerent moverenturque, fecundum Ifido-
rum Sc remis Sc velis agebantur. Ha: naves non eranc
ea longitudine qua naves long* didtas > aliquando ra-
men armabantur iifque roftra apponebantur , ut ait
Hirtius Pan fa de bello Alexandrino.Piratx qui naves
veloces fedtabantur, iis uti folebant ut ulcro citroque
difeurrerent > crant hx naves apertx aefine tabula to,
neque ut plurimum roftra five embolos in proris ha-
bebant. Polybius in loco fupra allato triginta remorum
naves opponit navibus cataphra&is five illis quae
tabulata haberent. Thucydides verode bello.Trojano
loquens , ait illo tempore Graecos cataphradtas naves
non habuifle , fed piraticarum tantum navium more
inftrudtas. ,
I I. Naves longae , quae ad bellum ufurpabantur ,
L E S V A I S S E A U X : 121
les uns n’avoient qu’un rang de rames de chaque côté, les autres en avoient
deux ou trois, ou quatre, ou cinq, ou en plus grand nombre jufqu’à quarante
; mais ces derniers étoient plus pour la montre que pour l’ufage. De ceux
qui n’avoient qu’un rang de rames , quelques-uns avoient cinquante rames ,
& d’autres davantage ; en forte que la moitié de ces rames étoit d’un côte , &
l’autre moitié de l’autre. Les Grecs appelaient les vaifleaux à cinquante rames
««TnxWest!?, & ceux à cent iwm"dew ; on les appelloit des vaifleaux longs :
ils tenoient le milieu entre les vaifleaux légers qui étoient plus petits , & les
vaifleaux à plufieurs rangs qui étoient plus grands. Polybe fait diftinétion de
ces trois efpeces de bâtimens, & les met par ordre à raifbn de leur grandeur :
Ils préparaient, dit-il, le refie des autres bâtimens, le* trireme*, ou les vaijfeaux,
d trois rangs de rames y les vaifleaux d cinquante rames, & les plus grands d entre
les vaifleaux légers. Celan’.étoit pourtant pas toûjours de même: nous lifons
dans Diodore de Sicile, qu’on trouva écrit dansies mémoires d’Alexandre le
Grand , que pour aller faire la guerre aux Carthaginois & aux autres peuples
qui habitoient les côtes de 1 Afrique & de l’Efpagne, il falloir faire mille
vaifleaux longs plus grands que des triremes., ou des vaifleauxa trois rangs de
rames l’un fur l’autre. Mais ce paflage fe peut fort bien entendre autrement ;
quand il dit, plus grands que des triremes, peutêtre veut-il faire entendre
qu’il faut faire des vaifleaux à quatre & à cinq rangs de rames, & même à
un plus grand nombre. Cette maniéré d’expliquer paroit même meilleure que
l’autre. - - -■ . • _
III. Ces navires longs à un rang de rames, s'appelaient aphraiïles ; c eft-
à-dire j qu’ils n’étoient pas couverts & n’avoient point de pont ; on les diftin-
guoit par là des cataphraéles qui en avoient : ils avoient feulement vers la
proue & vers la pouppe de petits planchers , où l’on fe tenoit pour combattre
; tous n étoient pas pourtant de même , il y en avoit qui etoient couverts
& avoient un pont : ils avoient à leurs proues de ces avances, qu on appelloit
roflra. Tite-Live dit d’Oétavius , qu’étant parti de Sicile avec deux cens
vaifleaux de charge, & trente vaifleaux longs, fa navigation ne fut pas toujours
égalementheureufe ; & que lorfqu’il fut arrivé, prefque jufqu'a la vue
de l’Afrique , aiant toûjours un bon vent, il eut d’abord une bonafle ; & que
le vent s’étant enfuite tourne , fa navigation fut troublée, les navires dif-
perfez d’un côté & d’autre ; & qu'avec fes navires armez d’éperons, il eut
duplicis generis erant *, aliae unum tantum remorum
ordinem in utroque latere habebant i aliæ autem duos
vel très ordines, aut quatuor , auc quinque, aut plu«,
res ad ufque quadraginta î fed hæ poftremæ magis
ad oftenrationem aut ad fpeétaculum, quam ad üfum
concinnatæ erant. Ex iis quæ unum tantum ordinem
remorum utrinque haberent, aliæ quinquaginta remis
, aliæ pluribus inftruâæ erant, ita ut dimidia
remorum pars in uno latere , dimidia in altero effet.
Quinquaginta remorum naves vocabant Græci wtn-
xovnçHf y centum autem remorum iyetrorngaf. Hæ naves
longæ appellabantur , & medium quafi tenebant
inter naves celeres, quæ minores erant, Sc pluribus
remorum ordinibus inftrudtas , quæ majores eranc.
Polybius lib. i. tria ilia navium genera diftinguit, &
racione magnirudinis ea ordine commémorât : P ara-
barn autem , inquit, relief ua navigia , triremes, pert-
tccoMoros, & maxima acatia ; neque tamen . ut vi-
detur , Temper triremes illis aliislongis navibus uno
tantum remorum ordine inftrudtis majores erant >
Diodorus cnim lib. 18. in Commçntariis Alejcandri
magni fcrîptum repertum fuiffe ait, ut mille nave«
longæ triremibus majores çompaginarentur ad expe-
ditionem in Carthaginenfcs Sc cæteros, qui Africæ
& Hifpaniæ regiones littorales incolercnt. Verum hic
locus poteift alio intelligi modo , cum a it, triremibus
majores, fortaffe intelligendum , pluribus remorum
ordinibus inftru&as, videlicet quaternis, quinis , &c.
Sc hæc explicatio verior fortaffe eft priori.
I I I . Hæ naves longæ uno remorum ordine in-
ftrudhc voçabantur aphrabla , id eft non redtæ, quæ
nullum tabulatum haberent, qua voce a cataphra-
dtis diftinguebantur, quæ tabulatis erant contedtæ.
Aphradtæ verfus puppim tantum ac verfus proram
tranftra quædam habebant, ubi pugnaturi ftabant..
Non omnes tamen apertæ erant, & roftris cundtæ
muniebantur. Ait Titus Livius 30. 24. Cn. Otta.
vio dacentis operariis , triginta longis navibus ex Sicilia
trajicienti, non eadem fortuna fuit. In con-
fpettum pene Africa profpero curfu vellum , primo
dejlituit ventus , dein verfus in Africum turbavit, ae
paffm naves disjecit : ipfc cum rojlratis per adverfos