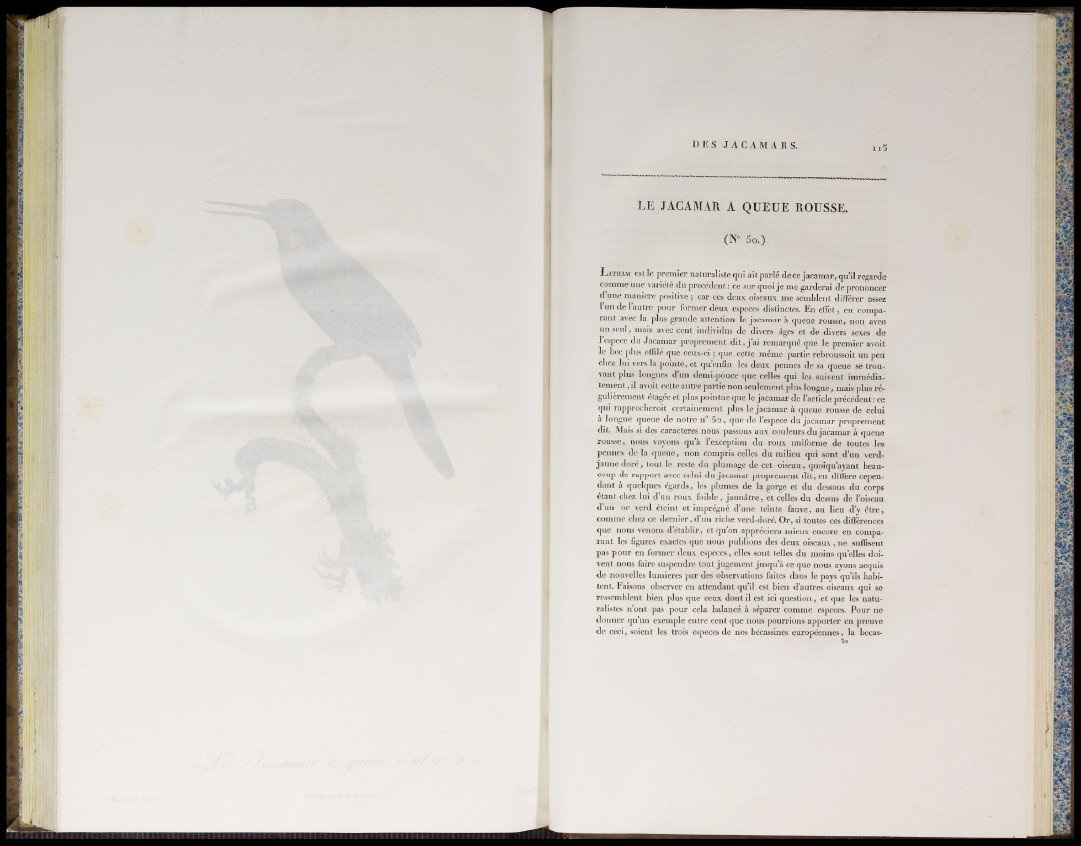
LE JACAMAR A QUEUE ROUSSE.
(N° 5o.)
LATIIAM est le premier naturaliste qui ait parlé de ce jacamar, qu'il regarde
comme une variété du précédent: ce sur quoi je me garderai de prononcer
d'une manière positive ; car ces deux oiseaux me semblent différer assez
l'un de l'autre pour former deux especes distinctes. En effet, en comparant
avec la plus grande attention le jacamar à queue rousse, non avec
un seul, mais avec cent individus de divers âges et de divers sexes de
l'espece du Jacamar proprement dit, j'ai remarqué que le premier avoit
le bec plus effilé que ceux-ci ; que cette même partie rebroussoit un peu
chez lui vers la pointe, et qu'enfin les deux pennes de sa queue se trouvant
plus longues d'un demi-pouce que celles qui les suivent immédiatement
, il avoit cette autre partie non seulement plus longue, mais plus régulièrement
élagée et plus pointue que le jacamar de l'article précédent : ce
qui rapprocherait certainement plus le jacamar à queue rousse de celui
à longue queue de notre n° 5 a , que de l'espece du jacamar proprement
dit. Mais si des caractères nous passons aux couleurs du jacamar à queue
rousse, nous voyons qu'à l'exception du roux uniforme de toutes les
pennes de la queue, non compris celles du milieu qui sont d'un verdjaune
doré, tout le reste du plumage de cet oiseau, quoiqu'ayant beaucoup
de rapport avec celui du jacamar proprement dit, en différé cependant
à quelques égards, les plumes de la gorge et du dessous du corps
ctant chez lui d'un roux foible, jaunâtre, et celles du dessus de l'oiseau
d'un or verd éteint et imprégné d'une teinte fauve, au lieu d'y être,
comme chez ce dernier, d'un riche verd-doré. Or, si toutes ces différences
que nous venons d'établir, et qu'on appréciera mieux encore en comparant
les figures exactes que nous publions des deux oiseaux , ne suffisent
pas pour en former deux especes, elles sont telles du moins qu'elles doivent
nous faire suspendre tout jugement jusqu'à ce que nous ayons acquis
de nouvelles lumieres par des observations faites dans le pays qu'ils habitent.
Faisons observer en attendant qu'il est bien d'autres oiseaux qui se
ressemblent bien plus que ceux dont il est ici question, et que les naturalistes
n'ont pas pour cela balancé à séparer comme especes. Pour ne
donner qu'un exemple entre cent que nous pourrions apporter en preuve
de ceci, soient les trois especes de nos bécassines européennes, la becas-
3o