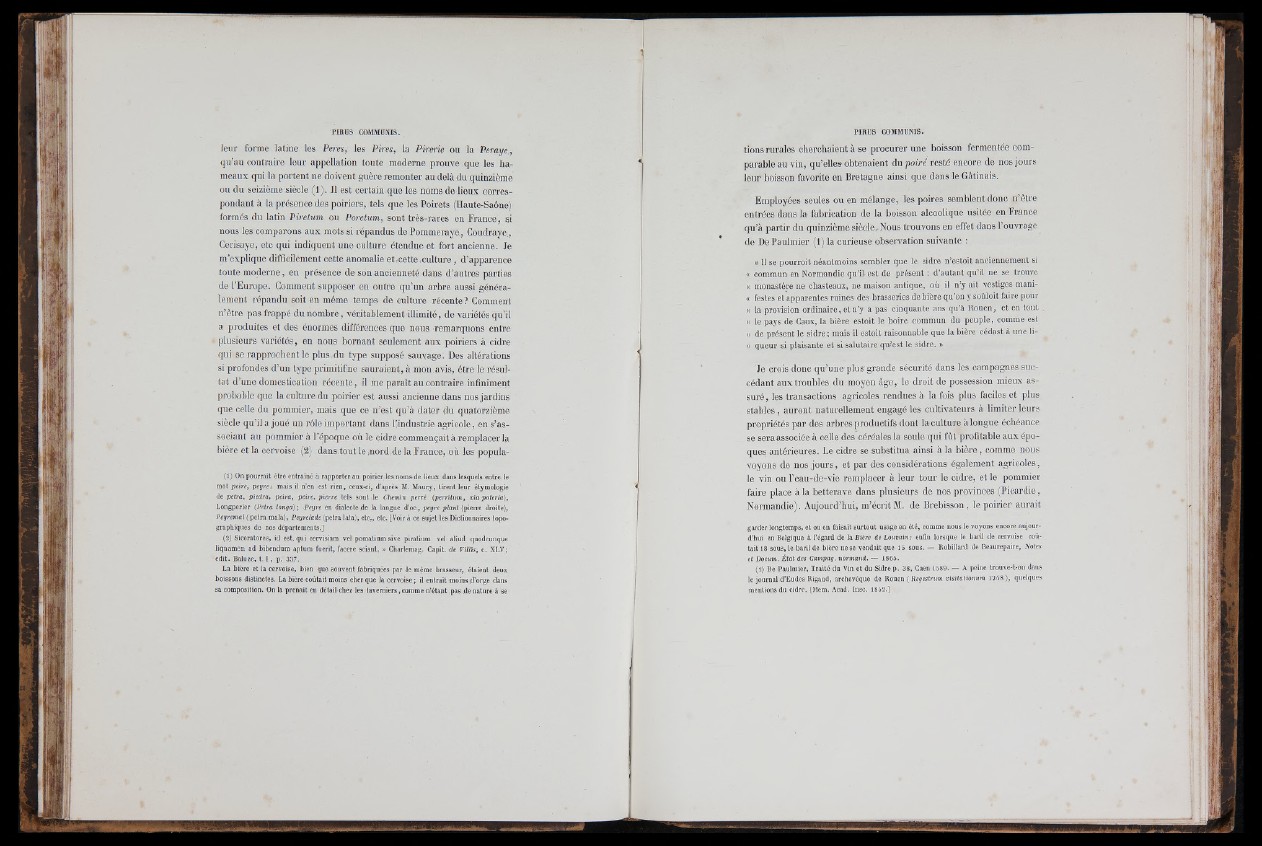
PIRÜ S COMMUNIS.
le u r forme la tin e les Peres, les P ires, la P ir e r ie ou la Pera ye,
q u ’au c o n tra ire le u r a p p e lla tio n to u te moderne p ro u v e que les h a me
a ux q u i la p o rte n t ne d o iv e n t guère rem o n te r au delà d u quinzième
ou d u seizième siècle (1 ). I l est c e rta in que les noms de lie u x co rre sp
on da n t à la présence des p o ir ie rs , tels que les Poirets (Haute-Saône)
formés d u la t in Piretum ou Poretum, sont trè s -ra re s en Fra n ce, si
nous les comparons a u x mots si répandus de P ommeraye., C o u d ra y e ,
Cerisaye, etc q u i in d iq u e n t une c u ltu re étendue et fo r t ancienne. Je
m ’e x p liq u e d iffic ilem e n t cette anomalie et c e tte ,c u ltu re , d ’apparence
toute m o d e rn e , en présence de son ancienneté dans d ’autres parties
de l ’Europ e. Comment supposer en o utre q u ’ u n a rb re aussi généralem
e n t ré p an du so it en même temps de c u ltu re récente? Comment
n ’ être pas frappé du n om b re , v é rita b lem e n t ill im ité , de va rié tés q u ’il
a p ro d u ite s et des énormes d ifférences que nous rema rq uo n s entre
[)lusieurs v a rié té s , en nous b o rn a n t seulement a u x p o irie rs à cid re
q u i se ra p p ro c h e n t le p lus du type supposé sauyage. Des a ltératio ns
si profondes d ’un typ e p r iin it ifn e sa u ra ie n t, à mon avis, être le ré su lta
t d ’une dom es tica tion ré ce nte , il me p a ra ît au c o n tra ire in fin im e n t
pro ba ble q ue la c u ltu re d u p o ir ie r est aussi ancienne dans nos ja rd in s
que celle du p om m ie r, mais que ce n ’est q u ’ à d ate r d u q uatorzième
siècle q u ’il a jo u é un rô le im p o rta n t dans ^ in d u s trie a g ric o le , en s’associant
au p om m ie r à l ’époque o ù le c id re c omme nça it à remp la cer la
bière e t la cervoise (2) dans to u t le ,nord de la France, où les p opula-
(1) On p o u r ra it ê tre e n tra în é à r a p p o rte r au p o irie r le s.n oms de lie u x d a n s lesq u els e n tre ie
m o t peire, peyre; m a is il n ’en e s t r ie n , ceux-ci, d ’a p rè s M. M a u ry , tire n t le u r étymo lo g ie
d e p e ira , p ie d ra , p e ira , pcire, pierre te ls so n t le Chemin perré {perritinn, via potería),
Lo n g p erie r (P e ira longa) ; Peyre en dia lec te d e la lan g u e d’o c , petjre plant (p ierre d ro ite ),
Peyremal { p e ira m a la), Peyrelade (p e tra la ta ), e tc ., etc. [Voir à ce s u je t le s D ic lionnaire s topo-
g ra p h iq u e s de nos d é p a rtem en ts .]
( 2) S ic e ra to re s , id e s t, q u i c erv isiam vel p om a lium siv e p ira lium vel a liu d q u o d cu n q u e
liq u am e n ad b ib e n d um a p tum fu e r il, facere sc ian t. « Ch a rlemag . Ca p it. de VUlis, c . XLV;
e d it . Ba lu z e, 1 .1 , p . 3 37.
La b iè re e t ia c e rv o is e , b ien qu e so u v e n t fab riq u é es p a r le mêm e b ra s s e u r, é ta ie n t d eux
b o is so n s d is tin c te s . La b iè re c o û ta it m o in s c h e r qu e la c erv o ise ; il e n tra it m o in s fl’o rg e dan s
s a c om p o sitio n . On la p r e n a it en d é tail ch ez les ta v e r n ie r s , comme n’é ta n t p a s d e n a tu re à se
P IR U S COMMUNIS.
lio n s ru ra le s ch ercha ie nt à se p ro c u re r une boisson fermentée c om p
arable au v in , q u ’e lles o bte na ie nt du. p o ir é resté encore de nos jo u rs
le u r boisson fa v o rite en Bretagne a ins i que dans le Gâtinais.
Employées seules ou en mélange, les poires semblent d onc n ’ être
entrées dans la fa b ric a tio n de la boisson a lcoo liq u e usitée en France
q u ’à p a r tir d u quin z ième siècle. Nous tro u v o n s en e ffe t dans l ’ouvrage
de D eP a u lm ie r (1) la curieuse observation su ivan te :
c< Il se pourroitnéanlmoins sembler que le sidre n’estoil anciennement si
« commun en Normandie qu ’i l est de présent : d’autant qu’il ne se trouve
« monastère ne chasteaux, ne maison antique, où il n’y a il vestiges mani-
« festes el apparentes ruines des brasseries de bière qu’on y soùîoit faire pour
« la provision ordinaire, et n ’y a pas cinquante ans qu’à Rouen, et en tout .
il le pays de Caux, la bière estoit le boire commun du peuple, comme est
<1 de présent le sidre; mais il estoit raisonnable que la bière cédast à une li-
(( queur si plaisante et si salulaire qu’est le sidre. »
Je cro is donc q u ’u ne-plus grande sécurité dans les campagnes succé
da nt a u x tro u b le s d u moyen âge, le d ro it de possession m ie u x ass
u ré , les tra nsa ctio ns agricoles rendues à la fois p lu s faciles et plus
s ta b le s , a u ro n t n a tu re llem e n t engagé les c u ltiv a te u rs à lim ite r le urs
p ro p rié té s p a r des arbres p ro d u c tifs d o n t la c u ltu re à lo ng u e échéance
se sera associée à celle des céréales la seule q u i fû t p ro fita b le a u x époques
anté rie ures. Le c id re se su b s titu a a in s i à la b iè re , comme nous
voyons de nos jo u r s , et p a r des considérations également a g rico le s ,
le v in ou l ’e au -d e-v ie remp la cer à le u r to u r le c id re , e t le p om m ie r
fa ire place à la b etterave dans p lu s ie u rs de nos p ro v in ce s (P ic a rd ie ,
N o rm a n d ie ). A u jo u rd ’h u i, m ’ é c rit M. de B re b is so n , le p o ir ie r a u ra it
g a rd e r lo n g tem p s , e t o n en fa is a it s u r to u t u sa g e en é lé , c om m e n o u s le v o y o n s e n co re a u jo u r d
’h u i en Be lg iq u e à l’é g ard d e la Bière de Louvain : enfin lo rsq u e le b a ril de c e rv o ise c o û ta
it 18 so u s , le b a ril de b iè re n e se v e n d a it q u e 15 so u s . — R o b illa rd de B e au re p a ire , N'oles
ct D o c im . É ta t des Campag. normand. — 1865.
( 1) De P a u lm ie r, T r a ité d u Vin e t d u Sid re p . 3 8 , Gaen 1589. — A pe in e tro u v e -t-o n dans
le jo u rn a l d ’E u d e s Rig au d , a rc h ev ê q u e d e Rou en ( Regestnnn l'is ifa lio n iim 124 8 ), q u e lq u es
r a e n lio n s d u c id re . [Mem, Acad. In sc. 1852.]
Í
f i i f
111
,4 I
i i l
i la