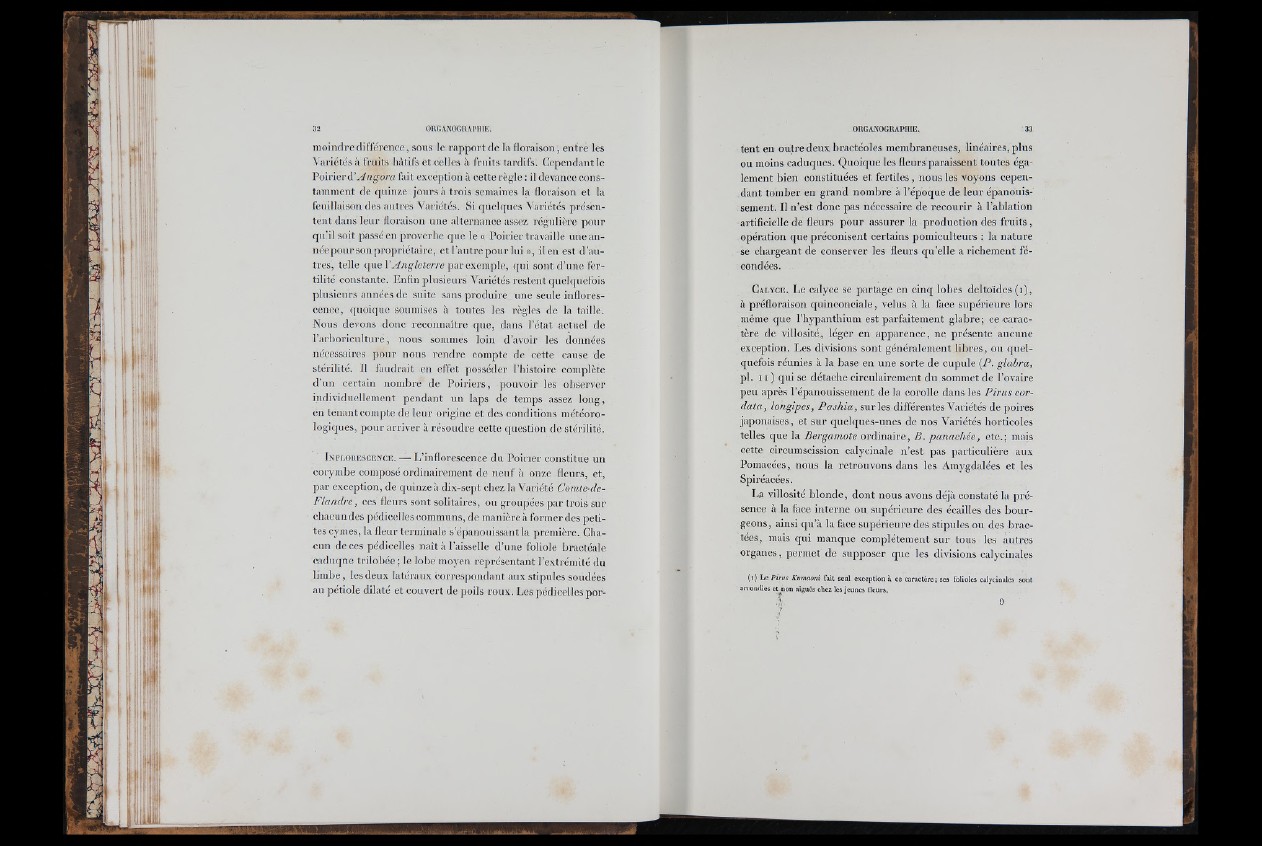
t raoiiKlredifiorence, sous le rapport de la floraison, entre les
A’ariétés à i'rnits liûtifs et celles à fruits tardifs. Cependant le
Poirier d’a4^«g om fait exception à cette règle : il devance constamment
de ([iiiiize jours à trois semaines la floraison et la
feuillaison des autres Variétés. Si cpielquos Variétés présentent
dans leur floraison une alternance assez régulière pour
qu'il soit passé en in-overbe que le « Poirier travaille une année
pour son propriétaire, et l’autre pour hii », il en est d’autres,
telle que l ’.^zig'/eterre par exemple, qui sont d’une fertilité
constante. Rulin plusieurs Aûiriétés restent quel([uefois
plusieurs années de suite sans produire une seule inflorescence,
i[uoique soumises à toutes les règles de la taille.
Nous devons doue reconnaître que, dans l’état actuel de
l’arboriculture, nous sommes loin d’avoir les données
nécessaires pour nous rendre compte de cette cause de
stérilité. Il faudrait en effet posséder l ’Instoire complète
d’un certain noiidu'e de Poiriers, pouvoir les observer
individuellement pendant un laps de temps assez long,
en tenant compte de leur origine et des conditions météoro-
logk[iies, pour arriver à résoudre cette cpiestion de stérilité.
Inflorescence. — L ’inflorescence du Poirier constitue un
coi-ymbe composé ordinairement de neuf à onze fleurs, et,
par exception, de quinze à dix-sept chez la Variété Comte-de-
Flandre, ces fleurs sont solitaires, ou groupées par trois sur
chacun des pédieelles communs, de manière à former des petites
cymes, la fleur terminale s’épanouissant la première. Clia-
cim de ces pédieelles naît à l ’aisselle d'une foliole braotéale
caduque trilobée ; le lolie moyen représentant l'extrémité du
limbe, les deux latéraux eorrespoiidant aux stipules soudées
au pétiole dilaté et couvert de poils roux. Les pédieelles portent
en outre deux bractéoles membraneuses, linéaires, plus
ou moins caduques. Qiioic[ue les fleurs paraissent toutes également
bien constituées et fertiles , nous les voyons cependant
tomber en grand nombre à l ’époque de leur épanouissement.
Il n’est donc pas nécessaire de recourir à l ’ablation
artificielle de fleurs pour assurer la production des fruits ,
opération que préconisent certains pomiculteurs : la nature
se chargeant de conserver les fleurs qu’elle a richement fécondées.
C a l y c e . Le calyce se partage en cinq lobes deltoïdes (i),
à préfloraison quinconciale, velus à la face supérieure lors
même (jue rhypantliium est parfaitement glabre; ce caractère
de villosité, léger en apparence, ne présente aucune
exception. Les divisions sont généralement libres, ou quelquefois
réunies à la base en une sorte de cupule {P. glabra,
pl. I l ) qui se détache circulairemeiit du sommet de l ’ovaire
peu après l ’épanouissement de la corolle dans les Pirus cordata,
longipes, Pashia, surles différentes Variétés de poires
japonaises, et sur quelques-unes de nos Afiiriétés horticoles
telles que la Bergamote ordinaire, B. panachée, etc.; mais
cette circumscission calyeiiiale n’est pas particulière aux
Pomacées, nous la retrouvons dans les Amygdalées et les
Spiréacées.
La villosité blonde, dont nous avons déjà constaté la présence
à la face interne ou supérieure des écailles des bourgeons,
ainsi qu’à la face supérieure des stipules ou des bractées,
mais qui manque complètement sur tous les autres
organes, permet de supposer que les divisions calycinales
( i ) L e Piru s Kumaoni fa it se u l e x c e p tio u à c e c a r a c tè r e ; s
iiTondies e t^ u o n a ig u ë s c h e z le s je u n e s fle u rs .
> fo lio le s c a ly c in a le s s o o t
- 'I
■ Ü''h'