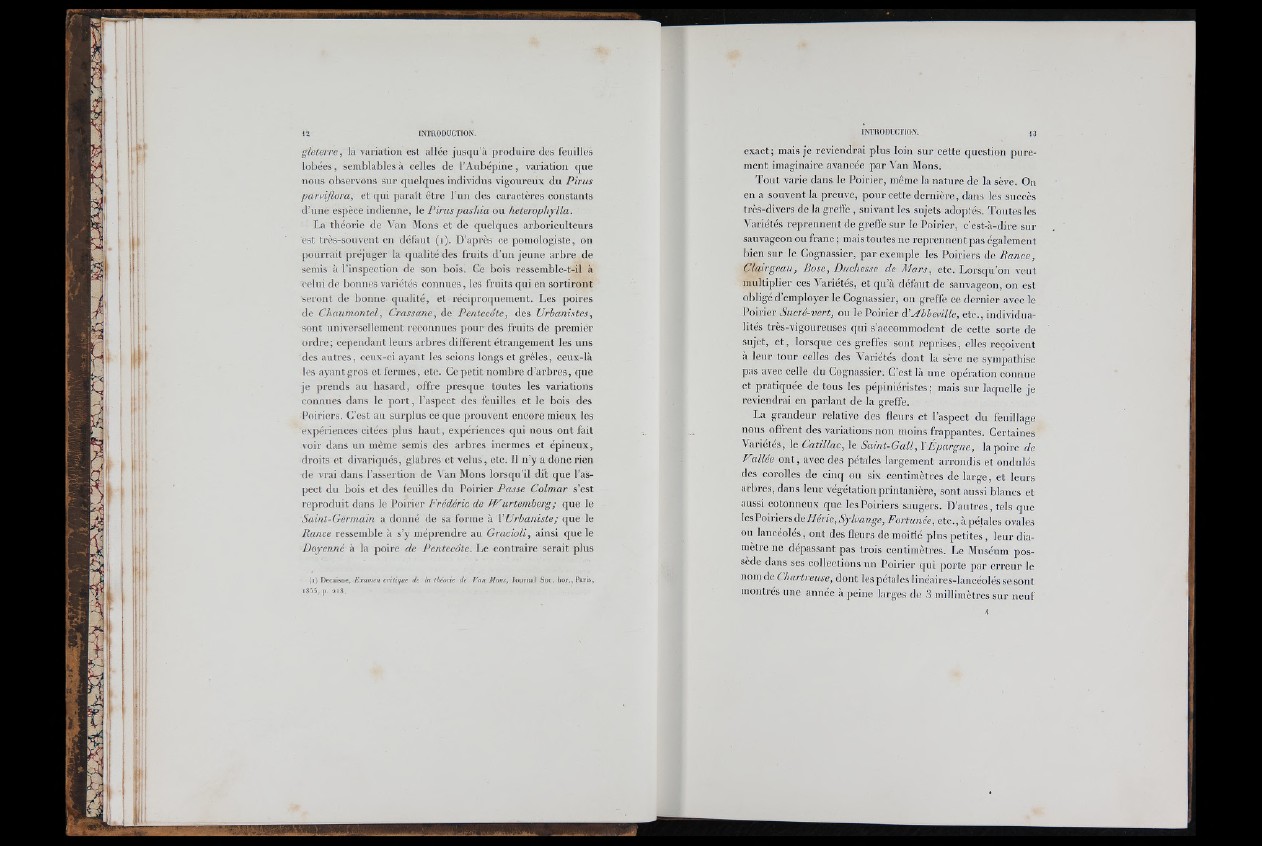
'! !
i::
I . I
12 INTRODUCTION.
gleterre, ia variation est ailée jusqu’à produire des feuilles
lobées, semblables à celles de l’Aubépine, variation (pie
lions observons sur quelques individus vigoureux du Pirus
parviflora, et qui paraît être l'iiii des caractères constants
(lliiiie espèce indienne, le Piruspasiiia ou heterophyiia.
La théorie de A’an Alons et de quelques arboriculteurs
est très-souvent eu défaut (i). D’après ce poiiiologiste, on
[loiirrait préjuger la (pialité des fruits d’uu ¡eiiiie arbre de
semis il l ’inspection de sou bois. Ce bois ressemble-t-il à
celui de lionnes variétés connues, les fruits qui eu sortiront
seront de bonne qualité, et réciprotjuemeiit. Les poires
(le Chaumontei, Crassane, de Pentecôte, des Urbanistes,
sont universellement reconnues pour des fruits de premier
ordre; cependant leurs arbres diffèrent étrangement les uns
(les autres, ceux-ei ayant les scions longs et grêles, ceux-là
les ayantgros et fermes, etc. Ce petit nombre d’arbres, que
je prends au hasard, offre presque toutes les variations
connues dans le p or t, l’aspect des feuilles et le bois des
Poiriers. C ’est au surplus ce (jue prouvent encore mieux les
e.xpériences citées plus haut, expériences qui nous ont fait
voir dans nu même semis des arbres inermes et épineux,
droits et divariqués, glabres et velus, etc. 11 n’y a donc rien
de vrai dans l'assertion de Van Mons lorsqu’il dit que l’aspect
du bois et des feuilles du Poirier Passe Coimar s’est
reproduit dans le Poirier Frédéric de FFurtemberg; que le
Saint-Germain a donné de sa forme à V Urbaniste ; cjue le
Rance ressemble à s’y méprendre au Gracioii, ainsi que le
Doyenné à la poire de Pentecôte. Le contraire serait plus
( i j D e c a isn e , Examen critique de la l/téorie de F a n Moii.s, J o u r n a l S o c . lio r ., P a r is ,
i8 5 5 , j). a i 8 .
exact; mais je reviendrai plus loin sur cette question purement
imaginaire avancée par Van Alons.
Tout varie dans le Poirier, même la nature de la sève. On
en a souvent la preuve, pour cette dernière, dans les succès
très-divers de la greffe , suivant les sujets adoptés. Tontes les
Variétés reprennent de greffe sur le Poirier, c’est-à-dire sur
sauvageon ou franc ; mais tontes ne reprennent pas également
bien sur le Cognassier, par exemple les Poiriers de Rance,
Cinirgean, Rose, Duchesse de Mars, etc. Lorsqu’on veut
multiplier ces Variétés, et qu’à défaut de sauvageon, ou est
obligé d’employer le Cognassier, on greffe ce dei-nier avec le
Poirier Sucré-vert, on le Poirier d’AbbcviUe, ete., individualités
très-vigoureuses qui s’accommodent de cette sorte de
sujet, e t, lorsque ces greffes sont reprises, elles reçoivent
à leur tour celles des A'ariétés dont la sève ne sympathise
pas avec celle du Cognassier. C’est là nue opération connue
et pratiquée de tous les pépiniéristes ; mais sur laquelle je
reviendrai en parlant de la greffe.
La grandeur relative des fleurs et l ’aspect du feuillage
nous offrent des variations non moins frappantes. Certaines
Variétés, le Catiiiae, le Saint-GaU, \Épargne, la poire de
Vaiiée ont, avec des pétales largement arrondis et ondulés
des corolles de cinq ou six centimètres de large, et leurs
arbres, dans leur végétation printanière, sont aussi blancs et
aussi cotonneux que les Poiriers saugers. D’autres, tels que
lesPoiriersde//eVm,Ay;rai;o'e, Fortunée, etc., apétales ovales
ou lancéolés, ont des fleurs de moitié plus petites , leur diamètre
ne dépassant pas trois centimètres. Le Muséum possède
dans ses colleclions un Poirier (pii porte par erreur le
nom de Chartreuse, dont les pétales linéaires-laiicéolés se sont
montrés une année à |icine larges de 3 millimètres sur neuf
t