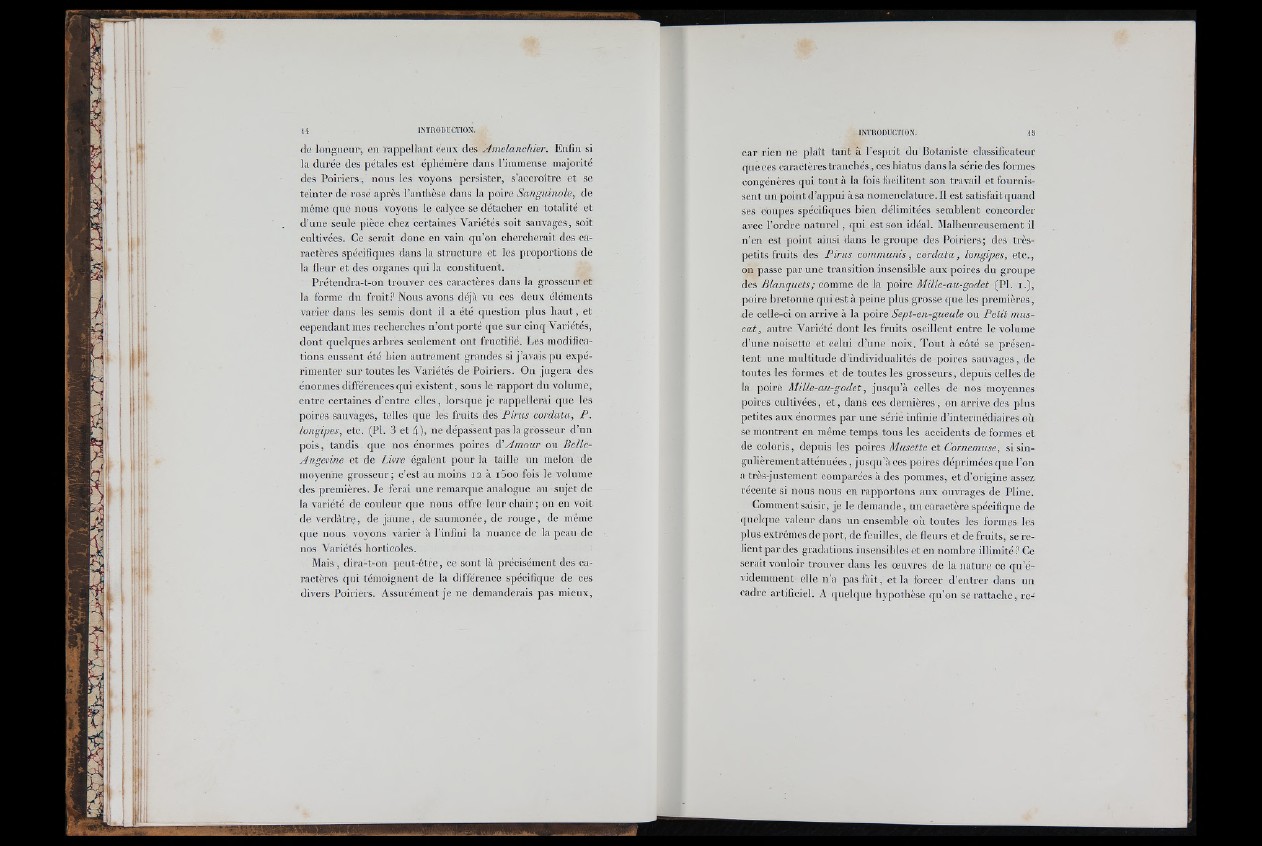
F i de longueur, en rappellant ceux des Amelanchier. Enfin si
la durée des pétales est éphémère dans l ’immense majorité
des Poiriers, nous les voyons persister, s’accroître et se
teinter de rose après l ’anthèse dans la poire Sanguinolc, de
même que nous voyons le calyce se détacher en totalité et
d’une seule pièce chez certaines Variétés soit sauvages, soit
cultivées. Ce serait donc en vain qu’on chercherait des caractères
spécifiques dans la structure et les proportions de
la fleur et des organes qui la constituent.
Prétendra-t-on trouver ces caractères dans la grosseur et
la forme du fruit.“ Nous avons déjà vu ces deux éléments
varier dans les semis dont il a été question plus h au t, et
cependant mes recherches n ’ont porté que sur cinq Variétés,
dont quelques arbres seulement ont fructifié. Les modifications
eussent été bien autrement grandes si j ’avais pu expérimenter
sur toutes les Variétés de Poiriers. On jugera des
énormes différences qui existent, sous le rapport du volume,
entre certaines d’entre elles, lorsque je rappellerai que les
poires sauvages, telles que les fruits des Pirus cordata, P .
longipes, etc. (Pl. 3 et 4 ), ne dépassent pas la grosseur d ’un
pois, tandis que nos énormes poires d'Amour on Belle-
Angevine et de Livre égalent pour la taille un melon de
moyenne grosseur; c’est au moins 12 à i 5oo fois le volume
des premières. Je ferai une remarque analogue au sujet de
la variété de couleur que nous offre leur chair; on en voit
de verdâtre, de jaune, de saumonée, de ronge, de même
([lie nous voyons varier à l ’infini la nuance de la peau de
nos Variétés horticoles.
Mais , dira-t-on peut-être, ce sont là précisément des caractères
qui témoignent de la différence spécifique de ces
divers Poiriers. Assurément je ne demanderais pas mieux,
car rien ne plaît tant à l ’esjirit du Botaniste classilieatenr
que ces caractères tranchés, ces hiatus dans la série des formes
congénères (jiii tout à la fois làcilitent son travail et fotiniis-
sent un point d’appui à sa nomenclature. Il est satisfait quand
ses coupes spécifiques bien délimitées semblent concorder
avec l’ordre naturel, qui est son idéal. Malbeureusement il
n’en est point ainsi dans le groupe des Poiriers; des très-
petits fruits des Pirus communis, cordata, longipes, etc.,
on passe par une transition insensible aux poires du groupe
des Blanquets; comme de la poire MiUe-au-godet (Pl. i.),
poire bretonne qui est à peine plus grosse que les premières,
de celle-ci on arrive à la [loire Sept-en-gueule ou Petit muscat,
antre Variété dont les fruits oscillent entre le volume
d’une noisette et celui d’une noix. Tout à côté se présentent
une multitude d’individualités de poires sauvages, de
toutes les formes et de toutes les grosseurs, depuis celles de
la poire Mille-au-godet, jusqu’à celles de nos moyennes
poires cultivées, e t, dans ces dernières, on arrive des pins
petites aux énormes par une série infinie d’intermédiaires où
se montrent en même temps tons les accidents de formes et
de coloris, depuis les poires Musette et Cornemuse, si singulièrement
atténuées, jusqu’à ces poires déprimées que l ’on
a très-justement comparées à des pommes, et d’origine assez
récente si nous nous en rapportons aux ouvrages de Pline.
Comment saisir, je le demande, un caractère spécifique de
([Uelqne valeur dans nu ensemble où toutes les formes les
plus extrêmes de port, de feuilles, de Ileurs et de fruits, se relient
par des gradations insensibles et en nombre illimité? Ce
serait vouloir trouver dans les oeuvres de la nature ce qu’évidemment
elle n’a pas fait, et la forcer d ’entrer dans tiii
cadre artificiel. A ([nelque hypothèse qu’on se rattache, rei
t a