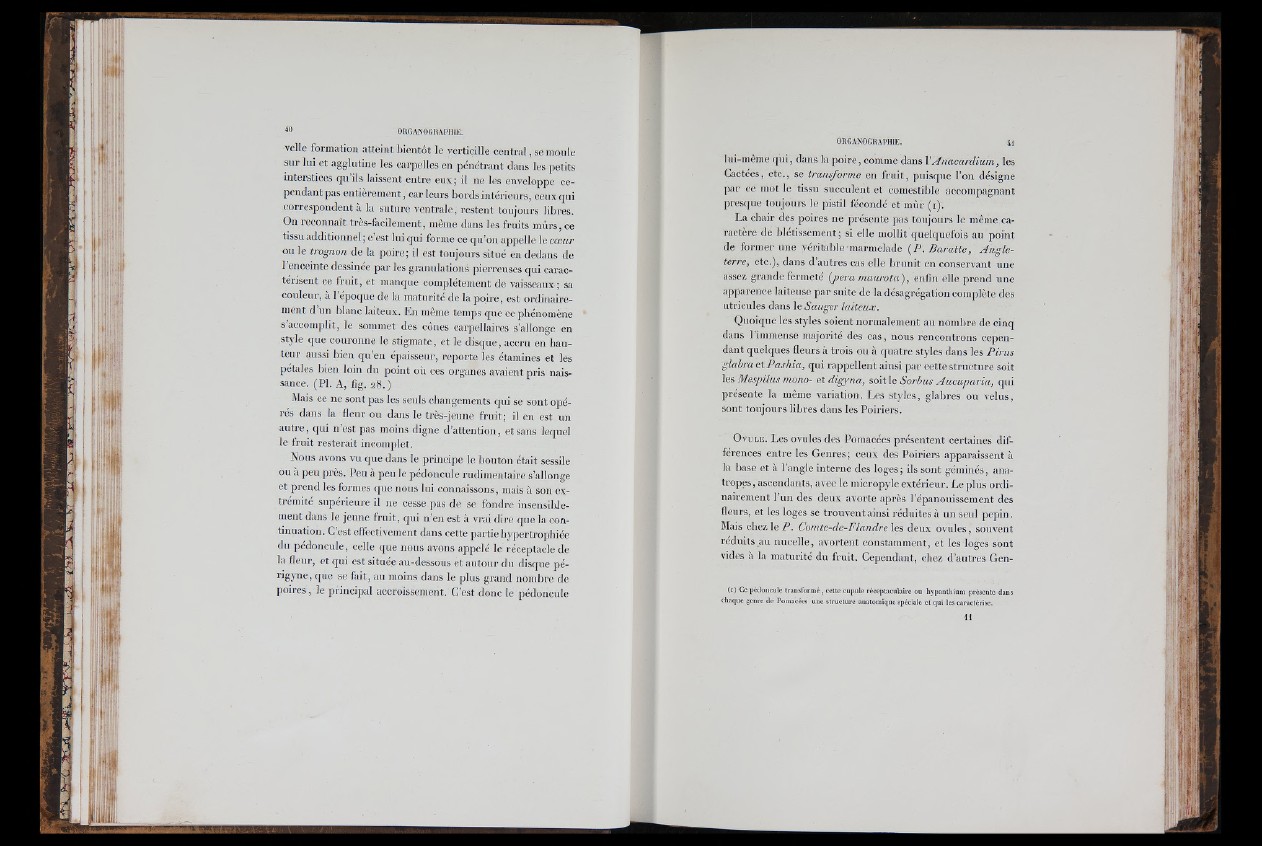
il
ri'i
velle formation atteint liientôt le verticille central, se mon le
sur lui et aggl ntine les carpelles en pénétrant dans les petits
interstices qu’ils laissent entre eii.x; il ne les enveloppe cependant
pas entièrement, car leurs bords intérieurs, ceux qui
correspondent à la suture ventrale, restent toujours libres.
On reconnaît très-facilement, même dans les fruits mûrs, ce
tissu additionnel ; c’est lui qui forme ce qn’on appelle le coeur
ou le trognon de la poire; il est toujours situé en dedans de
l ’enceinte dessinée par les granulations pierreuses qui caractérisent
ce fruit, et manque complètement de vaisseaux; sa
couleur, à l ’époqne de la maturité de la poire, est ordinairement
d lin blanc laiteux. En même temps que ce phénomène
s’accomplit, le sommet des cônes carpellaires s’allonge en
style que couronne le stigmate, et le disque, accru en hauteur
aussi bien qu’en épaisseur, reporte les étamines et les
pétales bien loin du point où ces organes avaient pris naissance.
(Pl. A, fig, 28.)
Biais ce ne sont pas les seuls changements qui se sont opérés
dans la fleuron dans le très-jeune fruit; il en est un
autre, qui n ’est pas moins digne d’attention, et sans lequel
le fruit resterait incomplet.
Nous avons vu que dans le principe le bouton était sessile
ou à peu près. Peu à peu le pédoncule rudimentaire s’allonge
et prend les formes que nous lui connaissons, mais à son extrémité
supérieure il ne cesse pas de se fondre insensilde-
ment dans le jeune fruit, qui n ’en est à vrai dire que la continuation.
C ’est effectivement dans cette partie hypertrophiée
du pédoncule, celle que nous avons appelé le réceptacle de
la fleur, et qui est située au-dessous et autour du disque pé-
rigyne, que se fait, au moins dans le plus grand iiomlire de
poires, le principal accroissement. C ’est donc le pédoncule
lui-niême qui, dans la poire, comme dans \Anacardium, les
Cactées, etc., se transforme en fruit, puisque l’on désigne
par ce mot le tissu succulent ct comestible accompagnant
presque toujours le pistil fécondé et mûr (i).
La chair des poires ne présente pas toujours le même caractère
de blétissement ; si elle mollit quelquefois au point
de former une véritable marmelade {P . Baratte, Angleterre,
etc.), dans d’antres cas elle brunit en conservant une
assez grande fermelé {pera manrota), enfin elle prend une
apparence laiteuse par suite de la désagrégation complète des
utricules dans leAiWg-cr laiteux.
Quoique les styles soient normalement au nombre de cinq
dans rimmense majorité des cas, nous rencontrons cependant
quelques fleurs à trois ou à quatre styles dans les Pirus
glabra et Pashia, qui rappellent ainsi par cette structure soit
les Mespiius mono- et digyna, soit le Sorbus Aucuparia, qui
présente la même variation. Les styles, glabres ou velus,
sont toujours libres dans les Poiriers.
O v u l e . Les ovules des Pomacées présentent certaines différences
entre les Genres; ceux des Poiriers apparaissent à
la base et à l ’angle interne des loges; ils sont géminés, ana-
tropes, ascendants, avec le micropyle extérieur. Le plus ordinairement
l ’un des deux avorte après répanoiiissement des
fleurs, et les loges se trouvent ainsi réduites à un seul pcpiii.
Biais chez le P . Comte-dc-Flandre\es, deux ovules, souvent
réduits au nucelle, avortent ooiistamment, et les loges sont
vides à la iiiaturité du fruit. Cependant, chez d’autres Gen-
( i ) Ce p é d o n c u le tr a n s fo rm é , c e tte c u p u le r é c e p ta c u la ir e o u h y p a n lliium p r é s e n te d a n s
c h a q u e g e n re d e P om a c é e s u n e s tr u c tu r e a n a tom iq u e sp é cia le c l q u i les c a ra c té ris e .