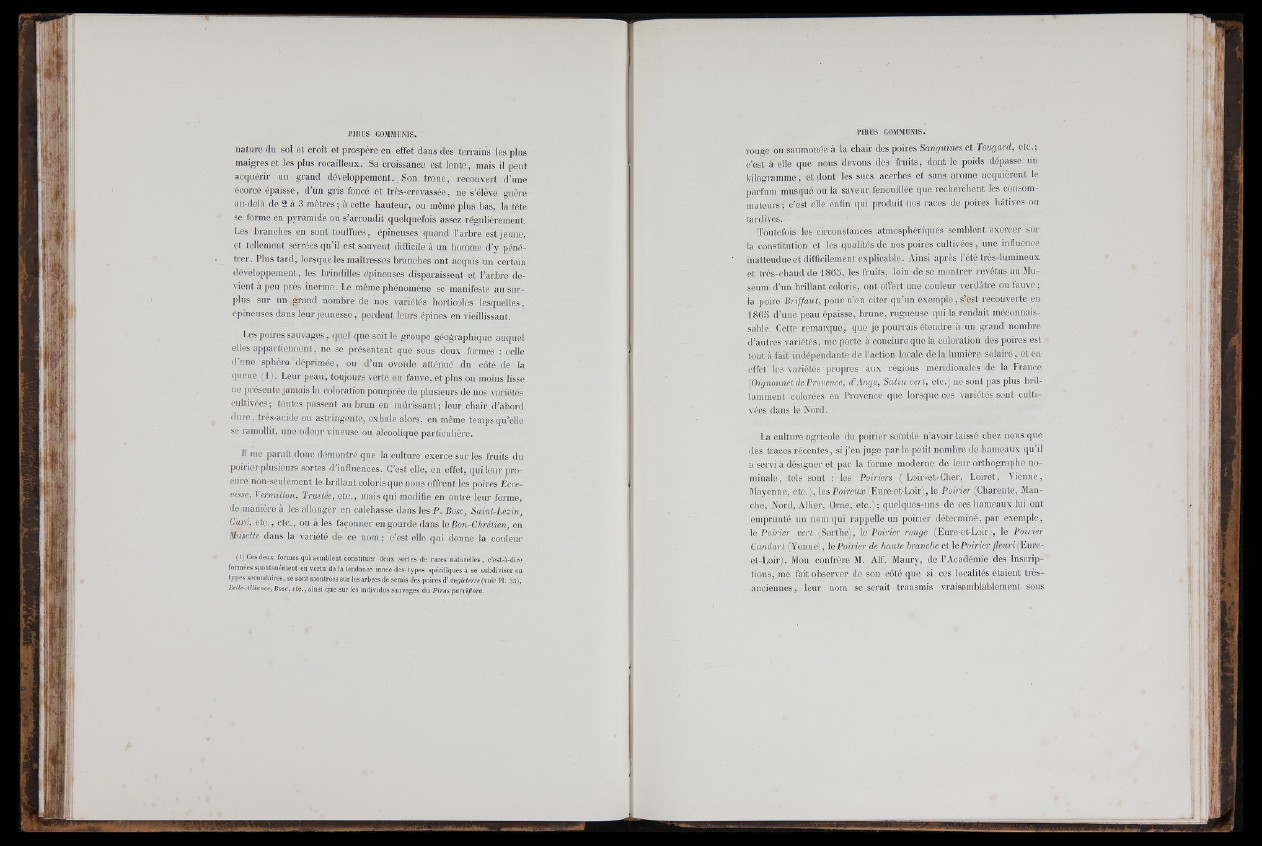
P IB B S COMMÜNIS.
n a tu re du sol et c ro it et prospère en e ffet dans des te rra in s les plus
maigres et les p lus ro c a ille u x . Sa croissance est le n to , mais il peut
a c q u é rir un g ra n d d éveloppement. Son t ro n c , re c o u v e rt d ’une
écorce épaisse, d ’u n g ris foncé et très-crevassée, ne s ’élève guère
a u-delà de 2 à 3 mètres ; à cette h a u te u r, ou même p lus bas, la tète
se forme en p y ram id e ou s’ a rro n d it que lq ue fois assez ré g ulièreme n t.
I.es branches en sont to u ffu e s , épineuses q ua nd l ’a rb re est je un e ,
et te llem e n t serrées q u ’i l est souvent d iffic ile à u n homme d ’y pénét
re r . Plus ta rd , lo rsq ue les m aîtresses b ranches o n t acquis u n ce rtain
d év e lo p p em e n t, les b rin d ille s épineuses disparaissent et l ’a rb re dev
ie n t à peu près in e rm e . Le même phénomène se manifeste au s u rp
lus s u r u n g ra n d n om bre de nos va rié tés horticole s le s q u e lle s ,
épineuses dans le u r jeunesse , p erde nt le u rs épines en v ie illis sa n t.
Les poires sauvages, q ue l que soit le g ro up e g éo graphique auquel
elles a p p a r tie n n e n t, ne se p résentent que sous deux formes : celle
d ’une sphère d é p rim é e , ou d ’ un ovoïde a tténué d u côté de la
queue (1 ). L e u r pea u, to u jo u rs ve rte o u fauve, et p lus ou moins lisse
ne présente jam a is la co loratio n p o u rp ré e de plus ieu rs de nos variétés
c u ltiv é e s ; tontes passent au b ru n en m û ris s a n t; le u r c h a ir d ’abord
d u re , très-acide ou a s trin ge nte , e xhale alors, en même temps q u ’elle
se ram o llit, une o d e u r vineuse ou a lcoo liq u e p a r tic u liè re .
1! m e p a r a î t d o n c d ém o n t r é q u e la c u l tu r e e x e r c e s u r le s f r u it s d u
p o i r i e r p lu s ie u r s s o r t e s d ’in f lu e n c e s . C’e s t e lle , e n e f fe t, q u i l e u r p r o c
u r e n o n - s e u lem e n t le b i-illa n t c o lo ris q u e n o u s o f f r e n t le s p o i r e s Écrevisse,
Vermillon, Truitée, e t c . , m a is q u i m o d ifie e n o u t r e l e u r fo rm e ,
d e m a n i è r e à le s a l lo n g e r e n c a le b a s s e d a n s le s P . Bosc, Sa in t-L e zin ,
Curé, e t c . , e t c . , o u à le s f a ç o n n e r e n g o u r d e d a n s le Bon-Chrétien, e n
Musette d a n s la v a r ié t é d e c e n om ; c ’e s t e lle q u i d o n n e l a c o u le u r
(1) Ces d eu x fo rm e s q u i s em b le n t c o n s titu e r d eu x so rte s de ra c e s n a tu r e lle s , c’e st-à-d ire
fo rm ée s sp o n ta n ém en t en v e rtu de la ten d an c e in n é e d e s . ty p e s sp é cifiq u e s à s e su b d iv is e r en
ty p e s s e co n d a ire s , se so n t m o n tré e s s u r les a rb r e s d e s em is des p o ire s d'Argleten-e (v o ir Pl. 33),
lîfUe-Alliance, Bosc, e tc ., a in si q u e s u r le s in d iv id u s sa u v ag e s d u Pirus 'panipora.
P lIt lJS COMMUNIS.
rouge ou saumonée à la c h a ir des poires Sanguines et Tougard, e tc .;
c’ost à elle que nous devons des f r u it s , d on t le p oid s dépasse un
k ilo g ram m e , et d o n t les sucs acerbes e t sans arôme a c q u iè re n t le
p a rfum musqué ou la saveur fen o uillé e que re ch erch e nt les consomm
a te u rs ; c’est elle e nfin q u i p ro d u it nos races de poires h âtive s ou
tardives.
Toutefois les circonstances atmosphériques semblent e xercer sur
la c o n s titu tio n e t les qua lité s de nos poires c u ltiv é e s , une in flue n ce
in atte nd ue e t d iffic ilem e n t e x p lic a b le . A in s i après Tété trè s -lum in e u x
et trè s -c h a u d de 186S, les fru its , lo in de se m o n tre r re vê tu s au M u séum
d ’u n b r illa n t c o lo ris , o n t o ffe rt une co ule u r v e rd â tre ou fauve ;
la p o ire Br iffau t, p o u r n ’en c ite r q u ’un e x em p le , s’ est re co uve rte en
1865 d ’u ne peau épaisse, b ru n e , rugueuse q u i la re n d a it méconnaissable.
Cette rem a rq u e , que je p o u rra is étendre à u n g ra n d nom bre
d ’autres v a rié té s , me p orte à c o nc lu re que la co lo ra tio n des poires est
to u t à fa it indépendante de Taction locale d e là lum iè re s o la ire , c t en
effet les variétés p ro pre s a u x ré g ion s m é rid io n a le s de la France
(Oignonnet de Provence, d’Ange, S a tin vert, etc.) ne so nt pas p lus lu’il-
lam m e n t colorées en Provence que lo rsq ue ces va rié tés so nt c u lt ivées
dans le N o rd .
La c u ltu re a g ric o le d u p o ir ie r semble n ’a v o ir laissé chez nous q ue
(les traces récentes, si j ’ en ju g e p a r le p e tit n om bre de ham ea ux q u ’ il
a se rv i à d ésig n er et p a r la forme mo derne de le u r o rth o g ra p h e n o m
in a le , tels sont : les Poiriers ( L o ir -e t-C h e r, L o ire t , T ie n n e ,
.Mayenne, e tc .), les P o ir eu x (E u re -e t-L o ir), le Poirier (Charente, M a n che,
N o rd , A llie r , Orne, e tc .) ; q ue lques-uns de ces h am ea ux lu i ont
emp run té u n nom q u i ra p p e lle un p o ir ie r d é te rm in é , p a r exemple,
le P o irie r vert ^Sarthe), le Poir ier rouge (E u re -e t-L o ir) , le Poir ier
Calidari (Y o n n e ), le Poir ier de haute branche e t le Poir ier fleuri (Eu re -
e t-L o ir ) . Mon c o nfrè re â l. A lf . M a u ry , de l ’Académie des In s c r ip tio
ns , me fa it o bse rve r de son côté que si ces lo calités éta ie nt trè s -
anciennes , le u r nom se serait tra nsm is vra isem b la b lem e n t sous
J !
i : -.ivi
, - rr'
II