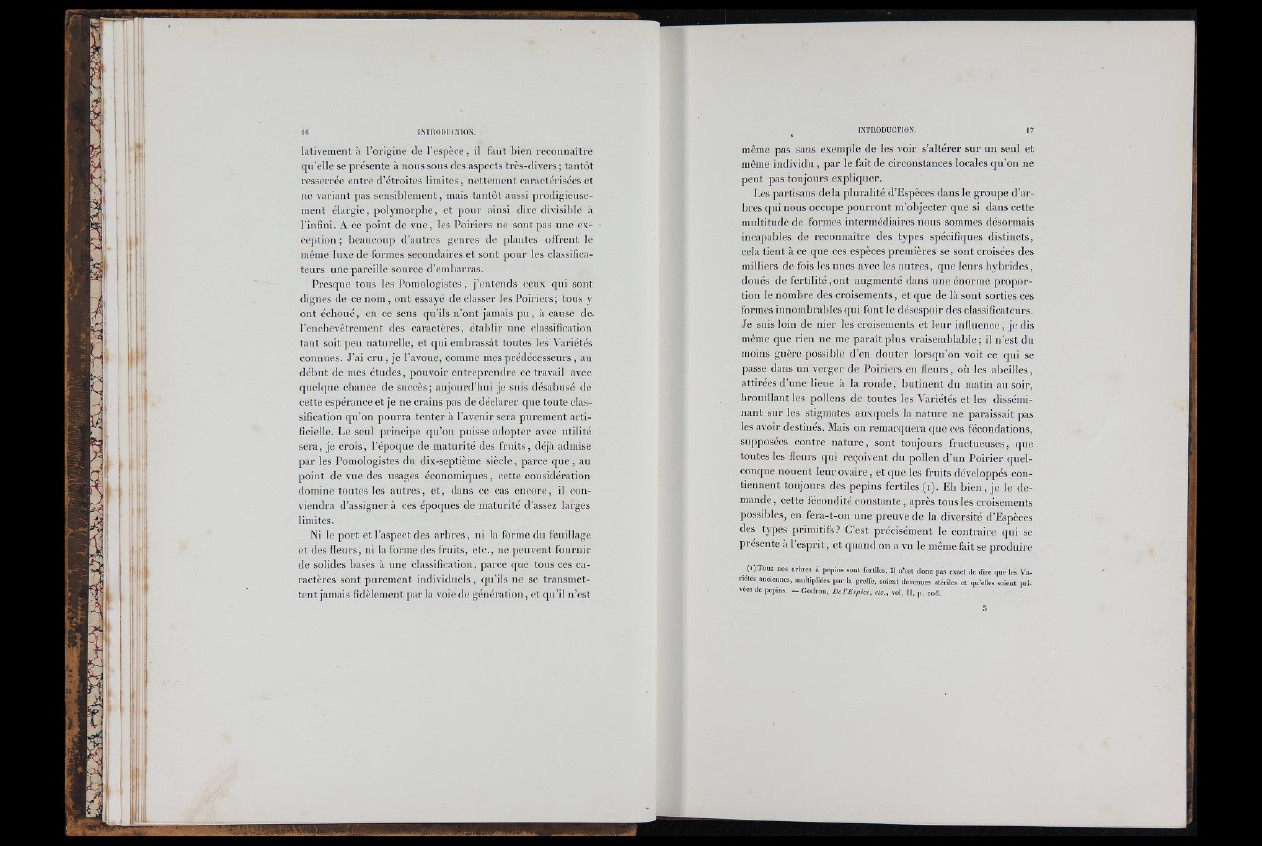
lativement à l ’origine de l’espèce, il faut bien reconnaître
qu’elle se présente à nous sous des aspects très-divers ; tantôt
resserrée entre d’étroites limites, nettement caractérisées et
ne variant pas sensiblement, mais tantôt aussi prodigieusement
élargie, polymorphe, et j)onr ainsi dire divisible à
l’infini. A ce point de vue, les Poiriers ne sont pas nue exception;
beaticoup d’autres genres de plantes offrent le
même luxe de formes secondaires et sont pour les classifica-
teiirs une pareille source d’embarras.
Presque tous les Pomologistes, j'entends ceux qui sont
dignes de ce nom , ont essayé de classer les Poiriers; tons y
ont échoué, en ce sens qti’ils n’ont jamais p u , à cause de.
l’enchevêtrement des caractères, établir une classification
tant soit peu naturelle, et qui emln-assàt toutes les Variétés
coiiniies. J’ai c ru , je l’avoue, comme mes prédécesseurs, au
début de mes études, pouvoir entreprendre ce travail avec
quelque chance de succès; aujourd’hui je suis désabusé de
cette espérance et je ne crains pas de déclarer que toute classification
qu’on pourra tenter à l ’avenir sera purement artificielle.
Le seul principe qu’on puisse adopter avec utilité
sera, je crois, l ’époque de maturité des fruits, déjà admise
par les Pomologistes du dix-septième siècle, parce q u e , au
point de vue des usages économiques, cette considération
domine toutes les autres, et, dans ce cas encore, il conviendra
d’assigner à ces époques de maturité d’assez larges
limites.
Ni le port et l’aspect des arbres, ni la forme du feuillage
et des fleurs, ni la forme des fruits, etc., ne peuvent fournir
de solides bases à une classilloalion, parce que tous ces caractères
sont purement individuels , qu’ils ne se transmettent
jamais fidèlement par la voie de génération, et ([u’il n’est
même pas sans exemple de les voir s’altérer sur un seul et
même individu , par le fait de circonstances locales qn’on ne
peut pas toujours expliquer.
Les partisans delà pluralité d’Espèces dans le groupe d ’arbres
qui nous occupe pourront m’objecter que si dans cette
multitude de formes intermédiaires nous sommes désormais
incapables de reconnaître des types spécifiques distincts,
cela tient à ce que ces espèces premières se sont croisées des
milliers de fois les unes avec les autres, que leurs hybrides,
doués de fertilité,ont augmenté dans une énorme proportion
le nombre des croisements, et que de là sont sorties ces
formes innombrables qui font le désespoir des classificateurs.
Je suis loin de nier les croisements et leur influence, je dis
même que rien ne me paraît plus vraisemblable; il n’est du
moins guère possible d’en douter lorsqu’on voit ce qui se
passe dans un verger de Poiriers en fleurs, où les alieilles,
attirées d’une lieue à la ronde, butinent du matin an soir,
brouillant les pollens de toutes les Variétés et les disséminant
sur les stigmates auxquels la nature ne paraissait pas
les avoir destinés. Alais on remarquera que ces fécondations,
supposées contre nature, sont toujours fructueuses, que
toutes les fleurs qui reçoivent du pollen d’un Poirier quelconque
nouent leur ovaire, et que les fi-uits développés contiennent
toujours des pépins fertiles (i). Eh bien, je le demande,
cette fécondité constante, après tous les croisements
possibles, en fera-t-on une preuve de la diversité d’Espèces
des types primitifs? C ’est précisément le contraire qui se
présente a l ’esprit, et quand on a \i\ le même fait se produire
Cq T o u s n o s a rb r e s à p é p in s s o n t fc rlilo s . I l n ’e s t d o n c p a s e x a c t d e d ir e q u e le s V a rie
te s a n c ie n n e s , m u ltip lié e s p a r la g re ffe , s o ie n t d e v e n u e s sté rile s e t q u ’elles s o ie n t p r i-
vées d e p é p in s . - G o d ro n , De l’Espèce, etc., v o l. I I , p . i o 6 .
É Ü