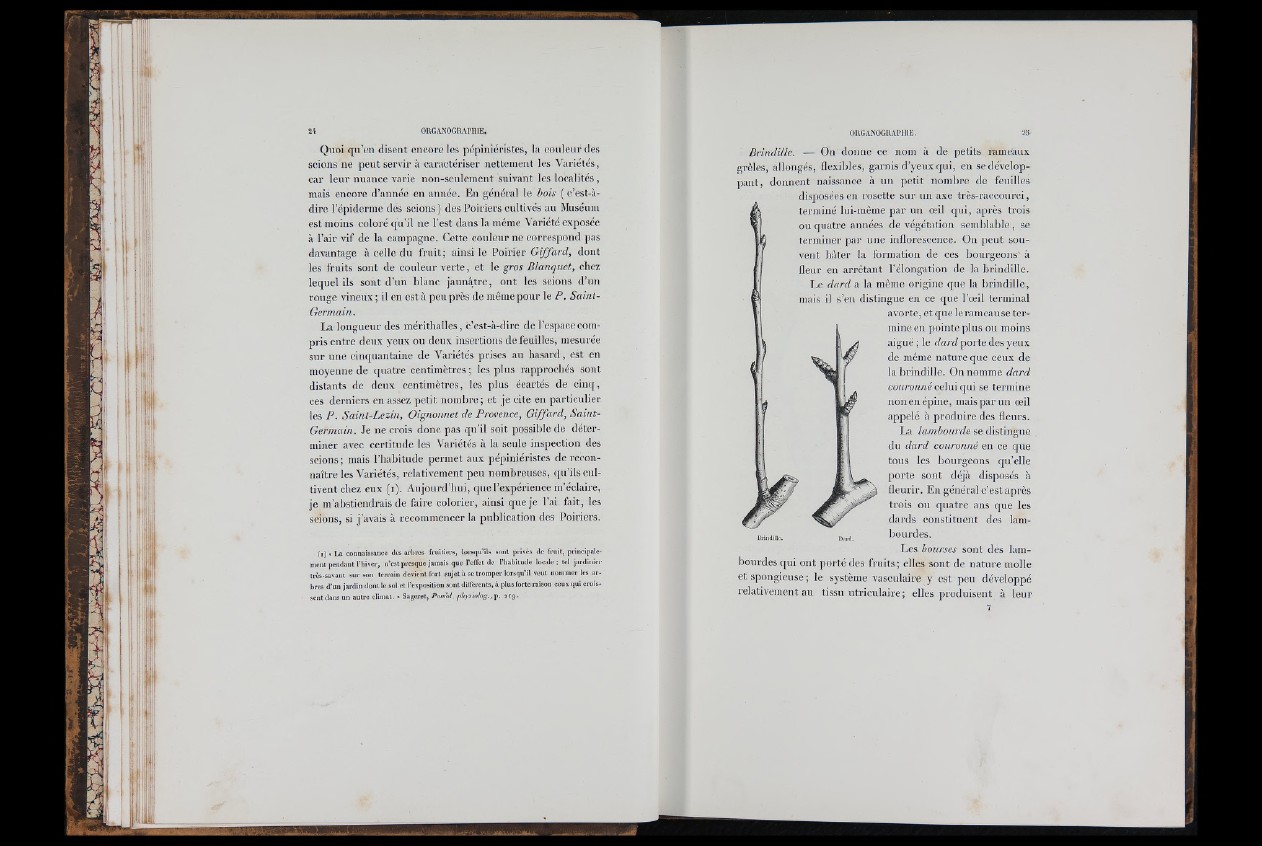
¡i I i " “'I
¡1 i 4 ,
24 ORGANOGRAPIIIE.
Quoi qu’en disent encore les pépiniéristes, lu couleur des
scions ne peut servir à caractériser nettement les Variétés,
car leur nuance varie non-seulement suivant les localités,
mais encore d’année en année. En général le bois ( c’est-à-
dire l’épiderme des scions) des Poiriers cultivés au Muséum
est moins coloré qu’il ne l’est dans la même Aùiriété exposée
à l ’air vif de la campagne. Cette couleur ne correspond pas
davantage à celle du fruit; ainsi le Voirier Giffard, dont
les fruits sont de couleur verte, et le gros Blanquet, citez
lequel ils sont d’im blanc jaunâtre, ont les scions d’un
rouge vineux ; il en est à peu près de même pour le P. Saint-
Germain.
La longueur des mérithalles, c’est-à-dire de l'espace compris
entre deux yeux ou deux insertions de feuilles, mesurée
sur une cinquantaine de Variétés prises au hasard, est en
moyenne de quatre centimètres; les plus rapprochés sont
distants de deux centimètres, les plus écartés de cinq,
ces derniers en assez petit nombre ; et je cite en particulier
les P . Saint-Lezin, OIgnonnet de Provence, Giffard, Saint-
Germain. Je ne crois donc pas qu’il soit possible de déterminer
avec certitude les Variétés à la setde inspection des
scions ; mais l ’habitude permet aux pépiniéristes de reconnaître
les Variétés, relativement peu nombreuses, qu’ils cultivent
chez eux (i). Aujourd’hui, que l ’expérience m’éclaire,
je m’abstiendrais de faire colorier, ainsi que je l ’ai fait, les
scions, si j ’avais à recommencer la publication des Poiriers.
f i ) « L a c o n n a is s a n c e d e s a rh r e s f ru itie r s , lo r sq u ’ils s o n t p r iv é s d e f ru i t, p r in c ip a le m
e n t p e n d a n t l’h iv e r , n ’e s tp r e s q u e jam a is q u e l’e ffet d e r iia b i lu d e lo c a le ; te l ja rd in ie r
tr è s -s a v a n t s u r so n te r r a in d e v ie n t fo rt s u je t à se tr om p e r lo r sq u ’il v e u t n om m e r les a r b
r e s d ’u n ja rd in d o n t le sol e t l’e x p o s itio n s o n t d ilf é re n ts , à p lu s ioiTe r a is o n c e u x q u i c ro is s
e n t d a n s u n a u tre c lim a t. - S a g e re t, Pomol. p/iysiolog., p . 2 1 9 .
Brindiiie. — On donne ce nom à de petits rameaux
grêles, allongés, flexibles, garnis d’yeux qui, en se développant,
donnent naissance à un petit nombre de feuilles
disposées en rosette sur nu axe très-raccourci,
terminé lui-même par un oeil qui, après trois
ou (jiiatre aimées de végétation semblable, se
terminer par une inflorescence. On peut souvent
bâter la formation de ces bourgeons à
fleur en arrêtant l’élongation de la brindille.
Le dard a la même origine que la brindille,
mais il s’en distingue en ce que l’oeil terminal
avorte, et que le rameau se termine
en pointe plus ou moins
aiguë ; le dard porte des yeux
de même nature que ceux de
labrindille. On nomme dard,
couronné celui qui se termine
non eu épine, mais par un oeil
appelé à produire des fleurs.
La iamhourde se distingue
du dard couronné en ce que
tous les bourgeons qu’elle
porte sont déjà disposés à
fleurir. En général c’est après
trois ou quatre ans que les
dards constituent des lam-
liourdes.
Les bourses sont des lambourdes
qui ont porté des fruits; elles sont de nature molle
et spongieuse ; le système vasculaire y est peu développé
relativement au tissu iitriculaire; elles produisent à leur
■I
ii !